I. De la permaculture à l’informatique
1. La confrontation du design avec les limites planétaires et la décroissance
« Les catastrophes chimiques de Bhopal en Inde (1984), les accidents nucléaires de Tchernobyl (1986) et Fukushima (2011), les affaires de l’amiante ou de la « vache folle » au cours des années 1990 »1 (Jarrige 2016) sont des exemples de catastrophes techniques humaines, voulant contrôler la nature. Ces évènements nous font prendre conscience de notre fragilité en tant qu'espèce vivante sur Terre. Certaines personnes comme Jacques Grinevald, s’intéressent aux sciences, à l’histoire des sciences et au progrès. De ce mélange de disciplines, « le mot « décroissance » [est] introduit par Jacques Grinevald pour traduire le travail du mathématicien et économiste roumain Nicholas Georgescu-Roegen. »1 (Jarrige 2016) La décroissance comme nous l'entendons aujourd’hui est une forme de rejet du productivisme économique grandissant, au sein de nos politiques publiques notamment. L’exemple du mouvement des low-techs illustre bien l’idée de cette décroissance. En fabriquant avec des matériaux soutenables, recyclés et recyclables dans la limite du possible, les low-techs conçoivent des objets simples, résilients et capables, visant à contrer ce productivisme grandissant. Des objets dit « low-techs » sont des objets facilement réparables, peu énergivores et techniquement simples. Ils sont moins performants que leurs concurrents high-tech, mais plus économiques en ressources.1 L’universitaire en histoire contemporaine François Jarrige décrit d’ailleurs la décroissance, dans son livre Technocritique paru en 2016, comme une manière fondamentale de « modifier les instruments techniques par lesquels s’opère notre rapport au monde, en commençant par critiquer le gigantisme, l’absurdité et le caractère non soutenable de nombreux choix techniques du passé et du présent. »1 Le principe de la décroissance, de la critique de la société croissante, s’est vu appliqué en Angleterre depuis 2005 dans une organisation humaine à grande échelle : la ville de Totnes.1 Rob Hopkins, enseignant et formateur à la permaculture et ses étudiants appliquent des exercices de soutenabilité et aspirent à la création du mouvement des « villes en transition ». La ville de Totnes et ses 9 214 habitants en 2021 en sont fondateurs. L’objectif de la ville est d’atteindre l’autonomie énergétique et alimentaire. Totnes donne l’exemple des possibles et est la tête de proue de ces villes en transition. Ainsi, la ville veut préparer l’humanité à l’ère de l’après-pétrole1, grâce à la décroissance. 
« Alors que la technique devait initialement nous sauver, permettre aux sociétés humaines de se protéger contre les risques naturels, contre la pression de l’environnement, un nombre croissant d’observateurs constatent que c’est l’inverse qui se produit. Comme le suggère l’apparition des notions d’« anthropocène » ou de « planetary boundaries » (limites planétaire) dans les milieux scientifiques, nous sommes désormais entrés dans une nouvelle ère géologique où l’agir technique humain est devenu une force géophysique dans un « système Terre » fermé et aux équilibres fragiles »1 (Jarrige 2016). La technique comme une barrière de contrôle et comme un moyen de progrès de l’humanité, sont les deux fondements qui définissent le technosolutionnisme. Il s’agit du regard porté sur la capacité de nos technologies présentes mais surtout futures à résoudre des problèmes d’ordre sociaux, environnementaux ou encore économiques, de manière pérenne et aveugle. La technocritique à l’inverse, questionne la technologie sur les aspects précédemment cités. Elle est amenée notamment à examiner comment nos relations sociales évoluent au contact de nos technologies, ou encore comment celles-ci creusent ou renforcent les inégalités économiques ou géographiques, mais aussi par exemple la surveillance, la gouvernance et les dérives potentielles de ces dites technologies. La technocritique cherche en somme à être nuancée et informée sur le développement des technologies, mais aussi sur leurs utilisations et leurs adoptions. Henry Cole et John Ruskin débattent déjà sur l’avènement des techniques au cours du XIXe siècle. Alors même que les ordinateurs n’existent pas, et que les mathématiciens mettent au point les prémices de ce que seront les calculateurs dans les années 1900. Henry Cole était un pragmatique qui croyait en la réconciliation de l'art et de l'industrie. Il voyait dans l’industrialisation un moyen d’améliorer la qualité de vie par la production d’objets bien conçus et abordables. En organisant la Grande Exposition de 1851, il promut l’idée que l’éducation artistique pouvait élever le goût du public et améliorer la production industrielle. Cole cherchait à intégrer la beauté dans les produits manufacturés tout en restant fidèle aux impératifs économiques et pratiques de son époque. Son regard sur la technologie pourrait presque s'apparenter à celui d’un technophile, c’est-à-dire à une personne qui célèbre le progrès technologique. John Ruskin quant à lui, était farouchement opposé à l'industrialisation et à la standardisation des productions qu'elle engendrait. Il voyait dans l'artisanat et les techniques traditionnelles une expression essentielle de l'humain, en valorisant le travail manuel comme source de beauté et de moralité. Ruskin rejetait la production industrielle de masse et revendiquait une société où les artisans pourraient s’épanouir, inspirant ainsi des personnes comme William Morris et le mouvement Arts & Crafts, qui prône un retour à l’artisanat et à la qualité du travail manuel, vis-à-vis de l’industrialisation déshumanisante. Il a jeté les bases de réflexions sur le rôle du design dans une société plus équitable, avec des notions telles qu’une production éthique, la simplicité et les matériaux naturels.
Un point de non retour quant au développement de nos technologies a été franchi depuis la révolution industrielle, avec comme première date notable, 1769, pour le dépôt de brevet de la machine à vapeur de James Watt. En 1913 débute le cycle de perturbation de l’azote grâce à l’agriculture industrielle et ses engrais chimiques qui gagnent du terrain. La constitution de l’atmosphère est modifiée en 1945 à cause des explosions des bombes nucléaires à Hiroshima et Nagasaki. Presque vingt années plus tard encore, en 1964, nous mesurons encore leurs effets sur les sols. En 2004 un clou d’or (point stratotypique mondial) est planté entre deux étages géologiques, faisant office de marqueur dans le temps de l’Anthropocène. Cette nouvelle époque géologique possède en réalité deux ruptures fondamentales. L’une est spatiale et l’autre est temporelle puisqu’une action exécutée aujourd’hui verra sa réaction dans 60 ans.1 Donna Haraway appuie sur le fait que « L’Anthropocène est la marque de discontinuités sévères ; ce qui vient après ne sera pas comme ce qui a précédé. »1 À l'inverse de l’Holocène, qui permettait encore aux espèces non-humaines de vivre dans leurs refuges naturels foisonnants,1 « un nom comme Anthropocène est la destruction des lieux et des temps de refuge pour les peuples humains et autres créatures. »1 (Haraway 2016) C’est-à-dire que avons transitionné d’une ère préindustrielle (avant le XVIIIe siècle) où tous les êtres vivants de la Terre cohabitent plus moins ensemble, en ayant un certain équilibre, à une ère où l’être humain a commencé à dégrader en tous points les habitats et les écosystèmes des autres êtres vivants.
La décroissance cherche donc à réduire volontairement la production et la consommation pour répondre aux limites écologiques de la planète et aux inégalités sociales. Elle s’oppose à la logique de croissance économique infinie, qui est jugée insoutenable dans un monde aux ressources limitées. La décroissance aspire aussi à construire une société où le bien-être humain ne dépend pas de l'accumulation matérielle et encourage des modes de vie plus simples, une relocalisation des activités, une sobriété énergétique, et une valorisation de la coopération plutôt que de la compétition. La permaculture se trouve exactement dans cette veine de décroissance. Dans son livre « Éloge du carburateur », Matthew Crawford fait une analogie pertinente à propos des systèmes agricoles qui permet d’appréhender la permaculture. Il y dit que l’agriculture industrielle impose sa vision à la terre avec des méthodes données et précises. La terre n’est plus qu’un espace abstrait sur lequel l’agriculteur planifie ses actions. Le sol n’est plus ici qu’une surface passive et docile. L’agriculture traditionnelle à l’inverse, adapte ses projets en fonction de son sol. Les contraintes d’un sol vivant sont fortes et force l’artisan à rester humble dans sa démarche.1 La permaculture est donc un concept traditionnel d’agriculture durable et autosuffisant (opposée à l’agriculture intensive industrielle). De par l’étude minutieuse de la terre, la permaculture se veut proche des écosystèmes et minimise ainsi l’impact de l’agriculteur sur la destruction des refuges pré-existants. Comme pour le low-tech et le high-tech dans l’informatique (nous reviendrons sur ces termes plus tard), la permaculture veut prendre à contre-pied le système agricole à grande échelle, celui d’un gigantisme non soutenable. La permaculture est un système de conception agricole qui a évolué à partir des idées de Bill Mollison et David Holmgren dans les années 1970. Le terme « permaculture » est une contraction des mots « permanent » et « agriculture ». La permaculture vise donc à créer des environnements durables, résilients et plus ou moins auto-entretenus. Il s’agit dès lors de protéger l’environnement, conserver les ressources naturelles et de maintenir la biodiversité et la régénération des sols. La pratique vise à minimiser l’impact négatif sur l’écosystème, tout en créant des méthodes qui répondent aux besoins humains, de manière éthique et équitable.1
L’approche de la permaculture peut être en totalité être holistique et transversale. Aau milieu du XIXe siècle où des débats et des critiques étaient émises sur la technique, et où la question de la décroissance en design se posait avec le mouvement Arts & Craft, pourquoi ne pas partir du même postulat mais sur la technologie cette fois-ci ? Force est de constater que la croissance jusqu’à aujourd’hui n’a pas réellement faibli. Notre consommation de données grâce à l’informatique personnelle et internet n’a jamais été aussi forte. « L’humanité produit chaque jour 2,5 quintillions d’octets de nouvelles données, selon IBM (soit 2 500 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 octets). La production mondiale de données numériques (articles, chansons, vidéos, etc.) devrait augmenter de 40 % par an entre 2023 et 2028. »1 La technologie, entre autres, explose et des innovations ou peut-être plus exactement du versioning semblent nous inonder chaque nouvelle année. Jusqu’à quel point allons-nous continuer cette croissance technologique et la miniaturisation des composants ? Avons-nous besoin de cette croissance toujours plus forte aujourd’hui ? Et demain ? Pourquoi ne pas appliquer les valeurs de la permaculture et de la décroissance à l’informatique et ainsi trouver une forme raisonnable de consommation technologique ?
- 1 - Jarrige, François. 2016. Technocritiques: du refus des machines à la contestation des technosciences. La Découverte-poche. Paris: la Découverte. Chapitre 12, p. 313.
- 2 - Ibid. p. 337
- 3 - Bosqué, Camille. 2024. Design pour un monde fini. Carnets Parallèles. Premier Parallèle. p. 103
- 4 - Jarrige, François. 2016. Technocritiques: du refus des machines à la contestation des technosciences. La Découverte-poche. Paris: la Découverte. Chapitre 12, p. 338.
- 5 - Ibid. p. 339
- 6 - « Totnes ». 2023. In Wikipédia. https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Totnes&oldid=208689445.
- 7 - Jarrige, François. 2016. Technocritiques: du refus des machines à la contestation des technosciences. La Découverte-poche. Paris: la Découverte. Chapitre 12, p. 313.
- 8 - Fabienne Denoual, maître de conférence en design à l’Université Toulouse Jean Jaurès, membre de l’Atelier d’Écologie Politique (Atécopol) et du laboratoire LLA Créatis. et associée de la SCIC Lune Bleue. Dans le cadre du cours Arts et écologie, séances 7.
- 9 - Haraway, Donna. 2016. « Anthropocène, Capitalocène, Plantationocène, Chthulucène. Faire des parents ». Traduit par Frédéric Neyrat. Multitudes 65 (4): p.76. https://doi.org/10.3917/mult.065.0075.
- 10 - Ibid.
- 11 - Ibid.
- 12 - Crawford, Matthew B. 2009. Éloge du carburateur essai sur le sens et la valeur du travail. La Découverte. p.101.
- 13 - « Permaculture ». 2023. In Wikipédia. https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Permaculture&oldid=210509409.
- 14 - 5 chiffres pour comprendre la « submersion » numérique », s. d.
2. Le permacomputing, pour la décroissance de l'informatique
« Le permacomputing est à la fois un concept et une communauté de pratiques orientés autour des problématiques de résilience et de régénérativité des technologies informatiques et réseaux inspirées de la permaculture. » 1 (« permacomputing wiki », s. d.) Le mot permacomputing est apparu en 2020 pour la première fois par le clavier de Ville-Mathias Heikkilä, de pseudonyme Viznut. Ville-Mathias est né en 1979 en Finlande. Artiste et programmeur, il est surtout connu pour son travail dans la demoscene (scène démo), un mouvement de sous-culture informatique axé sur la création de démos (qui sont de courtes présentations multimédias destinées à montrer les capacités graphiques et musicales des ordinateurs). Ses contributions 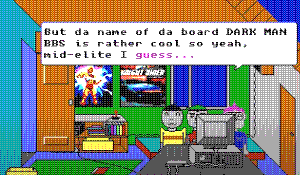
au mouvement ont permis à mettre en avant l'idée que la créativité peut s'épanouir dans des environnements informatiques avec des contraintes strictes. Il a également exploré d’autres formes d’arts numériques et partage ses réflexions sur la culture informatique à travers internet. Viznut fait un tour d’horizon sur des groupes ou des personnes dont les idées se rapprochent des siennes par rapport à l’informatique, à la société de consommation, et à la décroissance. Il recense principalement des projets autour de la résilience technologique, comme le workshop Limits ou le réseau social Merveilles.town, mais aussi Wim Vanderbauwhede et son essai Frugal Computing, ou encore le Low-tech Magazine. Pour être plus exhaustif, même si nous reviendrons en détail sur certains de ces mouvements, Ville-Mathias Heikkilä déplore le manque d’unité et de communication entre ces groupes qui partagent plus ou moins les mêmes idées : salvage computing, vernacular computing, frugal computing, collapse computing, solarpunk, cyberpunk, libre de droit, maker, hacker, low tech, … Il propose de se rassembler autour du mot « permacomputing ». 1 Ce mot valise est composé de « permaculture » et de « computing » (informatique). On comprend donc la volonté de transférer les valeurs et les idées de la permaculture à l’informatique, c’est-à-dire la durabilité, la résilience, le rendement énergétique, ou encore la préservation de l’environnement et de la biodiversité, autant que possible. Ce nouveau mot fait aussi son apparition en pleine ère covid (2020-2021), au moment où une partie importante de l’humanité se voyait contrainte d’utiliser l’outil informatique.

Des communautés construisent déjà des structures qui reprennent les idées de Viznut. Lors de ma recherche de stage sur le réemploi de l’informatique à Toulouse, mon moteur de recherche a tout de suite fait émerger l’association de recyclerie numérique qu’est la Rebooterie.Basée à Toulouse, cette association est fondée en 2020 dans le contexte de la pandémie de COVID-19, dans le même temps que Ville Matias décrit sont permacomputing. Inspirée par les initiatives de réparation de vélos, elle se consacre à la réparation et à la maintenance d'ordinateurs et d'autres appareils électroniques. Fonctionnant sur le principe du don de matériel, elle offre un espace où les bénévoles partagent leurs connaissances en informatique pour aider les individus à réparer leurs équipements. En mettant l'accent sur la réutilisation et la réparation plutôt que sur le remplacement, la Rebooterie vise à réduire le gaspillage électronique et à promouvoir une consommation plus responsable des technologies numériques. Le logo en forme de potion remplie de pixels et le nom de « Rebooterie » d’ailleurs, sont inspirés du rebouteux, le médecin d'antan, du « boot » qui est le terme anglais pour désigner le démarrage d’un appareil informatique, et du « reboot », l’anglicisme de redémarrer. Étant en parfait accord avec le sujet de ma recherche sur le permacomputing, nous nous sommes rencontrés pour faire connaissance et discuter (retrouvez en annexes l'entretien complet).


Pendant un mois j’ai participé à la vie de l’association et j’ai été assigné à certaines tâches. J’ai pris part à l’animation des ateliers pour acquérir de l’expérience dans le domaine du hardware et du software. J’ai appris énormément de manipulations en aidant à réparer et en écoutant les problématiques et les solutions proposées par les participants, lors des ateliers d’auto-réparation notamment. Tous les problèmes sont uniques et il y a souvent plusieurs manières de les résoudre, ce qui est exaltant. Cette période riche m’a éclairé sur les problématiques réelles rencontrées par les utilisateurs dans leur vie quotidienne et prosaïque. Certains points récurrents que j’ai relevés seront d'ailleurs observés plus loin dans cet écrit. Voici ceux rencontrés le plus fréquemment lors des ateliers d’auto-réparation :
- l’ancienneté du matériel, qui n’évolue pas au même rythme que les mises à jours logicielles,
- la surchauffe liée à la négligence de l’appareil, l’accumulation de poussière et autres poils qui enrayent et empêchent un refroidissement efficace de la machine,
- les logiciel (bugs, virus, écran bleu de la mort), qui sont en conflit avec d’autres ou qui se sont mal installés, provoquant des dysfonctionnements,
- l’alimentation électrique défectueuse (batterie, alimentation, ou sa connectique).
L’association est un vrai terrain de jeu pour les hackers, les makers, ou bien les bricoleurs qui font partie de l’association. L’association reçoit des dons de matériel et doit ensuite les remettre en état de marche pour certains ateliers. Ces temps appelés « de reconditionnement » (ou « recoco », pour les habitués) est un moment convivial de diagnostiques et de réparations d’appareils en tout genre (smartphone, tablette, ordinateur portable, unité centrale, …). C’est à ce moment, comme Camille le dit, qu’on va « frankensteiniser » les PC ! (On ne parle pas de zombie computing. Le zombie computing est une machine zombie, c’est-à-dire qu’elle est contrôlée à distance par un cybercriminel malveillant). À côté de toute la partie hardware, j’ai été chargé de revoir la communication hétérogène de l’association. Disposant déjà d’une charte graphique, j’ai opéré un simple lifting des documents. Le semainier et le planning du mois ne sont pas encore sur la même longueur d’onde, mais les salariés connaissent les logiciels de PAO (publication assistée par ordinateur) libre de droit comme Scribus s’ils souhaitent faire des changements. Les affiches ensuite ont été un plus gros travail. L’idée était de trouver un principe simple à reproduire par les bénévoles ou les salariés. Ainsi, ils sont maîtres de leurs visuels de communication. Chaque atelier principal (décrit précédemment) a droit à une affiche. Elle sera placardée sur la devanture du local. Chaque couleur correspond à un atelier : ce principe permet aux participants de se repérer facilement sur le semainier. Cependant, certaines couleurs posent des problèmes de lisibilité et sont à revoir.
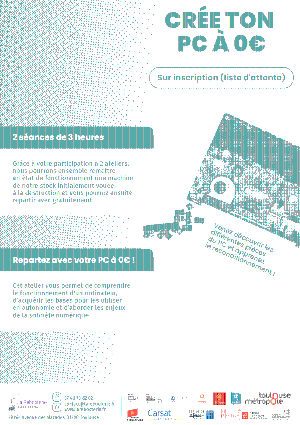
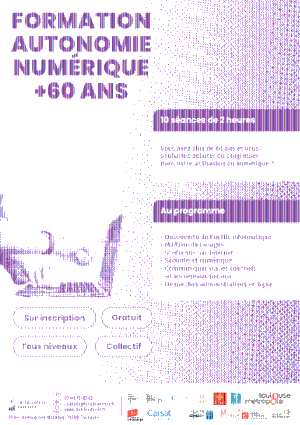



J’ai pu tirer une grande expérience concrète de la réparation électronique. Ainsi, j’ai pu identifier exactement les propos de Viznut et du permacomputing transpirer à travers des ateliers de la Rebooterie. Ce stage confirme mon idée, l’industrie de l’informatique doit évoluer. François Jarrige nous le disait plus tôt dans cet écrit, le problème des technologies industrielles solutionnistes devient de plus en plus problématique.1 Ajouter de la technologie partout et pour tout ne fait aucun sens. On trouve aujourd’hui toutes sortes de gadgets technologiques, ou du moins électroniques dans nos habitats.1 Qu’il s’agisse d’une cuillère de peser, ou d’un tapis piano pour pieds dans nos toilettes, ces appareillages utilisent des puces (chips) produites à l’autre bout du monde (principalement Taiwan dans l’entreprise TSMC), composé de ressources extraient en Afrique ou ailleurs, dans des conditions terribles et par les personnes vivant sur place.1 Aussi, « si les préoccupations environnementales n’étaient pas absentes auparavant, elles se généralisent et sont requalifiées au cours des années 1970, notamment sous l’effet de la médiatisation croissante de catastrophes écologiques. »1
Le technosolutionisme est la confiance que nous offrons à la technologie pour résoudre un problème. Les politiques voient les énergies renouvelables ou encore le nucléaire comme une solution aux énergies fossiles. En 2010 en Europe, les plus sceptiques à la question du technosolutionnisme sont la Finlande, la France et la Suisse. 57 % soit la majorité des habitants de ce territoire répondent négativement « à la question de savoir si la science et la technologie peuvent résoudre les problèmes des sociétés contemporaines. »1 (François Jarrige 2016) Le fondateur de la revue The Ecologist diffusée à 500 000 exemplaires Edward Goldsmith publie en 1972 le rapport « Changer ou disparaître ». Goldsmith écrit alors que « l’accroissement de la technosphère ne peut avoir lieu qu’au détriment de la biosphère. »1 La biosphère recule donc à chaque fois que la technologie débute une nouvelle entreprise. Le permacomputing ne se veut pas technosolutionisme, mais il utilise la technologie d’aujourd’hui et d’hier pour penser celle de demain.
Le terme de « technosphère » est employé puisque l’ordinateur et la culture du numérique ne sont pas encore concrètement théorisés au moment de la sortie de ce papier au début des années 1970. « La culture numérique (ou cyberculture) est un mode de pensée qui vise à comprendre et à analyser les défis et les enjeux liés au monde numérique dans lequel nous vivons. Les utilisateurs des outils numériques développeraient de nouvelles façons de créer et de communiquer. Ils dépassent le monde réel et inventent de nouvelles formes de penser et d’agir. Le numérique devient alors une véritable culture, avec des enjeux sociaux, politiques et éthiques. » 1 (Dubasque 2019) Le numérique est d’après le dictionnaire Larousse « la représentation d’informations ou de grandeurs physiques au moyen de caractères, tels que des chiffres, ou au moyen de signaux à valeurs discrètes. Cela se dit des systèmes, dispositifs ou procédés employant ce mode de représentation discret, par opposition à analogique. » 1 La pratique en tant que telle du numérique réside donc dans les actions d’un opérateur sur une technologie informatique des NTIC ou TIC (nouvelles technologies de l’information et de la communication). Nous parlons actuellement de révolution numérique comme « une mutation culturelle à l’origine de larges bouleversements dans notre perception du monde. » 1 (Dubasque 2019) C’est en 2005 pendant le Sommet mondial sur la société de l’information que le terme de révolution a vu le jour. Ce sommet mondial avait pour objectif d'analyser les transformations sociales et économiques importantes causées par l'utilisation généralisée des technologies de l'information et de la communication dans divers domaines de l'activité humaine.1 Il en a aussi été retenu que la technologie et la société ne sont pas des entités distinctes et autonomes : elles interagissent constamment, sont étroitement liées et se nourrissent mutuellement. 1 Des changements et des mutations s’opèrent doucement en même temps dans les deux parties, au fur et à mesure du temps. Les nouvelles machines informatiques changent nos usages envers nous-même et celles-ci, tout autant que les nouveaux moyens d'interagir avec elles, changent la conception de nos nouveaux outils technologiques.
Notre pratique du numérique dans l'hémisphère Nord (riche) de la planète nous laisse le luxe de réfléchir à ces problématiques, à l’inverse du Sud, qui, quant à lui, doit vivre dans cette réalité de la pauvreté. « D’un côté la technique, qui n’est jamais neutre, impose certaines contraintes de maniement et est porteuse de procédures opératoires. […] Du côté de la société, on sait depuis quelque temps déjà que les techniques sont ancrées dans le social, sont insérées dans des systèmes de valeurs. » 1 (Rieffel 2014) De plus, les utilisations s'intègrent dans diverses pratiques familiales, scolaires et professionnelles déjà établies, s'adaptant aux routines et évoluant dans des contextes économiques, sociaux et culturels spécifiques à chaque pays. 1 Le permacomputing s’inspire et partage des valeurs transversales à de nombreux groupes et mouvements vieux de plusieurs dizaines d’années maintenant. Viznut est né en 1979, encore dans la génération X, à l’aube de l’Y. Pour mieux comprendre le positionnement d’Heikkilä vis-à-vis de l’informatique et de sa pratique ancré dans un contexte sociétal d’un moment donné, nous allons reprendre les définitions des trois dernières générations de Didier Dubasque dans son livre Comprendre et maîtriser les excès de la société numérique, paru en 2019. 1 La génération X : L'écrivain canadien Douglas Coupland a popularisé cette expression « Génération X » en 1991. Cette génération au faible taux de natalité suit celle des baby-boomers de l’après-guerre. Elle a vécu la rareté de l’emploi et les contrats précaires. Cette génération a posé les bases de la recherche d’équilibre entre vie professionnelle et vie privée. C’est aussi la génération qui a grandi devant les écrans de télévision. La génération Y : L’origine de ce terme a plusieurs attributions. Pour les uns il vient de la génération précédente, pour d’autres, il pourrait venir de la phonétique anglaise de l’expression « Y » (Why), signifiant « pourquoi ». Cette génération, née entre 1980 et 2000, est plutôt celle des écrans d’ordinateurs et de la perte d’influence de la télévision. Elle était jeune lors de l’apparition des premiers outils informatiques mais en a très rapidement intégré les usages. On appelle aussi ce groupe les digitales natives car ils sont nés avec le numérique et ont accompagné ses différentes formes. Le jeu vidéo est pour eux un divertissement banal, au contraire de la génération X. La génération Z : Cette génération, née entre 1997 et 2012, est également nommée « génération C » pour « communication », « collaboration », « connexion » et « créativité ». Elle a grandi avec la technologie et surtout avec les réseaux sociaux. Cette génération considère qu’il n’y a plus ou très peu de barrières entre vie personnelle et vie professionnelle. Tout se mélange dans un monde où les plates-formes sociales régissent le quotidien. La génération Z est encore plus numérique que la génération Y.
Ville-Mathias est donc né avec les écrans d’ordinateurs et a participé à la modélisation du numérique que nous connaissons aujourd’hui. De ce fait, il a vécu l’avènement de l’informatique mais aussi les catastrophes technologiques humaines. C’est pourquoi il a rassemblé ses idées dans un écrit en 2020, qu’il a précisé en 2021, pour espérer sauver son informatique. Pour nous y faire voir plus clair, Viznut nous propose des points clés qui définissent le permacomputing 1 :
- Prendre soin de la vie
- Prendre soin des puces (électroniques)
- Rester simple et petit
- Espérer le meilleur, se préparer au pire
- Rester flexible
- Construire sur des bases solides
- Amplifier la prise de conscience
- Être transparent
- Répondre aux changements
- Tout a sa place.
Nous reviendrons sur la plupart des ces points au fil de cet écrit. Toutefois, on peut noter que cette liste n’est pas composée que de principes pragmatiques purs et durs appliqués à l’informatique. « Prendre soin de la vie » par exemple, n’est pas inscrit tout en haut de la liste par hasard, et n’a pas de rapport réel avec l’informatique de prime abord. Ce point doit être lu au sens large, pour être ensuite appliqué à un autre domaine. C’est en prenant soin de la (sa) vie que nous nous rendons attentifs aux détails de celle-ci. Ainsi, nous sommes plus aptes à appréhender et à nous confronter à des problématiques tangibles, telles que celles présentes dans nos appareils domestiques, mais tout aussi bien celles présentes dans notre société (proche, comme notre cercle familial, ou à plus grande échelle). Le permacomputing est un mouvement politique engagé, qui touche avant tout, certes à l’informatique, mais tout autant à l’humain, et à la société dans son ensemble. Il s’agit de l’humain et de l’informatique ensemble, et non pas l’humain d’un côté, et l’informatique de l’autre, telle une entité autonome. Le mouvement du permacomputing étant récent, ses bases sont amenées à se mouvoir, au fur et à mesure que la communauté la composant s’accroît. Les points de Viznut sont les siens et ne visent pas à la résolution de problèmes d’après le wiki du mouvement. 1 Pourquoi et comment pouvons nous alors les confronter à la réalité actuelle de l’informatique et des ressources humaines et terrestres, qui font que la technologie aujourd’hui soit critiquée ? C’est bien là l'objectif du permacomputing, être engagé dans une lutte environnementale et sociétale de l’informatique.
- 15 - « permacomputing wiki ». s. d. Consulté le 29 octobre 2023. https://permacomputing.net/.
- 16 - Heikkilä « Viznut », Ville-Mathias. 2021. « Permacomputing Update 2021 ». 2021. http://viznut.fi/texts-en/permacomputing_update_2021.html.
- 16 - Ibid.
- 18 - RTS - Radio Télévision Suisse, réal. 2025. Pourquoi on achète autant de gadgets inutiles ? | RTS. https://www.youtube.com/watch?v=e4W1gmqVYSM.
- 19 - ARTE, réal. 2025. La guerre des puces | ARTE. https://www.youtube.com/watch?v=ontJn5ZLHj8.
- 20 - Jarrige, François. 2016. Technocritiques: du refus des machines à la contestation des technosciences. La Découverte-poche. Paris: la Découverte. Chapitre 10, p. 273.
- 21 - Jarrige, François. 2016. Technocritiques: du refus des machines à la contestation des technosciences. La Découverte-poche. Paris: la Découverte. Chapitre 12, p. 311.
- 22 - Ibid. Chapitre 10, p. 274
- 23 - Dubasque, Didier. 2019. Comprendre et maîtriser les excès de la société numérique. Politiques et interventions sociales. Rennes: Presses de l’École des hautes études en santé publique. p. 20.
- 24 - Larousse, Éditions. s. d. « Définitions : numérique - Dictionnaire de français Larousse ». Consulté le 14 avril 2024. https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/ %num % %C3%A9rique/55253.
- 25 - Dubasque, Didier. 2019. Comprendre et maîtriser les excès de la société numérique. Politiques et interventions sociales. Rennes: Presses de l’École des hautes études en santé publique. p. 19.
- 26 - Ibid.
- 27 - Rieffel, Rémy. 2014. Révolution numérique, révolution culturelle ? Gallimard. Folio actuel. p.41-42
- 28 - Ibid.
- 29 - Ibid. p. 43.
- 30 - dubasque, Didier. 2019. Comprendre et maîtriser les excès de la société numérique. Politiques et interventions sociales. Rennes: Presses de l’École des hautes études en santé publique. p. 21.
- 31 - « permacomputing wiki ». s. d. Consulté le 29 octobre 2023. https://permacomputing.net/.
- 32 - Ibid.
3. Les idées du permacomputing à l’ère du Chthulucène
« Certains, comme le chercheur en design Alain Findeli, affirment que la mission du designer est de maintenir ou d’améliorer l’habitabilité du monde. Il s’agirait par exemple de faire en sorte que les personnes qui utilisent des objets, des services ou des interfaces n’en soient pas uniquement des usagers, mais soient en mesure de les comprendre, de se les approprier, voire de les interpréter d’une manière ouverte, qui autorise et prévoit les détournements, les variations, le jeu, le braconnage. » 1 (Bosqué 2024) Pourquoi est-il important de laisser à l’usager le pouvoir de comprendre l’objet ? Comprendre les choses est un droit. Si cette chose est cachée c’est qu’il y a des raisons. Dans le cadre d’un ordinateur, les plans des puces et des circuits électroniques peuvent être cachés pour des raisons de propriété. Ce niveau est déjà questionnable par rapport à celui du document secret défense. Pourquoi ne pas permettre à quiconque d’être curieux sur des parties qui composent mon objet et de le rendre open source ? 1 D’abord parce qu’il est plus difficile de se faire pour certains objets que d’autres. Même s’il existe aujourd’hui des logiciels open source, le matériel ouvert se fait plus discret. Nous y reviendrons dans les chapitres suivants ensuite,parce que dans notre cas, les puces deviennent le nouveau pétrole, et par extension tous les maux qui s'ensuivent : économiques, sociales, environnementales, politiques et géopolitiques, éthiques, …1
Le permacomputing s’inscrit parfaitement dans les dires d’Alain Findeli et de l’habitabilité du monde. En effet, étant donné que notre monde est régi par l’informatique, il est primordial de le comprendre et faire en sorte que celui-ci ait le moins d'impact négatif possible sur nos vies. Or, l’université de Lancaster, au Royaume-Uni, a mené une étude publiée le 10 septembre 2021 sur les émissions mondiales de gaz à effet de serre au regard de la fabrication, de l’utilisation, et de la fin de vie des objets de l’informatique et des NTIC. 1 Le résultat démontre que nos objets technologiques comme nos ordinateurs, nos smartphones, ou encore nos télévisions ou tout autre objets connectés, sont responsables à hauteur de 2,1 à 3,9 % des émissions à effet de serre globales mondiales. Si la croissance actuelle du marché du numérique continue ainsi, « d’ici 2040 l’informatique sera la cause de 14 % des émissions globales mondiales » 1 (Grindle 2023), comprenant toujours tout le cycle de vie de nos appareils. Au-delà des émissions de gaz à effet de serre dans l’atmosphère, le problème des déchets informatiques se pose. Nous remplaçons nos appareils qui fonctionnent toujours par des modèles encore plus puissants que nécessaires. Pour les particuliers, la durée de vie moyenne d’un smartphone avant remplacement est de deux ans et demi (le smartphone peut en réalité aussi être comparé à un micro-ordinateur). Pour les professionnels, la durée de vie moyenne des serveurs dans les data-centers est comprise entre trois et cinq ans.1 Tous ces appareils sont dans la très grande majorité encore fonctionnels.
En informatique, tout comme en agriculture, les solutions aux problèmes consistent souvent à renforcer le contrôle d’un processus, ce qui implique fréquemment une augmentation de la consommation de ressources. En revanche, la permaculture privilégie des approches qui laissent la nature agir, en limitant la dépendance à l'énergie artificielle. Heikkilä identifie des parallèles entre les méthodes ingénieuses des praticiens de la permaculture et celles des hackers (un point qui sera approfondi plus tard). Il souligne que la véritable justification de l'existence des ordinateurs réside dans leur capacité à accroître le potentiel humain pour soutenir et régénérer les écosystèmes. 1 (fabbula, s. d.) Or, et c’est bien ici que l’opposition se crée, puisque Edward Goldsmith nous disait que « l’accroissement de la technosphère ne peut avoir lieu qu’au détriment de la biosphère. » 1 (Jarrige 2016) Le permacomputing a comme objectif de renverser ce propos. Cependant les chiffres d’aujourd’hui donnent toujours raison à Goldsmith, puisqu’en 2023 ce sont environ 485 câbles sous-marins soit 1,4 million de kilomètres (presque deux allers-retours Terre-Lune) uniquement pour internet (sans parler des antennes et des datacenters). Ces câbles ravagent les fonds marins lors de leurs poses. Les mines qui extraient les précieux composants de nos appareils polluent massivement l’air, les sols et les eaux environnantes. Les populations locales en payent le prix sur leur santé, tout comme la faune et la flore. Un français par exemple équivaut à près d’une tonne par an de ressource pour la fabrication de ses équipements numériques. On appelle les équipements numériques personnels des terminaux utilisateurs. En France, la moyenne de ces dispositifs est de 10 par personne. Cela comprend nos smartphones, nos télévisions, nos ordinateurs, nos tablettes, nos box internet, et tout ce qui est dit intelligent, donc comprenant des puces. De plus, les terminaux utilisateurs sont ceux qui consomment le plus d’énergie, du fait de leur immense quantité en service. Cela représente 60 % de l’électricité mondiale, parmis laquelle 80 % est issue d’énergie fossile. La majorité de ces énergies fossiles sont dues à la fabrication des appareils, à l’instar de la Chine, qui utilise le charbon pour produire son électricité. De plus, les terminaux utilisateurs représentent à la hauteur de 75 % des ressources extraites pour la fabrication de matériels informatiques. Pour un ordinateur portable de 2 kilogrammes, c’est 800 kilogrammes de terre à extraire et plus de 1000 litres d’eau. La raréfaction des métaux dans les sols demande de creuser plus pour la même quantité qu’auparavant. On retrouve dans ordinateurs 50 des 90 éléments naturels du tableau périodique. Ce nombre augmente jusqu’à 60 pour nos smartphones. L’extraction et le raffinage conduisent à un stress hydrique et à la pollution des sols, avec comme autre conséquence des crises sociales locales. 1 Nous devons trouver une solution à cette surproduction de biens, et tout ce qui s'ensuit.

Il n’y a pas une manière miracle de faire du permacomputing, comme il n’y a pas une plante miracle en permaculture. 1 Viznut voit ainsi la permaculture comme une approche holistique de la conception, mettant l’accent sur la connexion et l’interdépendance entre les éléments d’un système. Transplantées à l’informatique, ces idées nous rapproche du mouvement solarpunk. Le solarpunk est un mouvement à la fois artistique mais surtout politique, issu du cyberpunk, qui propose une vision optimiste de l’avenir en réponse aux défis environnementaux actuels, comme le changement climatique, la pollution, et les inégalités sociales. Selon les membres de ce mouvement, l’esthétique, qui à ce jour est la plus représentative du solarpunk, est une publicité vidéo de 90 secondes pour du yaourt grec. Dear Alice a été produit par THE LINE, un studio d’animation. L’univers est fortement inspiré des « ghibli » japonais fondé par Hayao Miyazaki et Isao Takahata en 1985. On retrouve dans ce spot publicitaire des humains coexistants en parfaite harmonie avec la nature et aussi la technologie, où les robots sont au service de l’homme pour leur faciliter la vie de tous les jours (ici dans les champs). Les tables sont de véritables banquets, les robots volent et sont autonomes, le bleu comme couleur futuriste permet au spectateur de croire en la magie (des écrans holographiques volants sur chaque machine) et la nature est foisonnante. L’idée en tout cas est que tout le monde (humain et non humain) y trouve son compte, et que le Chthulucène existe. Est-ce du greenwashing de la part de Chobani, l’entreprise américaine qui est le commanditaire de cette animation ? Peut-être, mais en attendant il s’agit de la représentation descriptive la plus juste de l’utopie solarpunk. 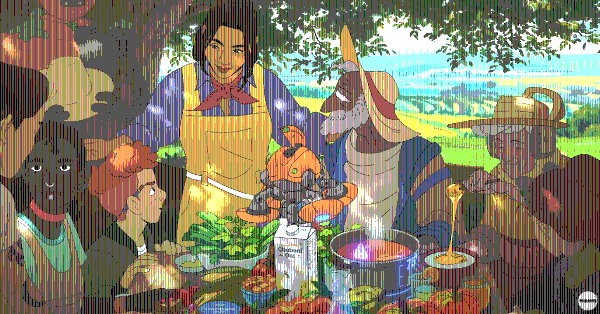
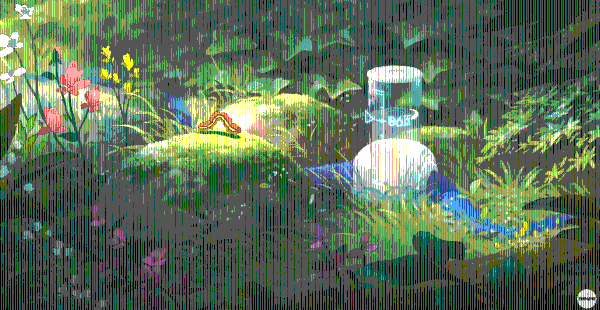
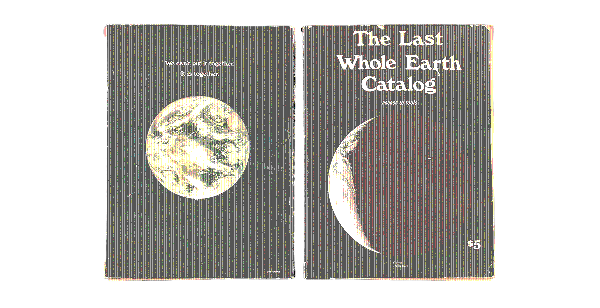
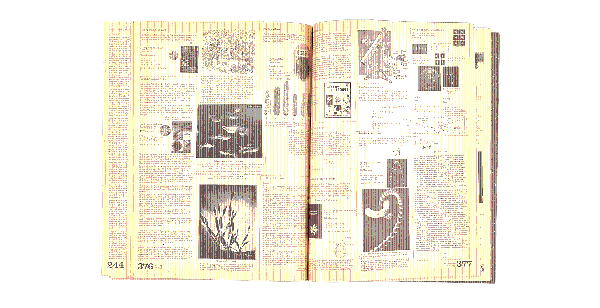
Nous remarquons donc que les idées derrière le permacomputing ne sont pas fondamentalement toutes nouvelles. Ce qui pourrait être jugé comme démarche inimaginée jusqu’alors, est celle d’une volonté d’une informatique technologiquement et humainement soutenable, au travers de ressources finies engagées. Comment alors y parvenir ? Les idées du permacomputing, esquissent un futur désirable autour de l’être humain, utilisateur et consommateur de l’informatique. Il n’y a pas de mode d’emploi du permacomputing. Les acteurs au sein de ce mouvement souhaitent et sont pour un mouvement fluide, qui évolue autour des notions existantes. Chacune et chacun est invité à collectivement et radicalement repenser la culture informatique. 1 Concrètement, nous sommes invités à être technocritique, non pas pour trouver une solution à un problème précis, mais pour devenir soi-même acteur, et non plus consommateur de nos objets technologiques.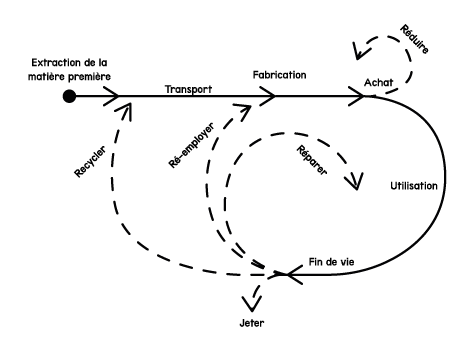
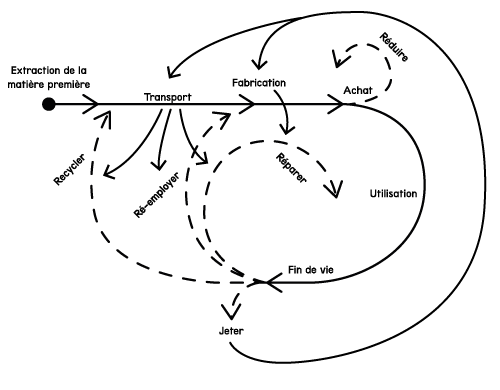
- 33 - Bosqué, Camille. 2024. Design pour un monde fini. Carnets Parallèles. Premier Parallèle. p. 15-16
- 34 - Underscore_, réal. 2025. L’IA vient de créer une puce parfaite (mais personne ne comprend comment). https://www.youtube.com/watch?v=NHgag2vKbxg.
- 35 - ARTE, réal. 2025. La guerre des puces | ARTE. https://www.youtube.com/watch?v=ontJn5ZLHj8.
- 36 - « Emissions from Computing and ICT Could Be Worse than Previously Thought ». s. d. Consulté le 10 janvier 2024. https://www.sciencedaily.com/ releases/2021/09/210910121715.htm.
- 37 - Grindle, Mike. 2023. « Permacomputing: Tackling the Problem of Technological Waste ». The New Climate. (blog). 31 juillet 2023. https://medium.com/the-new-climate/permacomputing-tackling-the-problem-of-technological-waste-4cc7a4437ad6.
- 38 - Ibid.
- 39 - fabbula. s. d. « What is permacomputing? » Notion. Consulté le 19 février 2024. https://www.notion.so.
- 40 - Jarrige, François. 2016. Technocritiques: du refus des machines à la contestation des technosciences. La Découverte-poche. Paris: la Découverte. Chapitre 10, p. 274.
- 41 - Chiffres provenant de « La fresque du numérique », à laquelle j’ai participé. 13 mai 2025.
- 42 - Haraway, Donna. 2016. « Anthropocène, Capitalocène, Plantationocène, Chthulucène. Faire des parents ». Traduit par Frédéric Neyrat. Multitudes 65 (4): p.76. https://doi.org/10.3917/mult.065.0075.
- 43 - Ibid. p. 77.
- 44 - Defoe, Daniel. 1728. Libertalia, une utopie pirate. La Petite littéraire. Libertalia. p. 103
- 45 - Ibid.
- 46 - Heikkilä « Viznut », Ville-Mathias. 2021. « Permacomputing Update 2021 ». 2021. http://viznut.fi/texts-en/permacomputing_update_2021.html
- 47 - Bosqué, Camille. 2021. Open design. Fabrication numérique et mouvement maker. B42 éd. Collection Esthétique des données 04. p. 129
- 48 - « #Café Bricol’ ». s. d. uMap. Consulté le 19 avril 2024. https://umap.openstreetmap.fr/fr/map/cafe-bricol_23889.
- 49 - « permacomputing wiki ». s. d. Consulté le 29 octobre 2023. https://permacomputing.net/.
II. Les grands principes du permacomputing
1. Conscientiser l’utilisation de nos machines
Comment alors utiliser l’informatique tout en contribuant positivement à l’environnement, la biosphère et la société ? 1 Dans tous les cas, nous ne voulons pas tomber dans les travers du technosolutionisme, comme évoqué précédemment. En étant critique toutefois, nous nous rendons compte que la majorité des appareils sont du côté utilisateur, de notre côté. Comment alors mettre en lumière cette problématique ? « Symptomatique d’une époque où les appareils ne sont plus des objets dignes d’intérêt, les relations homme-machine sont de plus en plus marquées par les registres de l’utilité, du rendement ou du gain de temps. […] Qu’il soit « amical » voire « invisible », ce milieu technique n’en est pas moins un carcan, une situation sous contrôle où tout échange est anticipé et programmé. À force de vouloir nous imiter dans des ordinateurs « humains, trop humains », c’est nous-mêmes, « simples personnes », qui risquons de passer à côté de leurs possibilités complexes et infinies. » 1 (Masure 2017) Au-delà de l’informatique et de la relation humain-machine comme nous le dit Anthony Masure, un mouvement reconnu qui franchit ces barrières prédéfinies par les designers, les ingénieurs et les constructeurs sont les makers. Les « makers » sont des personnes qui s'engagent dans la fabrication (making), souvent à petite échelle et souvent de manière collaborative ou communautaire et mettent l'accent sur le partage des connaissances. Les makers utilisent une variété d'outils et de techniques, allant des outils traditionnels comme le travail du bois et du métal aux technologies modernes comme l'impression 3D, l'électronique programmable et la découpe laser. Les makers peuvent être des amateurs passionnés, des bricoleurs, des artistes, des ingénieurs, des designers, …. Ils sont souvent motivés par le désir de créer des objets personnalisés ou utiles, et de les partager avec d'autres. Le mouvement des makers encourage l'expérimentation, l'apprentissage par l'action et la participation à des communautés de partage des connaissances telles que les hackerspaces, les fablabs et les makerspaces. Ils contribuent également à démocratiser l'accès aux outils et aux compétences de fabrication, ce qui permet à un plus grand nombre de personnes de devenir des créateurs actifs plutôt que de simples consommateurs. En ce sens, l’initiative Café Bricol’ à Toulouse peut donc facilement être qualifiée de makerspace.
Aujourd’hui les appareils à opérer sont de plus en plus électroniques et miniaturisés, les gens sont plus anxieux quant à leur réparation possible. Émilie Gaches, étudiante en master à l’isdaT (institut supérieur des arts et du design de Toulouse) est venue à l’atelier « rebooste ton PC » de l’association la Rebooterie. Elle n’a pas ouvert son PC car elle a peur de faire cette opération seule pour la première fois et peur de perdre ses données. « Il faudrait que ce soit plus simple, on aurait moins peur de l’ouvrir. » 1 Pourquoi se sent-on capable de (dé)monter un meuble IKEA mais pas une machine à laver ou un ordinateur ? Abraham Moles, dans son livre Vivre avec les choses : contre une culture immatérielle, dit que « si l’objet est en panne, qu’il s’agisse de l’automobile, du téléphone, ou de la machine à laver, la complexité de sa structure fait irruption dans le flux vital comme un obstacle. » 1 IKEA est une entreprise suédoise de renommée mondiale spécialisée dans la conception et la vente de meubles, d'articles de décoration d'intérieur et d'accessoires pour la maison. Son histoire remonte à 1943, lorsque Ingvar Kamprad, âgé de seulement 17 ans, a fondé l’entreprise de vente par correspondance de produits divers, notamment des stylos, des cadres photo et des articles de Noël, en utilisant ses initiales (I.K.) et le nom de son village natal (Elmtaryd) ainsi que la ferme où il a grandi (Agunnaryd) pour former le nom "IKEA". 1 Dans les années qui ont suivi, IKEA a élargi son offre pour inclure des meubles, des luminaires et des accessoires d'intérieur abordables et est devenu célèbre pour son modèle d'affaires novateur axé sur la vente en libre-service, l'efficacité opérationnelle et le design fonctionnel et esthétique. Une étape majeure dans l'histoire d'IKEA a été l'introduction du concept de mobilier en kit, permettant aux clients d'assembler eux-mêmes leurs achats à la maison, ce qui réduit les coûts de transport et de stockage. 1 Le produit fini que l’acheteur reçoit est donc en kit à monter chez soi (DIY).
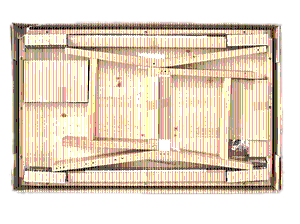
Ainsi, le bricoleur connaît mieux son objet et sera plus enclin à vouloir potentiellement le réparer. Effectivement, le meuble en kit permet de réduire le coût d’achat pour le consommateur, mais aussi les coûts de production et de logistique pour l’entreprise, bien qu’elle puisse aussi baisser la qualité.Le produit tiendra moins longtemps qu’une commode, un bahut ou qu’un vaisselier en bois massif de nos grand-parents, comme le fait remarquer Émilie Gaches lors d’un autre entretien. « IKEA nous a fait perdre le côté artisanal et transmission des compétences. IKEA est aussi devenu un problème écologique monstrueux puisque, leurs meubles sont passés de bois massifs à de l’aggloméré et à de la colle mélangée à de la poussière de bois. S’il y avait une bonne idée au départ, elle a été pervertie par le profit et la volonté capitaliste. » 1 D’un autre côté, même si les meubles de la marque suédoise sont moins résistants dans le temps, ils nous (r)éveillent notre côté bricoleur, et par extension réparateur, grâce aux notices de montage. 

« En 2012, plus de 400 millions d’ordinateurs sont vendus dans le monde et autour de 450 millions de smartphones. » 1 (Jarrige 2016) La croissance du parc informatique ne fait qu’augmenter, et avec elle, la tendance négative du changement climatique. En apprenant à connaître notre matériel, nous pouvons l’entretenir mais aussi le maintenir. Si nos appareils vivent plus longtemps, nous avons par conséquent moins besoin d’en produire. Le permacomputing ne souhaite pas seulement recycler ou réemployer, il souhaite changer nos habitudes, et par extension, les habitudes des fabricants et constructeurs. Pour y parvenir, les machines doivent être facilement réparables à la fois matériellement et numériquement (hardware et software). Or aujourd’hui, les fabricants de composants informatiques empêchent cela de par leurs politiques propriétaire du matériel. Il ne faut donc pas se reposer sur les constructeurs et leur circuit de consommation fermé et propriétaire, mais plutôt sur des architectures ouvertes. En attendant que les géants de la tech, comme Apple, Microsoft, ou Nvidia (pour ne citer qu’eux) prennent leurs responsabilités écologiques et mettent de côté l’hyper profit, des associations de recyclerie numériques adoptent l’approche holistique de la permaculture. À Toulouse par exemple, « L’association la Rebooterie a été créée en 2020, pendant la période du covid, en même temps que Viznut et son écrit au sujet du permacomputing. Sur le modèle des associations qui réparent des vélos, les premiers bénévoles qui aimaient bien l’informatique, se sont dit qu’il manquait justement un endroit où réparer son ordinateur. Ils ont alors mis leurs savoirs à disposition au travers de cette association. » 1 L’association fonctionne sur le don de matériel, et en refuse. Elle n’a pas assez d’espace de stockage et accumule des tours d’ordinateurs à ne plus savoir quoi en faire. Les unités centrales ne sont plus récupérées. Les salariés de l’association constatent également que l'écrasante majorité des personnes qui viennent pour des réparations sont aux sujet de, soit des smartphones, soit des ordinateurs portables. L’usage de ces appareils portables est moins encombrant et plus pratique. Le smartphone est en fait un micro-ordinateur, de la même manière que l’ordinateur portable est le condensé de l’attirail d’un ordinateur fixe et de ses périphériques. Du fait de la complexité de nos appareils, nous ne connaissons pas la réelle valeur matérielle, humaine et écologique de ces derniers. Sans doute aussi, de par leur présence abondante dans nos routines de vie, nous consommons ces appareils, les rendant trop rapidement et trop facilement remplaçable. 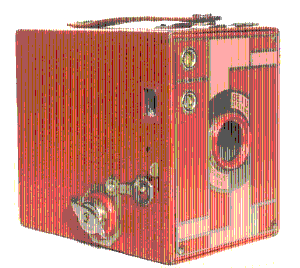
« La problématique principale réside dans l’idée que l’électronique grand public reste jetable. » 1 (« Framework Laptop », s. d.) De quel héritage nous provient alors la considération que nous avons du jetable ? Dans les années 1930 est né le Kodak Brownie, un appareil photo conçu pour rendre la pratique de la photographie accessible au grand public. Compact et fabriqué en bakélite, un matériau plastique rigide, il présente une forme rectangulaire aux coins légèrement arrondis et des détails métalliques tels que les boutons et le logo Kodak bien visible. Créée par la Eastman Kodak Company, le Brownie s’inscrit dans la vision de George Eastman, son fondateur, qui souhaitait démocratiser la photographie en proposant des appareils abordables et simples d’utilisation. Grâce à son prix réduit et à sa simplicité, l’appareil photo a permis à de nombreuses personnes de capturer leur quotidien, jouant ainsi un rôle crucial dans la popularisation de la photographie et dans la construction de l’histoire visuelle du XXᵉ siècle. Le Brownie de Kodak a participé à l’aliénation que nous avons des objets aujourd’hui, visant à « rendre les objets faciles d’emploi ». 1 (Bartholeyns et Charpy 2021) Le slogan de publicité de l’appareil était clair : « Pressez le bouton, nous faisons le reste ! » C’est aussi dans les mêmes années 50, que les ergonomes, et non pas les designers, recherchent cette nouvelle relation homme-machine, aussi bien pour le Brownie, que pour les appareils électroménagers. Encore une fois, avec des slogans marketing marquants, utilisés ici par la marque Moulinex : « Vive la cuisine presse-bouton ! » 1 Les appareils se referment pour ne laisser apparaître que leur peau extérieure. L’ergonomie est indéniablement augmentée de par cette conception, et l’usager ne peut être que satisfait d’un tel produit répondant parfaitement à ses besoins, sans se soucier de son fonctionnement interne, ou de comprendre quels sont les mécanismes à actionner. D’un autre côté, cette peau esthétique et ergonomique, voire affordante, est aussi la cause pour laquelle nous avons perdu notre sensibilité du fonctionnement des objets. Si la compréhension de l’objet est biaisée et que celui-ci est incompris, alors elle est la cause de leur délaissement. Plus tard, à partir des années 1990, le paradoxe des pièces standardes est flagrant, puisque la réparation du petit électroménager est plus cher que son remplacement. Le problème de consommation est donc aussi forcément incombé aux fabricants, qui poussent au rachat d’appareils neufs.
« Personne, ailleurs qu’à Cuba, ne s’aventure à démonter un Mac ou une brosse à dents électrique Braun. » 1 (Oroza 2009) C’est le constat actuel à Cuba, dont les habitants n’ont pas les mêmes solutions que nous, dans le nord global. Le permacomputing envisage un état d’esprit équivalent aux Cubains. Les cubains utilisent les composants de toutes sortes d’horizons matérielles pour hybrider et réparer leurs appareils. De la même manière qu’une unité centrale d’ordinateur fixe en est capable dans certaines mesures, c’est encore moins le cas pour les ordinateurs portables. Prenons l’exemple d’un ordinateur de la marque à la pomme, un Mac. L’élégance et la finesse de ses lignes en aluminium brossé en font un objet visuellement esthétique et démarqué. Quels propriétaires de ces objets voudraient déchirer la coque de ce dernier, au risque de le défigurer, ou pire, de l'endommager encore davantage ? Le mystère qui règne sous les carrosseries de nos appareils technologiques semble incompris et donc réservé aux sachants, aux experts : les fabricants, ou alors les « divinités » qui nous influencent et s'immiscent dans notre consommation, comme Cthulhu pourrait le faire dans nos rêves. Le permacomputing peut trouver l’entrain à cette démystification, au côté d’autres mouvements comme celui du design libre ou des makers. Ceux-ci ont la volonté d’endiguer ce phénomène de jetable grâce, entre autres, à l'open source, au libre.
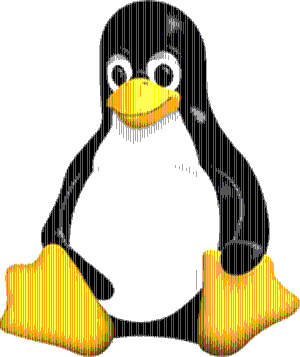
Il existe deux branches du libre dans le domaine de l’informatique : le hardware (matériel) et le software (logiciel). L’open source, ou code source ouvert, s’applique sur la partie logiciel (software) des machines. Apparu en 1983 grâce au projet GNU de Richard Stallman, l’open-source et les logiciels libres sont comme pour la partie hard, libres à copier, à distribuer, à étudier, à modifier et à améliorer en fonction des besoins de chacun. Richard Stallman est un programmeur et militant du logiciel libre. Il est surtout connu pour avoir fondé le mouvement du logiciel libre dans les années 1980. En tant que défenseur passionné des libertés informatiques, il milite pour le droit des utilisateurs à utiliser, étudier, modifier et distribuer librement les logiciels. Stallman est également un critique du logiciel propriétaire et des pratiques qui limitent la liberté des utilisateurs, et il a consacré sa vie à promouvoir les idéaux du logiciel libre à travers le monde. Pour pousser l’idée du logiciel libre à son maximum, Linus Torvalds créé en 1991 un système d’exploitation libre, GNU/Linux. Le système d’exploitation est le cerveau de la machine. Ce nouveau noyau est partageable mais surtout modifiable et maintenable. Linus Torvalds est un informaticien finlandais renommé pour avoir créé le noyau Linux utilisé dans le monde entier. Son initiative a donné des ailes au mouvement du logiciel libre et a permis le développement collaboratif d'un écosystème logiciel puissant. Son travail a eu un impact majeur sur l'industrie informatique, favorisant l'innovation, la transparence et l'accès universel aux technologies. Les logiciels de création assistée par ordinateur comme Adobe sont tout l’inverse de l’état d’esprit du libre. Ces logiciels sont la propriété d’une personne morale et ne peuvent pas être modifiés pour se conformer aux usages différents de chacun·e. Wikipédia est un exemple concret de réussite du libre, comme « une réappropriation citoyenne des outils numériques par les acteurs d’en bas. » 1 (Jarrige 2016). L’open hardware ensuite, ou matériel ouvert, permet de mieux comprendre les appareils, leurs limites et leurs souplesses de modification grâce à des composants, des pièces, et des appareils entièrement documentés, gratuits à regarder, étudier, copier, modifier et réutiliser, même pour une utilisation commerciale. 1 De la même façon que l’open-source, le matériel ouvert se veut transparent avec ses utilisateurs. Le libre et l’ouverture ne s’arrêtent pas aux frontières du numérique et de l’informatique. L’Atelier Paysan par exemple, « propose aux agriculteurs des stages de fabrication de leurs machines-outils. Le tout avec des plans open-source et accompagnés, les agriculteurs réalisent leurs machines pour des usages très spécifiques comme l’élevage, l’épandage, les semences, la viticulture, … » 1 (Bosqué 2024) Derechef, ouvrir le matériel permet de donner le pouvoir à son utilisateur d’en faire l’usage le plus adéquat en fonction de sa situation. Encore plus intéressant, de faire évoluer l’objet en même temps que son usage et sa pratique. 
Il y a dix ans, dans le domaine de l’informatique de bureau, la société Méta IT créait l’ordinateur Alt. En avance sur son temps, l'ordinateur Alt incarne une approche radicale de l'informatique durable. Pensé pour les usages bureautiques essentiels, il se distingue par une consommation électrique très basse de 25 watts et une conception minimaliste : seulement quatre pièces en aluminium, cinq composants électroniques, sans ventilateur ni disque mécanique, ce qui le rend totalement silencieux et prolonge sa durée de vie. On remarque que les mêmes problèmes d’obsolescence matérielle ont été observés et ajustés dans cet ordinateur que ceux observés à la Rebooterie, dix ans plus tard : le refroidissement actif. On peut légitimement se demander pourquoi cela n’a-t-il pas évolué ? Alt vise à réduire l'impact environnemental à chaque étape, de la fabrication à la fin de vie, en facilitant le démontage non seulement pour le recyclage, mais surtout pour donner le pouvoir à son utilisateur de s’en emparer. De plus, la solution logicielle comprise dans le pc suivait les mêmes lignes directrices. Cet ordinateur fixe était destiné aux entreprises ou administrations. Les concurrents directs de Méta IT étaient des géants tels que Microsoft, Hp, ou encore Dell. C’est malheureusement en 2017 que leur aventure se conclut, faute de moyens et peut-être de partis pris trop radicaux pour l’époque. Si un projet équivalent aux mêmes convictions se développerait aujourd’hui, nul doute que celui-ci aurait réussi à se créer une place. Beaucoup d’énergie et de temps ont été consacrés par Méta dans le dialogue avec des futurs partenaires pour expliquer basiquement ce qu’était l’écoconception. Chose qu’aujourd’hui tout le monde arrive plus ou moins à se représenter. 1 L’évolution semble toutefois aller dans le bon sens, grâce à des projets précurseurs et avant-gardistes comme celui-ci. Plus récemment, un autre exemple d’open-hardware en informatique, sont les ordinateurs de la société Framework. Il s’agit d’une initiative dans le domaine des ordinateurs notamment portables, visant à offrir aux utilisateurs une expérience plus modulaire, évolutive et durable. Conçus avec un souci de durabilité et de réparabilité, les Framework laptops permettent aux utilisateurs de remplacer et de mettre à niveau facilement des composants tels que la RAM, le stockage, le Wi-Fi et même le clavier. Le Framework vise à réduire l'empreinte écologique de l'industrie technologique tout en offrant aux utilisateurs un contrôle accru sur leur matériel informatique. L’opérabilité et les modifications de la machine se font avec un unique tournevis et avec des tutoriels étapes par étapes du site du constructeur. Toutefois, le prix d’un tel produit reste plus élevé qu’un ordinateur de constructeurs de grandes séries. L’entreprise s’est engagée à ce que toutes les coques de leurs ordinateurs portables en aluminium restent inchangées. C’est-à-dire que le versioning (l’évolution) de leurs ordinateurs se fera sur la base du même châssis (variant bien-sûr en fonction de la taille de la dalle de l’écran). Ainsi l’interopérabilité des pièces de cet ordinateur est simplifiée. Ce produit est certes dans l’idée du libre, mais l’accessibilité financière n’est pas encore assez forte pour démocratiser ce cheminement de pensée au grand public.
Le matériel ouvert donc, « permet de mieux comprendre les appareils, leurs limites et leurs souplesses de modification grâce à des composants, des pièces, et des appareils entièrement documentés, gratuits à regarder, étudier, copier, modifier et réutiliser, même pour une utilisation commerciale. » 1 (Grindle 2023) Cette idée est noble mais hélas n’est pas utilisée aujourd’hui par la majorité des fabricants d’objets, tous domaines confondus. Les fabricants d’objets technologiques tendent vers des appareils ayant leur propre autonomie et aussi leur propre autorité. Conscientiser l’utilisation de nos machines demande alors une dose d’humilité et de considération dans l’approche de la réparation d’appareils que nous n’avons pas fabriqués nous-mêmes. 1 Les fabricants d’ordinateurs tel qu’Apple pour ne citer qu’eux, n’indiquent pas comment réparer la machine. Ils invitent à contacter leur service après-vente. Pas de notice livrée avec l’ordinateur portable. Les modes d’emploi participent à l’ouverture des appareils, ce n’est pas un hasard si les constructeurs ne fournissent pas ces papiers. Ils mettent à disposition une notice d’utilisation d’usage de la machine, mais pas de remplacement de pièce. Les modes d’emploi n’existent pas, à l’exception des jouets scientifiques, avant les années 1860. 1 C’est à partir du XXe siècle que les fabricants vendent leurs produits directement au domicile du consommateur. De ce fait, l’intervenant réalisait une démonstration de l’utilisation de l’objet. Ainsi, les futurs acquéreurs dudit objet étaient en mesure à la fois de s’en servir, mais aussi de comprendre son fonctionnement en cas de panne. Ce sont pendant les mêmes années, « avec le développement massif de la vente par correspondance, [que] les appareils envoyés par colis postal s’accompagnent d'imprimés qui décrivent leur fonctionnement. » 1 (Bartholeyns et Charpy 2021) Les premiers modes d’emploi sont alors, à la manière des intervenants, « des textes interminables qui décrivent chacun des gestes que doit effectuer l’utilisateur et qui listent les pannes et obstacles possibles » 1 (Bartholeyns et Charpy 2021) L’appareil est perçu comme une innovation dans le train de vie quotidien des ménages et devient par conséquent un objet précieux, que l’on conserve longtemps.
Les modes d’emploi et manuels d’instruction sont incontournables depuis les années 1930 1 et aident à la compréhension de nos objets. Cependant, il en va du bon vouloir des fabricants de les mettre à disposition. Le permacomputing s’inspire de ces visions ouvertes du partage pour répandre l’accessibilité à la réparation du matériel informatique et de son utilisation, en marge des géants qui contrôlent et influencent leurs usagers de par leurs politiques marketing. Toutefois, tout n’est pas aussi manichéen. L’ergonomie est indispensable et est gage d’efficacité. De plus, un objet esthétiquement plaisant donnera l’envie à son propriétaire d’en prendre soin pour ne pas l’abîmer. Les constructeurs comme Dell par exemple tendent à ouvrir les ordinateurs portables, aux vues des impératifs climatiques. Nous ne parlons pas encore d’interopérabilité, ou bien encore de rétrocompatibilité, uniquement de simplicité d’ouverture; ce qui est déjà un bon premier pas. L’ouverture arrive certes, mais la miniaturisation des composants ne cesse pas. Avec la miniaturisation, vient l’irréparabilité. Pourquoi est-ce un problème ? Comment le permacomputing compte-il solutionner cette complication ? Avec des systèmes informatiques robustes, simples et sobres.
- 50 - Grindle, Mike. 2023. « Permacomputing: Tackling the Problem of Technological Waste ». The New Climate. (blog). 31 juillet 2023. https://medium.com/the-new-climate/permacomputing-tackling-the-problem-of-technological-waste-4cc7a4437ad6
- 51 - Masure, Anthony. 2017. Design et humanités numériques. Édition B42. Esthétique des données. p. 90.
- 52 - Discussion avec Émilie Gaches lors de l’atelier « rebooste ton PC ».
- 53 - Moles, Abraham. 1987. Vivre avec les choses : contre une culture immatérielle. Vol. 7. Art Press, hors-série. p. 12
- 54 - « Ikea ». 2024. In Wikipédia. https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Ikea&oldid=214042456.
- 55 - « Notre histoire ». s. d. Consulté le 28 avril 2024. https://www.ikea.com/be/fr/this-is-ikea/about-us/notre-heritage-pubad29a981.
- 56 - Émilie Gaches, réal. 2024. Échange mémoire Émilie Gaches. https://www.youtube.com/watch?v=9QK0JmWqnAM. (24:30) Entretien avec Émilie Gaches sur nos recherches autour de l’informatique hardware et software.
- 57 - Crawford, Matthew B. 2009. Éloge du carburateur essai sur le sens et la valeur du travail. La Découverte. p.78
- 58 - Jarrige, François. 2016. Technocritiques: du refus des machines à la contestation des technosciences. La Découverte-poche. Paris: la Découverte. Chapitre 11, p. 289.
- 59 - Cf. 1. Entretien avec la Rebooterie en annexes.
- 60 - « Framework Laptop ». s. d. Framework. Consulté le 7 novembre 2023. https://frame.work/fr/fr.
- 61 - Bartholeyns, Gil, et Manuel Charpy. 2021. L’étrange et folle aventure du grille-pain, de la machine à coudre et des gens qui s’en servent. Carnets Parallèles. Premier Parallèle. p. 34
- 62 - Ibid.
- 63 - Oroza, Ernesto. 2009. Rikimbili. Publications de l’Université de Saint-Étienne. Cité du Design. p. 22
- 64 - Jarrige, François. 2016. Technocritiques: du refus des machines à la contestation des technosciences. La Découverte-poche. Paris: la Découverte. Chapitre 12, p. 317.
- 65 - Grindle, Mike. 2023. « What Is Open-Source Hardware and Why Does It Matter? » ILLUMINATION (blog). 29 mai 2023. https://medium.com/illumination/what-is-open-source-hardware-and-why-does-it-matter-b3e95f36fb84.
- 66 - Bosqué, Camille. 2024. Design pour un monde fini. Carnets Parallèles. Premier Parallèle. p. 105
- 67 - Cf. Entretien avec Brice Genre, cofondateur de Méta It, directeur artistique et de conception pour l’ordinateur Alt et le serveur Ctrl. Brice Genre retrace le parcours de la société Méta It, de l’ordinateur Alt et du serveur Ctrl.
- 68 - Grindle, Mike. 2023. « What Is Open-Source Hardware and Why Does It Matter? » ILLUMINATION (blog). 29 mai 2023. https://medium.com/illumination/what-is-open-source-hardware-and-why-does-it-matter-b3e95f36fb84.
- 69 - Crawford, Matthew B. 2009. Éloge du carburateur essai sur le sens et la valeur du travail. La Découverte. p.118
- 70 - Bartholeyns, Gil, et Manuel Charpy. 2021. L’étrange et folle aventure du grille-pain, de la machine à coudre et des gens qui s’en servent. Carnets Parallèles. Premier Parallèle. p. 31
- 71 - Ibid.
- 72 - Ibid. p. 31-32
- 73 - Ibid. p. 32
2. Une simplicité efficace et capable pour nos appareils
Simple dans la conception, mais simple aussi dans l’utilisation matérielle et logicielle. Ce précepte est repris d’un des points de Viznut : rester simple et petit. Pourquoi Viznut souhaite que le permacomputing reste « petit » ? Tout simplement parce que la taille induit la consommation. La taille n’est pas nécessairement liée à la grandeur d’un objet ou à la place qu’il prend dans l’espace, mais aussi à son utilisation. Nous parlons donc ici de petites et de faibles consommations d’énergie lors d’une utilisation d’ordinateur, mais aussi et surtout lors de sa fabrication. La fabrication d’un ordinateur portable requiert énormément de pièces différentes, composées elles-mêmes de matériaux différents. Ainsi, les constructeurs ont voulu cacher ces pièces sous une coque. à la manière d’un capot de voiture que l’on ouvre pour inspecter un moteur, on ouvre le capot, ou la coque de l’ordinateur portable pour pouvoir accéder à ses composants. « La Bugatti dissimule quantité de ses pièces constitutives et présente presque une « image » en deux dimensions, tandis que la Buick étale autant d’accessoires que possible, en une ruche composition tridimensionnelle, qui s’oppose, par un langage puissant et sauvage, à l’esthétique sophistiquée de la Bugatti. » 1 (Banham 2013) Il existe deux écoles de constructeurs pour les ordinateurs portables : Apple et les autres. Les macbooks d’Apple sont élégants et fins à l’extérieur, mais autant à l’intérieur. Les autres constructeurs sont dans la même mesure pour l’extérieur, mais loin du compte pour l’intérieur. L’intérieur d’un Mac est impeccablement optimisé, à un point où de l’espace vide est présent sous la coque. Les autres constructeurs, en revanche, utilisent toutes la place sous la coque et étalent les composants. « Sa forme ne découle pas de l’encombrement ou des contours de ces éléments disparates, puisqu’elle a pour seule raison d’être, de jeter un voile, de cacher et de maintenir hors de vue les entrailles de la machine et de permettre un meilleur usage et une meilleure « ergonomie » dans la manipulation de ses indices extérieurs de fonctionnement. » 1 (Moles 1987) En effet, les ordinateurs sont des éléments fragiles qui ont besoin de protections. La peau de plastique ou d’aluminium qui recouvre les composants ont un rôle protecteur mais aussi esthétique et ergonomique. C’est lorsque l’on décide d’ouvrir un ordinateur que l’on se rend compte du nombre de petites pièces, au-delà des composants, qui le composent : vis, adhésif, colle, câbles, fiches, prises, tous ses organes, les soudures et micro soudures, … Ces petites pièces sont d’abord présentes pour préserver l’intégrité de l’ensemble des composants dans leur coque protectrice. Cependant, pour des raisons économiques de fabrication, ces modes d'assemblage peuvent entraver la réparation de l’appareil, voire même sa simple ouverture. L’intégrité de l’ensemble devient alors bien trop préservée, pour les raisons économiques de l’entreprise, au-delà de la fabrication évidemment.
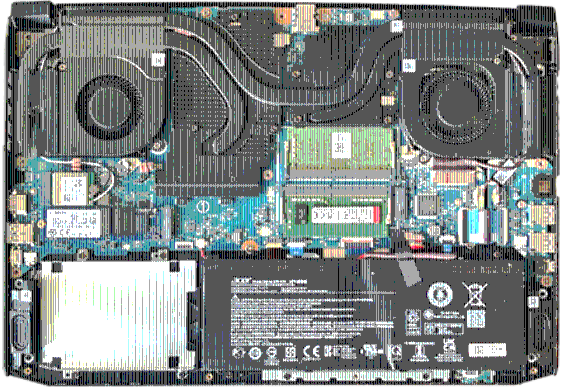
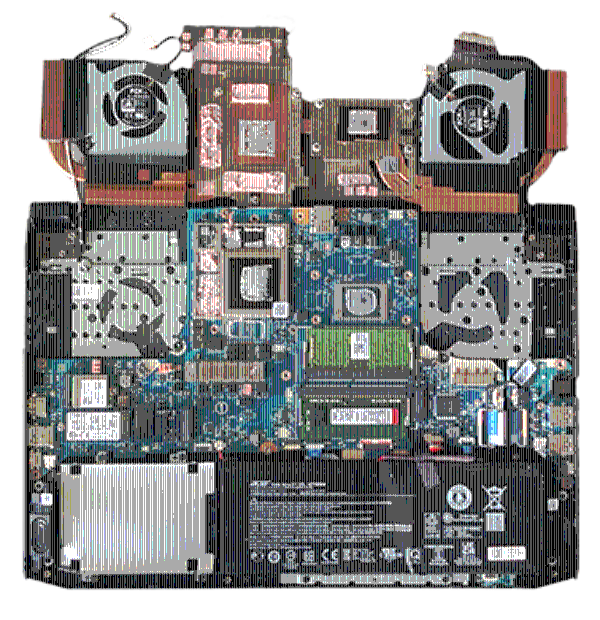
C’est « avec l’introduction de l’équipement électrique, [que] les réalités de base de la physique opèrent à une échelle tellement différente qu’elles échappent à l’expérience immédiate de l’usager. » 1 (Crawford 2009) Le permacomputing lutte contre la miniaturisation des composants informatiques pour cette raison exacte. Les usagers n’ont plus le contrôle sur les micro-puces, et par extension leur machines. Quel contrôle devraient-ils avoir sur leur machine ? Les puces et micro-puces ne sont pas forcément intéressantes à contrôler pour le commun des usagers. Leur souhait est d’utiliser une machine qui fonctionne, sans se soucier de devoir entrer une ou plusieurs lignes de codes dans un terminal pour opérer des actions, pour ce qui est de la partie logicielle. Le matériel se miniaturisant avec le temps, les utilisateurs ne sont plus amenés à pouvoir faire évoluer leurs machines. De ce fait, les machines se mystifient et, nous ne conscientisons plus notre utilisation de la machine. Laisser le pouvoir de l’objet à l’utilisateur, dans ce cas de l’évolutivité, de la réparabilité, de la création d’une longévité, revient à simplifier et non plus à complexifier et miniaturiser nos pièces d’ordinateurs.
L’idée alors pour le permacomputing est de rester simple, pour anticiper un effondrement. L’effondrement de notre société actuelle devient la ligne de mire, mais que nous ne devons pas atteindre. Le bedrock computing, littéralement l’informatique de base, ne veut utiliser que le strict minimum pour faire fonctionner un ordinateur, à l’image des cartes tel que le Raspberry PI, qui est un micro ordinateur.
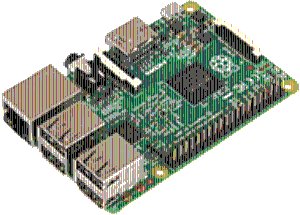
Cela a pour conséquence d’oublier entre autres la souris et de tout faire grâce à un terminal de commande et un clavier. Le mot « bedrock » est fort de sens puisqu’en géologie ce terme désigne la croûte terrestre, c’est-à-dire la base solide sur laquelle se déplace la vie sur Terre. On retrouve également ce terme dans le jeu Minecraft, développé d’abord par Markus Persson, alias Notch, puis par Mojang Studios, sous la forme d’un minerai indestructible qui limite la profondeur de la carte, afin d’empêcher le joueur d’aller plus bas (telle la croûte terrestre sur laquelle le joueur évolu). Si d’aventure le joueur s’y risque en trichant, il tombera dans un vide infini. Les idées derrière l’ordinateur de base sont d'une part de lutter contre la miniaturisation des composants, et d’autre part d’avoir un ordinateur indestructible, qui sont deux notions liées. Vous ne ferez par conséquent pas la même chose qu’avec un ordinateur contemporain, ceci limitera notre utilisation au minimum et réduira la consommation énergétique de l’appareil. Ces systèmes le plus simple possible, à la fois matériellement et logiciellement, devrons aussi supporter une alimentation électrique soutenable manuellement en cas d’effondrement. 1 Le principe, qui est de considérer l’effondrement comme finalité potentielle, mais non pas comme inévitable, ajoute une dimension heureuse au permacomputing. Là où aujourd’hui nous sommes inondés de chiffres et d’alertes sur le changement climatique, Viznut dans son écrit de 2021 1 prend à revers ces exclamations. Le bedrock computing est un exemple parmi d’autres qui répondrait à l’effondrement. Il est aussi, avant la réponse, un suppléant concret à ces chiffres alarmants. « Il nous reste environ trente ans de numérique devant nous, selon le cabinet Green IT. Or même dans les milieux technocritiques, on s’inquiète – à juste titre – de l’essor du numérique mais très peu de sa fin programmée. C’est pourtant un risque majeur, et nous ne sommes pas du tout prêts. Nos imaginaires futuristes reposent toujours sur une extension sans fin de la robotique, d’exosquelettes et d’intelligence artificielle. On devrait se poser sérieusement la question de ce qui va se passer quand les écrans s’éteindront et commencer à anticiper le monde d’après le numérique. » 1 
Le permacomputing veut nous faire réfléchir sur notre utilisation de l’informatique, au point de se demander s’il est nécessaire, en tant que tel. Les machines d’aujourd’hui se veulent simples et intuitives alors qu’elles n’ont jamais été aussi complexes. Cette couche de simplicité masque en fait la complexité d’un système. On parle ici de noyau intouchable de l’ordinateur, le noyau kernel. Ce sont ces noyaux, le cœur véritable, qui sont à la base de tout sur l’ordinateur, avant même le BIOS ou l’UEFI. Le BIOS et l’UEFI sont les premières couches avec lesquelles l'utilisateur est amené à interagir, s’il le souhaite. Ce sont des couches de sécurité et de paramétrage au démarrage d’un ordinateur. Elles n'existent que par principes de sécurité et ne sont pas un passage obligatoire. C’est donc bel et bien ces noyaux primordiaux qui disposent des informations premières, les plus indispensables pour le bon fonctionnement d’un ordinateur. Pour l’ergonomie de l’utilisateur et son confort, les ingénieurs et les designers ont lissé les interfaces avec des couches logicielles qui s’exécutent en fond de processus. Viznut propose une bulle de simplicité pour interférer avec toutes ces couches, en s’aidant de machines virtuelles. Les machines virtuelles permettent de transitionner vers un usage de l’informatique raisonné, et allant de paire avec une faible consommation énergétique. Elles sont indépendantes, se suffisent à elles-même et peuvent être installées sur toutes les machines. Il s’agit en fait de logiciels qui simulent une nouvelle interface sur l’ordinateur. Cette interface cependant, est volontairement contrainte. Ces bulles sont donc exécutables sur une machine, de la même manière que si vous lanciez votre navigateur internet. Cette machine virtuelle, comme son nom l’indique, est comme un nouvel ordinateur éphémère sur votre machine, comme un autre système d’exploitation (Windows, MacOS, Linux, Ubuntu, …). La machine virtuelle a des contraintes prédéfinies que l’utilisateur peut modifier à sa guise pour se limiter soi-même lors de son utilisation de son ordinateur, et donc limiter leur consommation d’énergie afin d’éviter d’en avoir toujours plus besoin. 1 Cette nouvelle interface, cette nouvelle couche s’ajoute par dessus les autres, comme pour écraser les précédentes. Celles-ci d’ailleurs constituent l’interface globale de l’ordinateur. Or, « l'interface, pour sa part, est censée être « intuitive », ce qui signifie qu’elle prétend garantir le minimum de friction psychique entre l’intention de l’usager et sa réalisation. Or, c’est justement ce type de résistance qui aiguise la conscience de la réalité en tant que facteur indépendant. » 1 (Crawford 2009) Les contraintes générées par la machine virtuelle sont alors non plus perçues comme contraignantes, mais comme éléments positifs pour un principe de création. 1
La croissance énergétique du monde augmente d’environ 2 % par an. Dans 37 ans, nous aurons doublé notre production actuelle. Dans 100 ans ce sera sept fois notre consommation. Dans 1000 ans, 400 000 000 fois (quatre cents millions). Dans 1600 ans nous consommerons l’équivalent d’un soleil en énergie. De plus, il reste entre 300 et 400 ans de consommation d’énergie sur la planète. 1 Jean-Marc Jancovici distingue trois catégories d’économie d’énergie. D’abord l’efficacité, c’est-à-dire prendre par exemple une voiture qui garde sa même masse et qui roule à la même vitesse, mais qui consomme moins d’énergie à l’usage et à la fabrication. Cette problématique est du côté des ingénieurs et non pas du consommateur, qui n’est pas contraint dans son utilisation de la voiture pour la rendre plus efficace. Ensuite la sobriété. Elle est une démarche volontaire de renoncement à un service, pour diminuer sa consommation d’énergie afférente. Deuxième exemple : le vélo et ses contraintes. La pluie, le vent, la température, les protections, moins vite, moins loin, … Et enfin la pauvreté, qui est exactement comme la sobriété mais que l’on ne choisit pas par faute de moyen. 1 Le permacomputing est donc une démarche de sobriété décidée aujourd’hui, en attendant que la simplicité et l’efficacité arrivent demain. Les termes « efficacité » et « rendement » sont souvent utilisés de manière interchangeable, mais ils peuvent avoir des nuances spécifiques selon le contexte. L’efficacité se concentre sur la réalisation des objectifs, tandis que le rendement est plus axé sur la maximisation de la production ou de la sortie par rapport aux ressources investies. Pour le permacomputing, le rendement semble plus juste : comment utiliser au maximum toutes les ressources disponibles d’un appareil pour un rendement énergétique optimal, relatif à notre utilisation. Le collectif Designers Éthiques est une organisation française regroupant des designers, chercheurs et professionnels du numérique engagés pour promouvoir une conception responsable et éthique des technologies. Ces personnes ont des pratiques de design qui respectent les utilisateurs, leurs données et l'environnement. Ils questionnent les dérives actuelles du numérique, comme l'obsolescence logicielle, les interfaces addictives ou la surconsommation énergétique. Les Designers Éthiques sont en quelque sorte pour la partie logicielle d’un ordinateur, ce qu’est le bedrock computing pour la partie matérielle. Le collectif propose des outils et des méthodes de design centrés sur l’écoresponsabilité, et milite pour un internet plus éthique et soutenable. Le travail de l’association est indispensable pour la sensibilisation du grand public à ces questions. Toutefois, il est nécessaire de rappeler que ces sites internet par exemple, si peu « lourds » dans leur conception et leurs usages, sont utilisés sur du matériel récent. De surcroît, les logiciels que nous utilisons pour consulter ces sites ne sont pas forcément respectueux de nos données personnelles. Dans ce cas, selon Aymeric Manssour, la low tech « revient à avoir un SUV pour rouler à 10 km/h. » 1 L’exemple du site web du Low Tech Magazine, utilise la puissance du soleil au-dessus de Barcelone. Par mauvais temps prolongé, le site web sera inaccessible, jusqu’à ce que les batteries du serveur se rechargent. La démarche est poussée un cran plus loin en intégrant ici un hébergement soutenable. La solution de cet hébergement est viable, pérenne et suffisante.
Le permacomputing s’enracine au côté de ces projets, ces idées, ces mouvements. La partie matérielle permet d'interagir avec la machine qu' elle compose. De l’autre côté, pour communiquer avec le matériel, une couche logiciel ou une interface est obligatoire, au regard des contraintes matérielles. Ce mélange est complexe, mais les parties logicielles et matérielles sont bien dépendantes les unes des autres. Comment alors optimiser les deux tenants et cultiver un rendement qui sied à nos usages, grâce au postulat d’un effondrement ?
- 74 - Banham,Reyner. 2013. Design l’Anthologie. Cité du Design. p. 189
- 75 - Moles, Abraham. 1987. Vivre avec les choses : contre une culture immatérielle. Vol. 7. Art Press, hors-série. p. 12
- 76 - Crawford, Matthew B. 2009. Éloge du carburateur essai sur le sens et la valeur du travail. La Découverte. p. 74
- 77 - Heikkilä « Viznut », Ville-Mathias. 2021. « Permacomputing Update 2021 ». 2021. http://viznut.fi/texts-en/permacomputing_update_2021.html.
- 78 - Ibid.
- 79 - « Il nous reste environ trente ans de numérique devant nous ». s. d. Consulté le 1 décembre 2024. https://usbeketrica.com/fr/article/il-nous-reste-environ-trente-ans-de-numerique-devant-nous.
- 80 - Heikkilä « Viznut », Ville-Mathias. 2021. « Permacomputing Update 2021 ». 2021. http://viznut.fi/texts-en/permacomputing_update_2021.html.
- 81 - Crawford, Matthew B. 2009. Éloge du carburateur essai sur le sens et la valeur du travail. La Découverte. p. 74
- 82 - « Permacomputing » : la discrète communauté qui défend des outils numériques libres, sobres et décroissants ». 2024, 13 mai 2024. https://www.lemonde.fr/pixels/article/ 2024/05/13/permacomputing-la-discrete-communaute-qui-experimente-un-numerique-sobre-et-decroissant_6232934_4408996.html.
- 83 - Thinkerview, réal. 2019. Philippe Bihouix : Prophète de l’apocalypse ? [EN DIRECT]. https://www.youtube.com/watch?v=Oq84s9BLn14.
- 84 - Coface France, réal. 2023. Interview de Jean-Marc Jancovici, associé fondateur, Carbone4 lors du colloque Risque Pays de Coface. https://www.youtube.com/watch?v=wupnTUk63RQ.
- 85 - « Permacomputing » : la discrète communauté qui défend des outils numériques libres, sobres et décroissants ». 2024, 13 mai 2024. https://www.lemonde.fr/pixels/article/ 2024/05/13/permacomputing-la-discrete-communaute-qui-experimente-un-numerique-sobre-et-decroissant_6232934_4408996.html.
3. L’effondrement, une dystopie ou une utopie ?
L’effondrement est l’idée que notre société décline de manière irréversible. Ainsi, les structures sociales, l’écologie, l’économie et tous les champs qui y sont interconnectés, dans leurs formes que nous connaissons, disparaissent. Ce scénario apocalyptique conduit donc l’humanité, et par extension toutes les formes de vie de planètes, à des pénuries graves, des migrations et des conflits d’intérêts. Le permacomputing choisit d’utiliser le scénario de l’effondrement comme postulat principal de son engagement. Ce scénario est donc une dystopie, au service de l’utopie tangible que cherche à faire exister le permacomputing.
« Utopie » et « dystopie » sont deux termes que nous rencontrons fréquemment dans notre langage actuel, dû aux changements climatiques grondants, qui influencent nos œuvres culturelles contemporaines. La dystopie semble d’ailleurs prendre une plus grande place que son pendant. En réalité, la première trace d’une utopie serait bien plus ancienne mais ne serait pas nommée en tant que telle, et remonterait à -360 avant J-C. Il s’agit de la Cité de L'Atlantide, relatée par le philosophe Platon. La cité fut dotée d’une organisation sociale avancée, de constructions gigantesques ou encore d’une enceinte impressionnante faite d’or et d’argent, témoignant du savoir-faire exceptionnel de ses habitants. Les Atlantes vouent un culte fort aux divinités et sont en harmonie avec leurs lois. Cependant, l’avidité des habitants ne faisait que grandir, au point où les Atlantes cherchent à dominer le monde. Les dieux les punissent alors en provoquant des catastrophes naturelles, qui engloutirent la cité en une nuit. Cette notion d’hybris indique que les humains ne sont pas restés à leur place de mortels, et ont tenté de chambouler l’ordre. Ils sont punis pour cette démesure. Ce récit représente à la fois l’apogée de l’humanité et sa décadence. La première partie du récit relate ce que pourrait être une forme d’utopie. Un endroit, dans lequel une organisation sociale est juste, tout en permettant un développement et une harmonie conjointe entre toutes les créatures de cette localité. L'utopie a été concrètement dépeinte par Thomas More en 1516 dans son ouvrage L’Utopie. Il y théorise sa pensée humaniste, qui considère une organisation politique égalitaire. La propriété privée est abolie et remplacée par une politique des biens communs, le gouvernement y est décentralisé, les lois sont peu nombreuses favorisant l’ordre autonome et la compréhension, l’éducation et la vertu morale sont des piliers de cette société. Le mot « utopie » lui est issu du grec, où « topos » signifie l’endroit, le lieu, la région ; et où le « u » (prononcé ou) est une négation. « Ou-topos » donc, est le « non-lieu », le lieu qui n’est nul part, qui n’existe pas, mais un lieu heureux. 1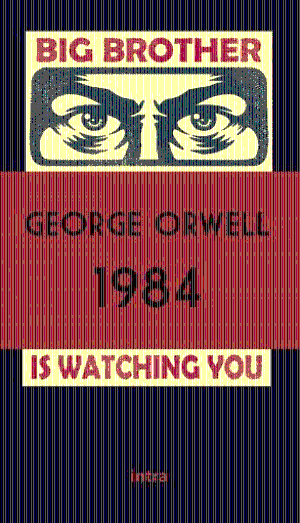
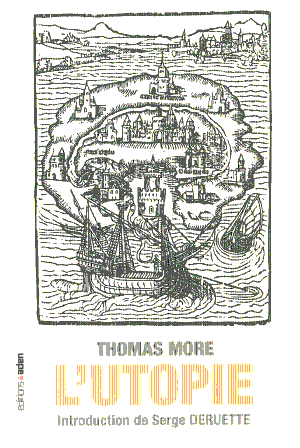
La définition de ce mot n’a guère changé encore aujourd’hui, 500 ans plus tard. D’après le dictionnaire en ligne Larousse, l'utopie est la « construction imaginaire et rigoureuse d’une société, qui constitue, par rapport à celui qui la réalise, un idéal ou un contre-idéal.» 1 Comme l’Atlantide, l’utopie peut virer à son exact contraire, la dystopie. Du même grec « topos » pour le lieu, le préfixe « dus » cependant, implique une idée de malheur et de difficulté. Ainsi, une dystopie est un lieu de malheur où les inégalités extrêmes, l’oppression totalitaire et les injustices règnent. Les catastrophes écologiques sont désastreuses, les dérives technologiques décadentes sont omniprésentes et la perte de liberté sont tous des conséquences de l’avidité humaine. La dystopie a été décrite et popularisée récemment, au XXe siècle, après les horreurs de la 2me guerre mondiale. On peut citer deux ouvrages qui résonnent encore aujourd’hui dans l’imaginaire collectif : 1984 de George Orwell écrit en 1949, et Neuromancer de William Gibson écrit en 1984. Les deux ouvrages explorent un futur dystopique. Dans le livre 1984, Orwell utilise un parti totalitaire, « Big Brother », pour exercer un contrôle total sur la population. La surveillance est donc omniprésente, mais aussi la manipulation, et la répression de la pensée individuelle. William Gibson pousse encore plus loin ce futur dystopique, en popularisant le genre du cyberpunk.
L’ouvrage de William Gibson dépeint parfaitement ce genre de dystopie où la technologie, les méga-sociétés, et les inégalités extrêmes sont souveraines. Depuis, d’autres œuvres sur des médias contemporains comme les jeux vidéos permettent de se plonger de son plein gré dans ces univers. Le jeu vidéo Cyberpunk 2077 développé par CD Projekt Red est paru en 2020. Le jeu se déroule dans l’univers dystopique du Neuromancer de Gibson (le père du cyberpunk).
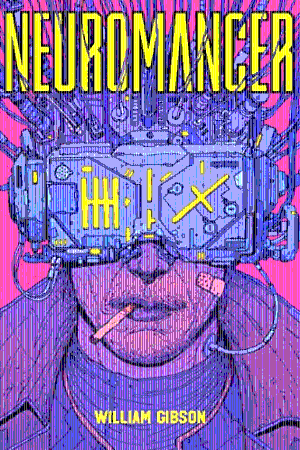

Ces références populaires inspirent l’imaginaire collectif mais aussi les designers, qui maintiennent l’habitabilité de notre monde. William Morris écrit par exemple en 1890 News from Nowhere, un roman utopique qui imagine une Angleterre égalitaire, communautaire et écologique, suite à une révolution. L'œuvre critique avant tout le capitalisme et l’industrialisation, en pensant un système basé sur l’entraide, l’harmonie avec la nature et l’artisanat. Les valeurs du travail des habitants ne sont plus des contraintes, mais un acte créatif réjouissant, heureux. Plus tard, dans les années 1960, les designers italiens radicaux engagent « une posture très politique en investissant l’anticipation, la fiction et l’imaginaire pour produire des formes et des propositions manifestes, affranchies de toute préoccupation commerciale ». 1 (« Biennale Internationale Design Saint-Étienne 2019 | En ce moment », s. d.) 
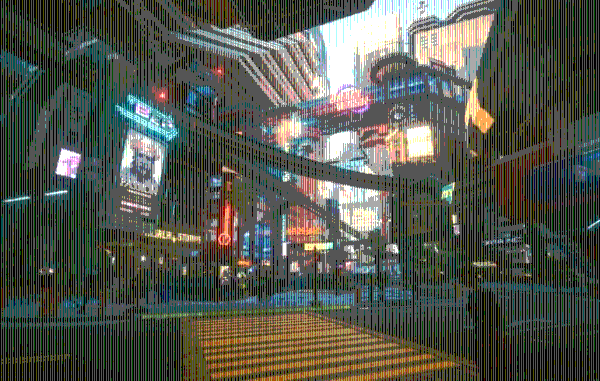
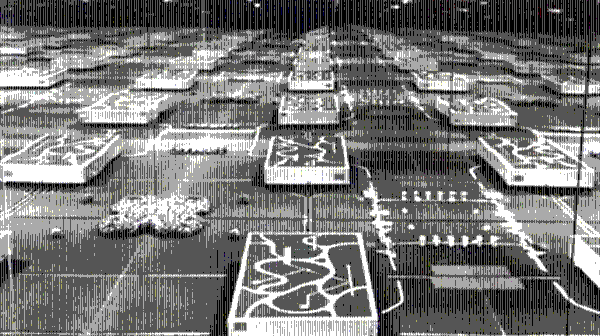
Le permacomputing prépare donc au pire et utilise l’effondrement comme scénario principal de sa pensée. Comme les designers radicaux italiens, il s’agit alors de repenser les objets en les critiquant, pour les plus résilients possibles dès aujourd’hui. On parle au sens large de « collapse informatics » (informatique de l’effondrement) de Bill Tomlinson, mais surtout de « collapse resistance » (résistance à l’effondrement) et de « collapse computing » (ordinateur d’effondrement). 1 Ces notions sont comme précédemment énoncées basées sur l’open-source hardware (OSHW). De ce fait, la documentation ouverte et les systèmes simples et moins dépendants, rendent le matériel résistant à l’effondrement car facile de maintenance et de réparation. Le mot « effondrement » est fort et transmet immédiatement un imaginaire dystopique. Or, à l’inverse du cyberpunk, cette dystopie dont William Gibson est le père avec son ouvrage Neuromancien (1984) et où la société high-tech est inégalitaire à l’extrême, le permacomputing s’inspire du solarpunk et se veut optimiste quant au changement climatique ainsi qu’aux inégalités sociales. L’effondrement est alors une manière engageante de parler de longévité. Viznut affirme qu’il faut étendre la durée de vie des technologies et réduire les dépendances superflues vis-à-vis de celles-ci. C’est selon lui une piste solide dans tous les cas, d’un effondrement, ou non.1

Toutefois, il est facile et important de s’en rendre compte, mais « bien que l'esthétique du permacomputing puisse sembler s'inspirer des pratiques de conception émergentes des besoins environnementaux directs du Sud, il est essentiel de reconnaître la situation réelle de cette communauté de pensée et de pratique. Elle se situe dans le contexte privilégié des pays à hauts revenus, où l'option d'un mode de vie alternatif et la capacité de travail volontaire sont possibles. » 1 (fabbula, s. d.) L’effondrement est de facto un contexte dans lequel le permacomputing s'inscrit. Il n’est pas uniquement question de matériel, de ressources et d’énergies, mais aussi d’humains. Nous sommes finalement déjà dans une situation globale où, comme pour le genre cyberpunk, des grosses sociétés nous influencent et créent de l’inégalité. L’idée de l’échelle est importante dans l’effondrement. Dans des fictions tels que The Walking Dead,1 où l’effondrement du monde est arrivé, des groupes de personnes se forment. L’effondrement est toujours une vision dystopique où des communautés doivent survivre pour exister contre l’environnement hostile et contre les autres groupes, dans un esprit de rivalité. Le permacomputing ne se veut pas dystopique, mais utopique. Le permacomputing contre de cette manière le high-tech, les exubérantes inégalités sociales et le profit maximal des méga-sociétés en s’inspirant du solarpunk. C’est ainsi qu’un circuit court et que le partage de connaissance sont de mise. L’informatique doit être locale et à l’échelle de nos besoins. Comment, par exemple, dans le cadre d’un effondrement, serait-il possible de maintenir un même parc technologique informatique pendant plusieurs générations ? La question est judicieuse et est nécessaire à se poser pour la simple raison que notre société actuelle est plus que jamais dépendante de l'informatique et des NTIC. Certaines pièces seront inévitablement usées par le temps et ne pourront plus être réparées et remplacées à cause des ressources planétaires manquantes, du besoin énergétique pour les produire ou les utiliser, ou simplement de par l’évaporation du savoir-faire de conception et de fabrication.
Les low-techs, ou technologies simples, sont des solutions techniques souvent inspirées par des pratiques traditionnelles et axées sur la durabilité et la résilience. Elles se caractérisent par leur simplicité, leur faible coût et leur utilisation minimale de ressources, visant à répondre aux besoins humains de manière efficace tout en réduisant l'impact sur l'environnement. Les low-techs englobent une gamme diversifiée de principes, allant des techniques agricoles traditionnelles à l'habitat écologique, en passant par les technologies de l'information et de la communication adaptées aux contextes locaux. Elles sont souvent promues comme des alternatives durables aux technologies hautement industrialisées (high-tech), mettant l'accent sur l'autonomie, la résilience communautaire et la réduction des inégalités. Les principes du permacomputing recoupent finalement « les 7 commandements des low tech » (Bihouix 2021) 1 :
- Remettre en cause les besoins
- Concevoir et produire réellement durable
- Orienter le savoir vers l’économie de ressources
- Recherche l’équilibre entre performance et convivialité
- Relocaliser sans perdre les bons effets d’échelle
- Démachiniser les services
- Savoir rester modeste
Tous ces points recoupent les traits principaux des utopies que nous avons analysées. Ceux-ci nous amènent à être raisonnable et critique envers toutes situations. La différence cependant entre ces points et le permacomputing, se trouve dans la technologie. « Démachiniser les services » convient au mouvement lancé par Viznut, mais est une finesse qu’il convient d’éclairer. En effet, notre société est régie par la technologie comme nous l’avons déjà observé. Dans son scénario, le permacomputing fait le pari que cette technologie sera toujours présente dans un futur, sous une forme amoindrie en tout point, sauf celui du rendement. Le fait de démachiniser les services, donc de remplacer les machines par l’humain, revient à faire quelques pas en arrière vis-à-vis de notre développement technologique. Pourquoi vouloir ce retour en arrière ? Sûrement à cause de l’augmentation de la consommation d’énergie lors de la fabrication et de l’usage de nos technologies, les inégalités économiques, géographiques et sociales qui accélèrent les changements climatiques, et donc l’habitabilité de notre monde. Aussi, remplacer les machines par des humains, en plus de la décentralisation, fera à nouveau de l’Homme le noyau central de toutes interactions. Le permacomputing aime sa technologie, et ne veut pas l’abandonner. Les valeurs humaines sont toutes aussi importantes à son égard, mais ne se soustraient pas à l’informatique, elles s’additionnent. Elles s’additionnent comme une extension d’une informatique idéale conçue pour et par soit. Ainsi, aucune ambiguïté de couches cachées ou de subordination n’est à déceler. La clé du permacomputing est bien là de faire l'informatique nôtre, dans un premier temps, ce qui sous-entend de le comprendre et de l’intégrer pleinement dans nos modes de vie, pour remettre ensuite en cause nos besoins envers celui-ci. Une réelle harmonie humain-technologie est projetée. À la manière de la permaculture où les plantes sont respectées par leurs cultivateurs, les deux parties sont en harmonie. Il y a cependant bien un sens, c’est l’humain qui est en harmonie avec ses plantations et non l’inverse, puisqu’il s’agit de ce premier qui décide de la disposition de son terrain, des plantes choisies, ou encore à la manière de les entretenir. De ce fait, l’informatique doit elle aussi être pensée de la sorte. Un potager entretenable qui répond à des besoins propres à chacun. Cette harmonie peut opérer à différents niveaux.
- Le premier serait l’harmonie homme-machine propre à son utilisateur, pendant son utilisation logicielle et matérielle, autant d’un ordinateur que son téléphone ou que de sa télévision.
- Le suivant pourrait être l’harmonie homme-machine au niveau local, où des communautés existent s’entraidant à maintenir le parc informatique des terminaux utilisateurs actuels.
- Le troisième serait l’harmonie homme-machine global, c’est-à-dire qu’elle comprend en plus des terminaux utilisateurs, les infrastructures de réseaux et nos équipements numériques.
De ce fait, si un effondrement a bel et bien lieu dans un temps plus ou moins lointain, des personnes se seront au moins penchées sur le sujet et auront potentiellement trouvé des solutions. Si des solutions arrivent avant l’effondrement, alors nous l'aurons évité. Peut-être alors vivrons-nous dans une utopie, sans en être conscient ?
- 86 - « L’Utopie ». 2024. In Wikipédia. https://fr.wikipedia.org/w/index.php?titl %e=L %27Utopie&oldid=214382833.
- 87 - Larousse, Éditions. s. d. « Définitions : utopie - Dictionnaire de français Larousse ». Consulté le 14 avril 2024. https://www.larousse.fr/dictionnaires/ francais/utopie/80825.
- 88 - Cf. Chapitre I. 3. Les idées du permacomputing à l’ère du Chthulucène
- 89 - « Detroit: Become Human ». 2024. In Wikipédia. https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Detroit:_Become_Human&oldid= 213793806.
- 90 - « Biennale Internationale Design Saint-Étienne 2019 | En ce moment ». s. d. Consulté le 14 novembre 2024. https://biennale-design.com/saint-etienne/2019/fr/home/?article=le-designer-chercheur-1670.
- 91 - Bosqué, Camille. 2024. Design pour un monde fini. Carnets Parallèles. Premier Parallèle. p. 14-15
- 92 - Cf. Chapitre I. 1. La confrontation du design avec les limites planétaires et la décroissance.
- 93 - Grindle, Mike. 2023. « Permacomputing: Tackling the Problem of Technological Waste ». The New Climate. (blog). 31 juillet 2023. https://medium.com/the-new-climate/permacomputing-tackling-the-problem-of-technological-waste-4cc7a4437ad6.
- 94 - Heikkilä « Viznut », Ville-Mathias. 2021. « Permacomputing Update 2021 ». 2021. http://viznut.fi/texts-en/permacomputing_update_2021.html.
- 95 - fabbula. s. d. « What is permacomputing? » Notion. Consulté le 19 février 2024. https://www.notion.so.
- 96 - Darabont, Frank, réal. 2010-2022. The Walking Dead. Horreur dramatique. AMC
- 97 - Bihouix, Philippe. 2021. L’Âge des low tech vers une civilisation techniquement soutenable. Éditions du Seuil. p. 143
III. État actuel du permacomputing dans notre culture
1. L’introduction du permacomputing dans la culture populaire

L’informatique grandit à une vitesse faramineuse, c’est pour celà que le permacomputing s’est décidé à exister. Aujourd’hui, dans l’imaginaire collectif et donc dans la culture populaire, la place de la technologie est indéniable. L’informatique, ses codes et ses usages, sont repris dans beaucoup si ce n’est pas tous, des dix arts que nous catégorisons depuis le XXe siècle. Que ce soit dans le troisième avec les arts visuels, le graphisme, le dessin, la peinture, la photographie, le web design, … ou le cinquième avec l’émergence des littératures cybers, ou encore bien évidemment dans le septième art au cinéma, et plus récemment dans la dixième et dernière catégorie, les jeux vidéos et le multimédia. Comment le permacomputing peut-il alors à son tour, s’intégrer dans cette culture populaire et favoriser son épanouissement au sein de notre société ? Le permacomputing se projette dans le futur grâce à la dystopie de l’effondrement et du cyberpunk, mais aussi à l’utopie du solarpunk. Quelles esthétiques le permacomputing veut-il alors adopter ? 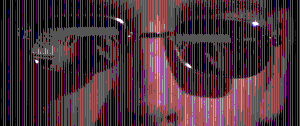
L’usage des fictions est un moyen fort pour faire passer un message. Les œuvres cinématographiques comme Hackers (1995) ou Matrix (1999) permettent justement de véhiculer des portraits, des espaces, ou même des contextes de dystopies technologiques. Les traits des univers sont souvent caricaturés, ou du moins exagérés, afin que le spectateur intègre les tenants et les aboutissants de ceux-ci. Le premier Matrix est sorti sur grand écran en 1999 et réalisé par le duo des sœurs Wachowski. Après une guerre entre l’humanité et les intelligences artificielles, les machines ont asservi les humains dans une simulation afin de les contrôler. Les héros résistants cherchent alors comment rentrer dans la « matrix », la réalité virtuelle conçue par les machines, et libérer ainsi l’humanité. Si l’on observe les esthétiques de cette série de films Matrix, la palette colorimétrique est foncée, brune, voire noire, et agrémentée de bleu et de vert. La série de films est caractérisée par les tons verts et bleus, reflétant la nature artificielle de la réalité simulée dans la matrice. Les décors industriels, les lignes épurées et les effets visuels tels que les machines et autres appareils technologiques contribuent à créer cette atmosphère futuriste et dystopique. Les costumes, notamment les longs manteaux en cuir et les lunettes de soleil sombres, renforcent l'image des personnages comme des rebelles urbains luttant contre le régime autoritaire. Les codes de cette série de films sont encore aujourd’hui ancrés dans l'imaginaire collectif de l’informatique, des hackeurs, et de la dystopie. 1
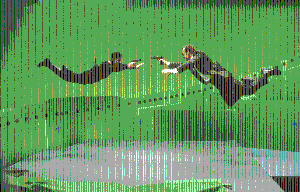
Le vert n’est pas anodin dans l'œuvre des sœurs Wachowski et dans la culture du cyber (du numérique) en général. En effet, Mindy Seu, autrice du Cyber-feminism Index, écrit dans un article en ligne pour le Hyundai Artlab le 6 novembre 2024, que la couleur verte n’est pas un hasard. Les premiers écrans d’ordinateurs étaient des oscilloscopes qui utilisaient du phosphore pour afficher de la couleur rouge, verte, et bleu. Avant les interfaces graphiques utilisateurs que nous utilisons tous aujourd’hui, les ordinateurs utilisaient un terminal textuel de commandes qui permettait à son utilisateur de communiquer avec la machine. La couleur utilisée était alors simplement la moins onéreuse, mais aussi la plus claire et la plus lumineuse, le vert. De plus, le contraste avec le noir du fond de l’écran accentuait encore davantage cette décision. 1 Le vert, mais aussi le rouge et le bleu se retrouvent dans la dénotation générale du film Hackers de 1995. Paru en salle quatre ans avant, Hackers de Iain Softley inspirera le premier film Matrix. Hackers se déroule dans un contexte où l’essor de l’informatique et d’internet commence à façonner la nouvelle culture technologique et submersive. Le film met en scène un groupe d'adolescents doué en piratage informatique qui découvre un complot impliquant une multinationale. Ils sont représentés comme l’archétype de jeunes adolescents rebelles que l’imaginaire collectif de cette période pouvait se faire, c’est-à-dire d’une inspiration punk, portant des blousons en cuir sombre et des paires de lunettes de soleil, en skateboard ou roller, et toujours accompagnés de musique électronique réalisée au synthétiseur. Ces derniers se révolteront en esquissant une certaine morale du hacker, une cybersécurité et des enjeux de pouvoir dans un monde de plus en plus connecté. 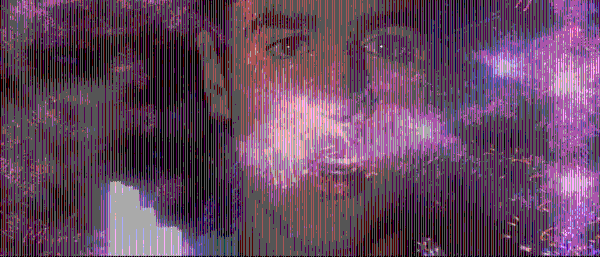
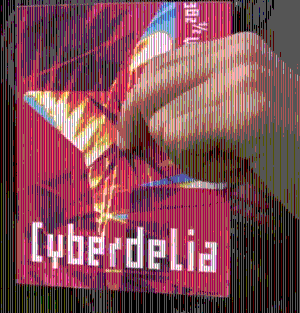
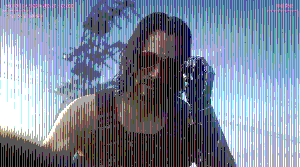
Les cowboys ensuite sont perçues comme le symbole de la liberté et de l’aventure, mais aussi solitaires. Ainsi, les cowboys du cyberespace sont un groupe encore minoritaire dans le film. Cette image est aussi reprise dans le jeu Cyberpunk 2077 par Keanu Reeves, dans le rôle de Johnny Silverhand, un rockeur rebelle et révolutionnaire emprisonné dans l’esprit numérique du protagoniste. Il dit alors à un moment critique pour la vie du héros principal, sans que ce dernier ne soit au courant de qui est Johnny, « Wake the fuck up samouraï, we have a city to burn », que l’on peut traduire par « réveille-toi samouraï, on a une ville à brûler. » Samouraï est d’une part le groupe de musique auquel appartenait Johnny Silverhand avant d’être emprisonné numériquement dans l’esprit du protagoniste appelé « V », et d’autre part également un signe distinctif d’une communauté. Coïncidence ou non, la symbolique est forte et aide le joueur ou le spectateur, dans le cas de Hackers, à considérer l’existence de clans numériques subversifs qui partagent les mêmes idées et les mêmes valeurs.
Les contextes sont souvent similaires dans les œuvres culturelles marquantes gravitant autour de l’informatique et du numérique. Elles sont nourries par les géants de la technologies qui sont implantés depuis de nombreuses années déjà. Ce sont elles qui initialement, comme nous l’avons expliqué pour la couleur verte, sont à l’origine de ces esthétiques. Les premières interfaces graphiques (GUI) augmentent l’ergonomie de commande de l’utilisateur d’une machine, en ayant une couche visuelle avec laquelle interagir directement via la souris, l’extension de notre main. Elles sont composées de menus déroulants, de fenêtres et donc d’une souris. Tous ces éléments nous sont familiers et banals aujourd’hui. Il s’agissait d’une réelle révolution dans le monde de l’informatique des années 1980. L’utilisation des ordinateurs est de ce fait facilitée pour le grand public. Les fenêtres et les couleurs sont imaginées à l’époque par Douglas Engelbart et son équipe pour le système d’exploitation Windows. Dans les années 1990 ensuite, les ordinateurs changent de peau. D’un gris beige aux couleurs et plastiques transparents, les coques des ordinateurs arborent le désir d’apporter une nouvelle dose d’accessibilité au public. Les premiers iMacs d’Apple lancés en 1998 sont la figure de proue de cette esthétique nouvelle. Jonathan Ive, en créant ces boîtier transparents, voulait démystifier la technologie et la rendre plus attrayante, notamment auprès des jeunes et des familles. Les coques d’ordinateur des iMacs se trouvent alors en différentes déclinaisons de couleurs comme le bleu, l’orange ou le vert. La technologie était souvent perçue comme austère et technique, réservée aux connaisseurs. La coque ainsi transparente laisse apparaître l’intérieur de l’ordinateur, visible depuis l’extérieur par tous : plus besoin de l’ouvrir pour voir ce qu’il s’y passe, l’appareil est démystifié. Cette esthétique s’appliquait alors à beaucoup d’objets technologiques, tels que les consoles de jeux. On comprend alors que ces dernières voulaient clairement se démarquer pour plaire à leurs cible principales, les jeunes. Certains nostalgiques, voire mélancoliques déplorent l’envie d’un retour de ces peaux semi transparentes aux couleurs chatoyantes et saturées, époque d’un passé plus agréable visuellement que celui d’aujourd’hui. 1 Depuis, la technologie s’est refermée, s’étant largement implantée dans notre quotidien, les constructeurs ne semblaient plus juger nécessaire cette ouverture, comme si le besoin de savoir et de comprendre l’informatique était comblé. C’est en fait tout l’inverse. Ce n’est pas à propos de l’acheteur et de sa connaissance sur le sujet, mais simplement d’une croissance économique du constructeurs toujours plus ambitieuse. Les géants de l’informatique ont réussi à faire intégrer les usages de la tech au grand public, cela leur suffisait. La connaissance de celle-ci, en revanche, est déplorable. 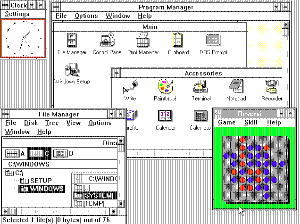

La cyberculture s’est donc étendue au fil des innovations techniques et s’est affranchie de son étiquette d’expert dans les usages, de nerd, à un point où nous savons tous et toutes comment interagir avec ces machines. Le permacomputing lui aussi « trouve de plus en plus d'écho non seulement chez les technologues et les hackers, mais aussi chez les artistes, les développeurs de jeux, les praticiens de la culture et leurs communautés au sens large. » 1 (fabbula, s. d.) Nous avons cerné l’importance des fictions et l’usage de médiums populaires dans la transmission de messages. Les acteurs du permacomputing se sont donnés rendez-vous du 11 au 13 octobre 2024 pour une game jam décentralisée à travers l’Europe. Une game jam est un hackathon du jeu vidéo. L’évènement se tenait dans différents hubs, à Paris, Genève, Rotterdam, Utrecht, Berlin, Vienne, Marseille et Arles, qui sont les points de rassemblement où les participants travaillent ensemble pendant les 48 heures du challenge. Leur objectif est de créer des jeux vidéo avec un thème donné et des contraintes fortes. D’une part les contraintes de la jam et de son thème « violences technologiques », mais d’autre part celles du permacomputing, bien-sûr, tel que l’utilisation de logiciels libres, une petite taille d’octet et l’accessibilité. Les jeux de cet exercice s'inspirent alors souvent du retrogaming. En effet, les développeurs de l’époque fabriquaient des jeux vidéo avec d’énormes contraintes matérielles, comparativement à aujourd’hui. Les contraintes d’hier sont alors les mêmes que nous nous fixons aujourd’hui, pour déconstruire et critiquer ce qui se fait dans l’industrie depuis lors, et surtout prouver que cela est possible.
Des mouvements d’arts numériques tels que le net art, le glitch art, ou la demoscene pour ne citer qu’eux, sont très présent sur internet. Le glitch art, par exemple, voue « un culte à « l’imperfection parfaite », qui exprime sa vérité subversive dans l’esthétique sale de la basse résolution et du sabotage de la machine. Une inclination qu’incarne notamment le collectif Jodi avec wwwwwwwww.jodi.org et Wrong Browser, de faux navigateurs qui confrontent l’internaute à des interfaces anti-intuitives et instables qu’on croirait porteuses d’un virus. Autre artiste clé de la scène du glitch art, le musicien et chercheur suédois Goto80 a développé un jeu vidéo sans nom qui se dégrade à mesure qu’on progresse dans son univers. » 1 Ce mouvement correspond en certains points à l’esthétique et aux idées du genre cyberpunk. En tout cas internet fédère. Les artistes numériques se regroupent et créent des communautés afin d’échanger leurs projets et leurs idées avec d’autres, sur les forums et les réseaux sociaux. Des chaînes Youtube d’éducation partagent même les techniques pour arriver à faire de l’art numérique par soi-même. The Coding Train notamment apprend à créer des visuels génératifs procéduraux grâce à Processing et Open-Processing (P5.JS). Ce sont deux langages de programmation simplifiés pour permettre aux artistes de créer des œuvres numériques. Des professionnels de la communication utilisent le langage Processing. 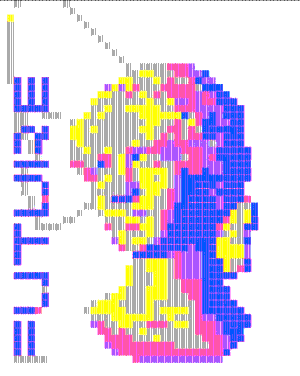
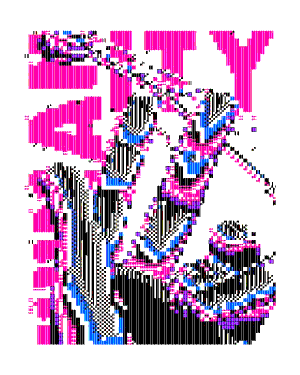
Tameem Sankari génère des courtes vidéos en boucle (semblable aux démos de Viznut) dans le but d’en tirer des affiches. Il se contraint alors à n’utiliser que des lignes de code et des visuels déconstruits de faible résolution. Au-delà d’être l’esthétique propre à l’artiste, l’économie d’énergie derrière ce processus de design graphique est notable. La majorité de la communication actuelle se fait en utilisant les logiciels propriétaires et gourmands en énergie et en puissance de calcul, comme ceux de la suite Adobe. Quelques essais produit de mon chef en me basant sur son travail avec Processing. La dégradation de l’image s’opère en fonction de la position sur les axes x et y de la souris. Des alternatives libres et moins gourmandes existent pourtant grâce à Gimp, Inkscape et Scribus pour ne citer qu’eux en comparaison de la suite Adobe. Il est important de se rendre compte que les possibilités de ces logiciels libres sont les mêmes, même pour des usages professionnels de graphistes. Pourtant, Adobe a su s’imposer depuis les années 1990 et est resté maître de son terrain, malgré sa boulimie d’énergie et de composants matériels de plus en plus nécessitantes.
L’informatique de nos jours a donc subi plusieurs phases. D'abord réservée à une minorité, elle a cherché à se démocratiser dans nos domiciles de plusieurs façons, notamment grâce à une stratégie marketing marquante. On comprend de ce fait l’attrait militant à la technologie des générations X et Y dont est issu Viznut, qui sont nés en même temps que l’éclosion de celle-ci. Les valeurs d’une informatique ouverte matériellement d’une part, mais aussi logiciellement d’une autre est indispensable si l’on veut changer le rapport humain-machine que nous avons aujourd’hui, en vue d'une harmonie. Le permacomputing s'immisce alors dans plusieurs champs pour atteindre différentes communautés. Le mouvement est en marche et fait parler de lui grâce à des initiatives dans l’ère du temps comme la création de jeux vidéo. Toutefois, les géants de l’informatique n’y voient qu’un retour au passé et aux contraintes, desquelles ils ont su s’affranchir à l’époque, synonyme de régression dans leurs marchés. Le problème réside dans l’économie de profit mondial et le permacomputing veut l’endiguer en appelant les samouraïs du clavier à brûler cette ville et ce système.
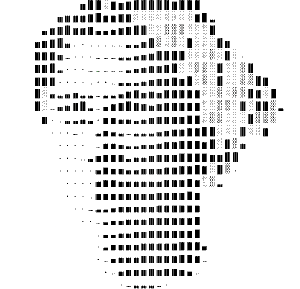
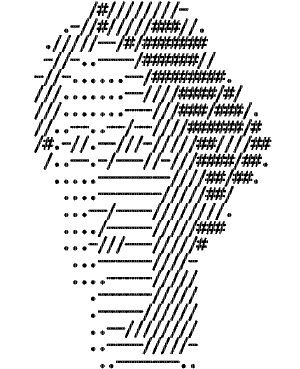


- 98 - « Matrix (film) ». 2024. In Wikipédia. https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Matrix_(film)&oldid=214343465.
- 99 - « Mindy Seu Traces the Origins of Internet Green ». s. d. Hyundai Artlab. Consulté le 9 novembre 2025. https://artlab.hyundai.com/editorial/mindy-seu-traces-the-origins-of-internet-green
- 100 - Softley, Iain, réal. 1995. Hackers : Les Pirates du cyberespace. Action, drame, thriller. United Artists
- 101 - Joseph, Fūnk-é. 2022. « I Miss You, Transparent Technology: An Investigation into the Y2K Clear Craze ». Fanbyte. 2 août 2022. https://www.fanbyte.com/pokemon/features/ transparent-technology-y2k-clear-craze-i-miss-you.
- 102 - fabbula. s. d. « What is permacomputing? » Notion. Consulté le 19 février 2024.
- 103 - « Glitch Art, l’imperfection parfaite ». s. d. Consulté le 2 février 2024. https://usbeketrica.com/fr/article/glitch-art-l-imperfection-parfaite.
2. La sphère matérielle et sociale du permacomputing
L’époque contemporaine est marquée par une surproduction et une surconsommation d’objets technologiques qui influencent nos modes de vie et notre relation au monde. Comme le souligne Fatima Ouassak en 2024 dans Pour une écologie pirate, notre société « fabrique des choses inutiles en même temps que les besoins poussant à vouloir les posséder absolument, des choses que l’on ne peut ni réparer ni fabriquer soi-même. C’est cela qui détruit le monde. » 1 Cette critique, ancrée dans un questionnement écologique et éthique, révèle une contradiction fondamentale entre les promesses de progrès technologique et les réalités destructrices de l’industrie technologique. Le modèle de production actuel, fondé sur l’extraction de ressources rares, la production massive et la génération de déchets, nous impose une urgence à repenser nos objets et les usages que nous faisons d’eux. Ces objets, au-delà de leur utilité apparente, participent à un conditionnement des comportements et à une déconnexion croissante entre l’humain, l’informatique et la nature. Pierre-Damien Huyghe affirme qu’« il existe une morale des objets » et que ces derniers modifient nos mœurs et nos façons de vivre. 1 Un exemple frappant est celui des ordinateurs portables et des smartphones, devenus indispensables mais souvent conçus pour être inaccessibles et impossibles à réparer par leurs propriétaires. Sont-ils seulement propriétaires alors ? Cette opacité reflète une logique industrielle qui déresponsabilise les consommateurs tout en amplifiant la production de déchets, comme nous l’avons déjà exacerber. Selon Camille Bosqué, seuls 15 % des téléphones hors d’usage sont recyclés, et les circuits électroniques, bien que constitués de métaux rares, représentent 8 % des 50 millions de tonnes de déchets électroniques produits en 2018 (2021). 1 Ces chiffres alarmants mettent en lumière une économie mondiale qui favorise le jetable et préfère ignorer les coûts écologiques et sociaux associés à ces pratiques. Ce modèle industriel ne se contente pas uniquement de produire des objets, il façonne aussi des comportements en créant des besoins artificiels et des habitudes de surconsommation que le permacomputing cherche à déconstruire. 
Dans ce contexte, Fairphone évolue depuis 2010. Cette entreprise sociale néerlandaise se distingue avec son modèle économique. Fairphone propose à la vente du grand public des appareils technologiques tels que des smartphones, des casques et écouteurs, ainsi que des accessoires accordants et des pièces détachées. L’entreprise met en avant la durabilité, la réparabilité et une production éthique de ses produits. Elle est confrontée logiquement à une complexité des chaînes d’approvisionnement, qui sont frileuses parfois aux changements que Fairphone veut apporter au monde de la tech, comme des pratiques logiques de commerce équitable. Fairphone cherche à sensibiliser les consommateurs aux enjeux de durabilité et à encourager des pratiques de consommation plus responsables. La marque est aujourd’hui un exemple de la façon dont les entreprises peuvent intégrer des considérations éthiques et environnementales dans leur modèle commercial pour promouvoir un changement positif dans le secteur. 1 Entre 2013 et 2018, Fairphone a écoulé 135 000 appareils, soit le volume que vend Apple en seulement cinq heures (Bosqué 2021). 1 Le constat est abasourdissant. Pourquoi un tel écart de vente alors même que les smartphones de Fairphone sont en tous points plus vertueux ? Comme pour Adobe, ces produits sont présents depuis l’avènement de la technologie et donc dans les accoutumances des consommateurs, qui se perpétuent depuis. Pour résister à ce problème des concepts de projets émergent, tel que le ComputerKIT. 1 Celui-ci valorise les composants reconditionnés, les présentant comme une alternative aux équipements neufs et jetables, tout en impliquant une nouvelle manière de concevoir ordinateurs : « non pas comme une boîte fermée mais comme un ensemble de composants. » 1 (Bosqué 2021) Antonin Odin conçoit ce projet de fin d’étude ainsi dans l’optique de contrer la miniaturisation des composants informatiques et de (re)donner le pouvoir à tous de construire son ordinateur. Ces initiatives montrent qu'il est possible d'envisager une nouvelle économie dans le domaine technologique. Le succès des ces projets dépend cependant d’une évolution des mentalités des consommateurs et d’une volonté politique et économique de soutenir ces modèles alternatifs. Ce type d’alternative ne résout pas uniquement la question des déchets, mais introduit une manière radicalement différente de concevoir les objets technologiques : comme des entités évolutives, transparentes et accessibles. Il est très important de recycler et de réemployer, mais il est encore plus primordial surtout, de concevoir et de consommer différemment. 
Cependant, le problème ne se limite pas à l’électronique. Les matériaux plastiques, omniprésents dans la fabrication des objets, posent également des défis environnementaux majeurs. Par exemple, le fauteuil Louis Ghost, conçu en une seule pièce de polycarbonate moulé par injection, illustre parfaitement la maîtrise technique que nous avons aujourd’hui de ces matériaux, mais soulève aussi des questions sur leur impact à long terme. Oki Sato, avec sa Chaise n°2 en plastique recyclé, et des initiatives comme Precious Plastic France, qui transforme des déchets plastiques en objets utiles, montrent qu’une autre voie est possible : celle d’une utilisation réfléchie et réparatrice des ressources. Precious Plastic France est une branche de Precious Plastic, un projet mondial open source initié par Dave Hakkens en 2013. L’objectif est de proposer des solutions de recyclage des déchets plastiques de manière locale. Le mouvement fournit donc gratuitement des plans open source pour construire des machines de recyclage low tech, permettant ainsi de transformer les déchets plastiques en nouveaux objets utiles. L’idée qui nous intéresse en plus de tout ceci est celle d’une volonté forte à mettre ces technologies entre les mains des citoyens.

Cadavres Exquis est une association Toulousaine qui fait partie de la communauté Precious Plastic France. J’ai rencontré Marlène qui coordonne aujourd’hui à cent pour cent l’association. Avec les bénévoles, ils se déplacent dans les lycées, hôpitaux, centres de recherche comme le CNRS, ou sur de l'événement, pour proposer des ateliers pratiques de sensibilisation à la matière plastique. De plus, l’association propose des objets à la vente, fabriqués par leur soin. Marlène et Cadavres Exquis ont « fait des recherches sur le territoire et aujourd’hui encore, il y a beaucoup de demandes d’ateliers de sensibilisation » 1 (Marlène). L’intérêt des déchets est donc grandissant, ce qui est une bonne chance. Toutefois, ces exemples mettent en lumière l’importance de repenser non seulement les matériaux, mais aussi la manière dont nous interagissons avec eux. Les plastiques, en tant que véritables symboles de l’économie de masse, nécessitent une refonte complète de leurs usages et de leurs cycles de vie pour minimiser leurs impacts environnementaux. Historiquement, des entreprises comme Tupperware ont démontré comment le plastique pouvait être réinterprété. Lancé en 1946, Tupperware a été conçu à partir de plastique issu de la transformation de résidus pétrochimiques en un nouveau produit. Son modèle de vente basé sur l’autogestion et les réunions citoyennes (les « réunions Tupperware ») prouve déjà à cette époque une nouvelle envie d’approcher la consommation. Cette méthode de vente était très ingénieuse, puisque le département marketing de la marque n’avait pas besoin de communiquer fortement. Le bouche à oreille se chargeait de la communication. Dans une période difficile économiquement, l’entreprise a réussi à proposer des produits à partir de déchets, et à les vendre en ne réalisant que très peu de publicité : la formule économique parfaite. Ensuite, si les produits ne fournissent pas une qualité convenable pour le public, ces derniers n’auraient peut-être pas créé cet engouement autour des Tupperware. « Comment devient-on jardinier (ou designer) dans ce jardin là ? » 1 (Bosqué 2024) La réponse réside dans une approche qui valorise la réparabilité, la durabilité et une nouvelle compréhension systémique de nos pratiques de conception. En réintégrant les usagers dans la chaîne de valeur des objets, non seulement comme consommateurs mais aussi comme participants actifs capables de réparer et de modifier leurs objets, nous pourrions transformer radicalement notre rapport aux technologies. Le permacomputing, sans chercher de solutions, se retrouve comme la réponse déterminante à la continuité de notre société actuelle.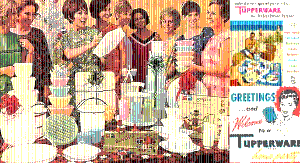
Des produits existants caractérisent déjà ces aspects. Le PhoneBloks 1, un projet visionnaire proposant un smartphone modulaire, n'a cependant jamais vu le jour, malgré un engouement immense avec plus de 380 millions d’audience et près de 980 000 supporters sur la page d’appel au soutien du projet. Imaginé encore par Dave Hakkens comme projet de fin d’étude, ce téléphone est constitué de blocs interchangeables, permettant de remplacer ou d’améliorer individuellement chaque composants, sans changer l’ensemble de l’appareil. On notera que les ordinateurs en sont aussi capables, dans une certaine mesure de compatibilité des pièces. Ce smartphone innovant a inspiré Google qui lance le projet ARA, qui lui aussi échouera à se lancer sur le marché. Le Phonebloks utilise le principe simple des briques LEGO. LEGO est une marque de jouets mondialement connue. Fondée en 1932, la marque est certainement l’exemple ultime en termes de modularité et d’assemblage avec son système de plots et de tubes. Dans la technologie encore, plus particulièrement du côté du quatrième art, la musique, ou Teenage Engineering propose des synthétiseurs portables. Ces appareils sont tous conçus à partir d’un même principe de grille et de blocs, comme LEGO. De ce fait, leurs objets sont d’une part esthétiquement équilibrés, et d’autre part rendus adaptable à la conception d’accessoires tiers ou de produits complémentaires. 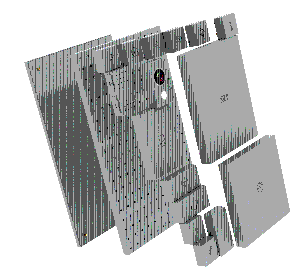
Ces objets concrets ou non témoignent d’une volonté croissante de redéfinir les objets à l’ère du Chthulucène. Cette période, caractérisée par l’impact massif des activités humaines sur la planète et ses résidants, exige une révision profonde de nos systèmes de production et de consommation pour limiter les effets de la crise environnementale. Cette approche ne requiert pas uniquement un engagement de la part des consommateurs comme nous l’avons vu avec Phonebloks, mais plus encore de la part des producteurs et des politiciens. L’enjeu est immense : il s’agit non seulement de réduire l’impact écologique des produits manufacturés, mais également de repenser leur place dans nos vies. L’ordinateur, par exemple, pourrait passer du statut de « boîte noire » à celui d’un outil transparent et évolutif, capable de stimuler une culture entière de la réparation et de la personnalisation. À travers ces exemples, un message clair émerge : l’innovation n’est pas seulement technologique, elle est aussi sociale et écologique. La réflexion sur la manière de concevoir, d’utiliser et de réutiliser les objets doit devenir une priorité collective. Le développement de stratégies ouvertes, comme le mouvement des Makers, pourrait jouer un rôle crucial dans la démocratisation de ces modèles, en rendant accessibles des savoir-faire qui favorisent l’autonomie et la résilience. En somme, il faut bâtir un futur où les objets seront enfin au service d’un bien commun, plutôt que d’un modèle économique destructeur. Il faut construire un nouvel informatique, ouvert, accessible, conscient de son impact, réparable, évolutif, et adapté à chacun de nos usages pour favoriser un rendement irréprochable. Un projet d’une telle envergure serait envisageable à produire d’un coup. C’est pourquoi, pour commencer, il faut adresser un problème qui est celui de l’interopérabilité des ordinateurs portables, que Antonin Odin a touché du doigt avec son projet ComputerKit, mais particulièrement de l’interopérabilité vis-à-vis de la coque de l’ordinateur portable. Pourquoi l’ordinateur portable ? En effet, comme le constatent les salariés de l’association la Rebooterie à Toulouse, « l’écrasante majorité des personnes qui viennent pour l’auto-réparation se présentent avec des ordinateurs portables ou des téléphones. Les gens n’utilisent plus que ces deux appareils. » 1
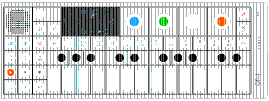
- 104 - Ouassak, Fatima. 2024. Pour une écologie pirate. Points Féminisite. Points. p. 49
- 105 - Journées du Design, 29 et 30 juin 2024 au Petit Perchoir, à Rieux-Volvestre, Toulouse, France. Pierre-Damien Huyghe donne une conférence nommée « Point de vue sur une des définitions du design ».
- 106 - Bosqué, Camille. 2021. Open design. Fabrication numérique et mouvement maker. B42 éd. Collection Esthétique des données 04. p. 67-68
- 107 - « Fairphone (entreprise) ». 2024. In Wikipédia. https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Fairphone_(entreprise) &oldid=214071464.
- 108 - Bosqué, Camille. 2021. Open design. Fabrication numérique et mouvement maker. B42 éd. Collection Esthétique des données 04. p. 68
- 109 - « ANTONIN ODIN ». s. d. Consulté le 30 mars 2024. https://diplorama2022.ensci.com/ PROJET/ANTONIN_ODIN/index_odin.html.
- 110 - Bosqué, Camille. 2021. Open design. Fabrication numérique et mouvement maker. B42 éd. Collection Esthétique des données 04. p. 60
- 111 - Cf. 3. Entretien avec Cadavres Exquis en annexes.
- 112 - Bosqué, Camille. 2024. Design pour un monde fini. Carnets Parallèles. Premier Parallèle. p. 23
- 113 - « Phonebloks ». s. d. Consulté le 15 mai 2024. https://onearmy.earth//project/phonebloks.
- 114 - Cf. 1. Entretien avec la Rebooterie dans les annexes.
IV. Une réappropriation de nos objets informatiques par le prisme pirate
1. Le hacking d’objets comme mantra
Le permacomputing est un mouvement voulant rendre acteurs les usagers de l’informatique. Pour y parvenir, il s’intègre dans les différentes formes d’arts et se diffuse ainsi rapidement. De plus, des entreprises bravent un système de surconsommation bien implanté pour proposer des réponses d’évolution positives différentes. Les mégas-sociétés et l’engagement des consommateurs doivent aller de paire pour parvenir à concevoir un avenir écologique et social plus souhaitable et soutenable. En 2021, « Un européen sur deux estime aujourd’hui être privé d’une compétence que sept sur dix considèrent comme essentielle : réparer et remettre les choses en état de marche » 1 (Bartholeyns et Charpy 2021) . Le changement commence des fois par le « bas », par la population, qu’elle soit entendue ou non. Dans ce cas actuel, il semble que le constat du bas soit acquis. Pour autant, mettent-ils en œuvre la possibilité de l’acceptation de cette compétence, de ce concept de réparation dans leur vie ?
Dans le film Vesper Chronicles, l'action se déroule dans un monde dystopique où une société totalitaire (une oligarchie) contrôle chaque aspect de la vie des citoyens. Les protagonistes, membres d'un groupe de résistance clandestin appelé « Les Vesper », luttent contre le régime oppressif en utilisant des tactiques de piratage informatique et des opérations clandestines pour exposer la vérité au grand jour. 1 L’enfant héros principal de ce film utilise des bouts de circuits électroniques, des tuyaux et des pièces techniques de récupération pour les combiner ensemble et en faire des machines. Comme les Cubains pourraient le faire, le protagoniste hack son environnement pour recréer des objets utiles. Les hackers (prononcé hackeurs)sont issus du mouvement culturel et communautaire hacker, né dans les années 1960. 1
Ces idées sont à remettre dans leurs époques. Oui, tout le monde est d’accord pour affirmer aujourd’hui que l’ordinateur peut être utilisé pour une nouvelle forme d’art : l’art numérique. Cependant, et Steven Levy nous le dit, personne dans les années 50 à 70 n’avait formulé de manière concrète ces « commandements » du hacker, mais tout le monde les respectait. Comme si le consensus se répandait grâce à l’objet sacré qu’est l’ordinateur, que sa mission était toute trouvée.
« Être un hacker va au-delà de toutes les définitions qu’on pourrait donner. Être un hacker, c’est s’autoriser à penser différemment, sortir du cadre avec enthousiasme, remettre en question ce que la société impose. Cela touche tous les domaines de la vie. On peut hacker la nourriture, hacker la manière dont on aime les gens, hacker notre relation avec notre boss, hacker la manière dont on conçoit le monde. C’est au-delà du geek. » 1 (Bosqué 2021) Camille Bosqué ajoute aussi que « l’éthique du hacker est un des éléments fondateurs d’une pensée de la technique ouverte, accessible, libre et décentralisée. » 1 Le mouvement hacker est définitivement un allié du permacomputing, qui partagent toutes ces valeurs. Le mouvement de Viznut, toutefois, est plus radical. On pourrait s’en emparer avec l’aide d’un prisme pirate, c’est-à-dire en contournant les failles qui nous entravent à notre échelle, pour construire notre idéal informatique.
Les Cubains sont l’exemple type,malgré eux, d’un archétype hacker. Suite à la chute du régime soviétique en 1991, Cuba a perdu son soutien économique principal. Il s’en est suivi une grave crise économique durant laquelle les Cubains et Cubaines ont été obligés de faire preuve d’inventivité. Une culture du hacking a alors vu le jour à partir d’objets obsolètes, pour maintenir et réparer les objets de la vie quotidienne. « À force d’ouvrir les objets, de les réparer, de les fragmenter et de s’en servir à sa convenance, le Cubain finit par mépriser les signes qui font des produits occidentaux une unité ou une identité fermée : entendons par là, les superficies, les structures, les couleurs, les formes d’un ensemble, les modes de manipulation, les styles techniques et formels. » 1 (Oroza 2009) Les habitants de l'île sont devenus des véritables experts de la manipulation de composants et de leur interopérabilité. Leur travail aspire exactement au projet esquissé de remodelage de coque d’ordinateur portable. De ce fait, « Si la pensée est intimement liée à l’action, alors la tâche de saisir adéquatement le monde sur le plan intellectuel dépend de notre capacité d’intervenir sur monde. » 1 (Crawford 2009). Notre volonté prime, à l’inverse des contraintes des Cubains, quant à l’envie d’empoigner le monde. 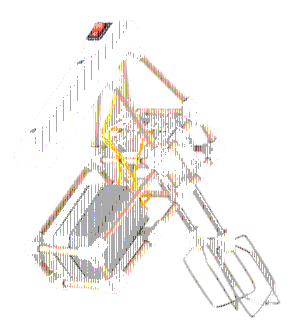
Le projet Hacking Household, conçu par le designer Ernesto Oroza et par le collectif Cuban Institute of Design, remet en question la logique de surconsommation d’objets. En s’inspirant pleinement du hacking, le projet cherche des solutions de détournement d’objets domestiques obsolètes ou endommagés. Le hacker est donc une personne bricoleuse, bidouilleuse et curieuse des artefacts et du monde qui l’entoure. Toutefois, le hacking est une intervention souvent a posteriori sur des objets qui ne sont pas disposés à être disséqué. Repenser un objet dont le but est précisément d’être hacké poursuit l’idéal de ce projet de Ernesto Oroza et du collectif cubain.
C’est au cours du XXe siècle que les objets techniques ont achevé de se refermer par souci d’ergonomie et d’esthétique. 1 L’essor de l’industrialisation pendant ce siècle a permis de remplacer les composants des objets alors fabriqués à la main, par des pièces standardisées faciles à reproduire. Les boîtes hermétiques n’ont alors plus besoin de réparation, il faut en acheter des neuves. Le constat est tempéré aujourd’hui. Les fabricants gardent la coutume, l’habitude de fabriquer des coques esthétiques, mais proposent aussi des solutions de réparation. La marque d'électroménager SEB s’engage par exemple pour la réparabilité. Leurs produits sont conçus en amont pour être facilement démontables, réparables et remontables. SEB propose alors un service de réparation valable quinze années après l’achat d’un appareil. 1 Ce ne sera pas le consommateur ou le bricoleur maker qui le fera himself (soi-même), mais le professionnel, moyennant monnaie. Une personne désireuse de réparer ses appareils ne se poserait pas la question de savoir si le constructeur propose ce type de service, mais l’initiative est à saluer pour la majorité des personnes, le grand public. Ce service est aussi gage de qualités de leurs produits qui durent dans le temps, comme une longévité programmée. Pour ce qui est de l’informatique et des ordinateurs portables, le constat reste encore sombre. Son homologue fixe, l’unité centrale, dispose d’un système de taille standard basé sur la carte mère. On retrouve le plus couramment les formats ATX, Micro ATX, ou Mini ATX, mais il en existe d’autres comme le XL-ATX, E-ATX, ou le Thin ATX. Voyez ces formats de carte mère comme les différents formats de papier que nous connaissons (A4, A5, A3, …). Plus la feuille est grande, plus vous pouvez y mettre des informations. Voici les tailles des standards les plus courants.
| Format | Longueur (mm) | Hauteur (mm) |
|---|---|---|
| ATX Standard | 305 | 244 |
| Micro ATX | 244 | 244 |
| Mini ATX | 170 | 170 |
| Nano ATX | 120 | 120 |
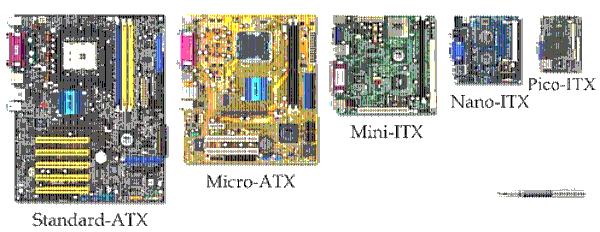
Lors d’un atelier d’auto-réparation mené à la Rebooterie, une personne qui n’avait jamais ouvert les entrailles de son ordinateur portable s’est exclamée : « Il faut démystifier le PC, c’est trop obscur ! » « On ne connaît les ordinateurs que sous leur forme fermée : une jolie boîte fine, avec un bel écran, une petite lumière qui s’allume … Tout est conçu pour qu’on ne sache rien de la manière dont cela fonctionne. » 1 (Bosqué 2021) Cela n'est pas tout à fait vrai. D’abord Camille Bosqué parle des ordinateurs portables. Ceux-ci sont bien les ordinateurs les plus courants, comparativement aux unités centrales, parmi nos terminaux utilisateurs. Les personnes possédant aujourd’hui des unités centrales font partie de communautés précises : les joueurs (gamers) et les créatifs, et connaissent bien leur matériel et leur fonctionnement. Ce sont même eux qui soulèvent le capot souvent transparent en verre trempé, pour opérer la maintenance ou l’évolutivité de leur machine. Cela fait partie intégrante de leur hobbie. Revenons à nos ordinateurs portables à démystifier. L’intégrité des composants est la raison première pour laquelle nous les connaissons sous leur forme fermée. Il est moins dérangeant d’avoir une unité centrale posée quelque part, en verre trempé, dans laquelle pouvoir observer un arc-en-ciel de couleur RGB. Faire la même chose pour un ordinateur portable n’a pas de sens. L’usure du matériau lié à la nature de l’usage de l’appareil aura raison de son intégrité. Utiliser des polymères transparents ou translucides, comme cela a déjà été le cas par le passé, est totalement possible. 1 Mon point est que l’informatique portable est au point aujourd’hui. Cela fait plusieurs dizaines d’années que les constructeurs réfléchissent à l’amélioration de ces appareils. Les couches protectrices sont volontairement opaques pour, comme Matthew B. Crawford le fait remarquer, que l’objet ne doit pas s’ouvrir à un point de déconstruction que l’usager serait forcé de hacker à chaque utilisation. « Ma moto dispose d’un démarreur électrique, d’un allumeur à avance centrifuge, d’une pompe à huile automatique, et je préfère passer mon temps à la conduire qu’à bricoler dessus. Je suis donc parfaitement prêt à admettre que ces innovations sont tout à fait positives, au cas où le lecteur aurait un doute là-dessus. » 1 (Crawford 2009) Un équilibre doit être trouvé entre son utilisation d’usage et sa réparabilité et hackabilité. Il faut aussi donner les clés aux personnes qui souhaitent « mettre les mains dans le cambouis », pour reprendre l’analogie à la mécanique de Crawford dans son ouvrage. Sa moto, nous dit-il, dispose d’éléments de confort tels qu’un démarreur électrique, d’une pompe à huile automatique, et d’un allumeur. Matthew Crawford est conscient de ces innovations confortables dans l’usage de sa moto et les trouve positives, mais il préfère passer son temps à la conduire plutôt qu’à bricoler dessus. 1
Le permacomputing est un terme et un univers politique qui regroupe différentes théories, pratiques et communautés déjà existantes. On peut notamment citer les low-techs, le mouvement maker, la permaculture, l’open source et l’open hardware, ou encore la collapsologie (l’effondrement). À la manière « de la permaculture et de l’agriculture industrielle, la différence est la même entre le permacomputing et le mainstream computing. » 1 (Miyazaki, de Valk, et Heikkilä, s. d.) Pour maximiser le rendement sur un terrain agricole mal choisi et qui n’est pas optimal, l’agriculteur épand de plus en plus d’engrais (de l’énergie artificielle, fabriquée et transformée avec d’autres énergies). Alors qu’en permaculture, l’intelligence par l’observation du terrain est la clé pour un rendement optimal. Ce temps consacré à l’étude du terrain permet donc de gagner en énergie par la suite : il s’agit d’une vision long-termiste. Le réemploi ou le recyclage est essentiel dans les idées du permacomputing, mais devrait aussi être un pragmatisme d’une sobriété matérielle que nous devrions tous adopter. C’est ce même constat qui a donné vie au projet Jerry Do-It-Together. Jerry, pour faire plus court, est une unité centrale d’ordinateur fabriquée à partir de composants de réemploi, dans un bidon ayant une contenance de vingt litres. L’ordinateur était destiné aux pays en voie de développement, notamment en Afrique. L’idée est de récupérer des composants d’ordinateurs compatibles et de les assembler lors d’ateliers. Le bidon est ensuite décoré selon les goûts et les envies des makers/hackers/faiseur-eux-mêmes. Certains Jerry sont utilisés comme ordinateurs, d'autres comme serveurs locaux, pour une alternative aux datacenters et aux clouds (nuages). Jerry Do-It-Together fonctionne grâce aux logiciels libres. 1 La contrainte principale de Jerry est que « la collecte de composants informatiques nécessite d’aller frapper à toutes les portes : particuliers, entreprises, administrations, … L’équipe doit ensuite désosser, démonter les ordinateurs récupérés et tester les composants. » 1(Bosqué 2021)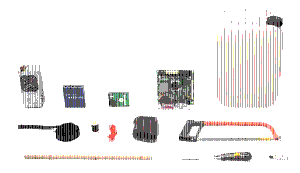
À la recyclerie numérique de Toulouse, la Rebooterie, les dons sont aussi un moyen de récupération des machines et des pièces. Les donateurs se débarrassent de leur matériel inutilisé pour en faire profiter aux autres, potentiellement demandeurs. Toutefois, l’association n’accepte pas tous les dons. Certaines technologies obsolètes comme les périphériques (claviers et souris) utilisant des ports PS/2, ou encore les câbles de téléphonie avant que la technologie n’évolue avec l'arrivée d’internet à haut débit. Hormis cela, ils acceptent tous les ordinateurs portables, les câbles récents, tous les types de téléphones et de smartphone et leurs chargeurs. Ce qui est refoulé à l’entrée est directement jeté dans un bac qu’un professionnel du recyclage de l’électronique viendra débarrasser. Le plus gros contenu de ce bac est composé de coques d’ordinateurs portables en plastique, car non réparables.
Encore une fois, le hacking nous intéresse de par son essence à remodeler des objets entre eux et ainsi de promouvoir une interopérabilité des biens. « Toutefois, il reste difficile de penser que ces pratiques en elles-mêmes auront une place dans le design futur. Leur valeur prend racine dans le présent, dans la possibilité de subvertir l’ordre actuel et de proposer de nouveaux regards sur la relation avec les objets, le marché et l’industrie ; c’est leur modeste contribution à l’avenir de la discipline. » 1 (Oroza 2009) Pour Ernesto Oroza, la pratique du hack d’objet n’est pas projetable d’un point de vue économique. Il s’agirait d’un acte opportun. Toutefois, le réemploi serait grandement simplifié si les constructeurs suivaient une typologie des composants dans leur agencement, les rendant ainsi interchangeables d’un ordinateur portable à un autre, à la manière du hacking d’objets de Cuba. « Afin de rendre les objets techniques opérables et pour favoriser l’expérience d’un design « ouvert », réparable et démontable, la question de la standardisation et de la norme doit être posée. » 1 (Bosqué 2021) C’est aux designers de se poser ces questions d’abord à eux, et ensuite aux potentiels futurs intéressés, nous les utilisateurs. Les industriels suivront s’ils sentent le filon, mais en attendant, ce ne sont pas eux qui vont faire bouger les choses dans ce sens. Ce qui paraît aberrant, puisque nous avons le cas des unités centrales, qui fonctionnent déjà sur ce principe de standardisation ! La subtilité réside dans la miniaturisation des pièces. Plus petit veut dire aussi moins encombrant et plus léger pour l’ordinateur portable. La nécessité est moins grandissante pour les tours fixes, disposées dans nos espaces intérieurs. Une solution donc, serait de poser cette question au travers d’un projet, et avérer l'appétence du public ou non pour un changement qui serait de prime abord minime, de leurs habitudes.
Dans tous les cas, les composants et les systèmes (dans le sens de l’ensemble) doivent être fabriqués en amont de manière à durer dans le temps, ou réparables avec de la documentation ouverte, rendre compatible les composants avec nos outils de tous les jours, avoir des systèmes modulaires, … 1 L'obsolescence programmée deviendra alors à ce moment une longévité programmée bienvenue. Si des pièces sont inutilisables fonctionnellement parlant, il convient alors de leur trouver une nouvelle utilité. À la manière de Brendan Howell et son Rustic Computer en 1976 1 qui n’avait pas d’usage pratique. De cette manière, même si une pièce est complètement obsolète pour sa tâche première, il convient de réfléchir à comment la revaloriser, même si sa nouvelle mission n’a strictement rien à voir avec ses fonctions de base. Qu’il s’agisse de praticité ou non, même sous forme d’art, cette nouvelle pièce aura trouvé sa nouvelle vie, son réemploi. Tout ne doit pas nécessairement être utile pour justifier son existence, mais simplement agréable et plaisant à regarder, écouter, toucher. Certains projets sont et doivent être simplement artistiques. 1 Il revient alors de considérer la place de l’éducation pour parvenir à engagement commun entre la population et les entreprises futures qui créeront nos technologies. John Maeda est un designer, artiste et chercheur connu pour ses contributions dans les domaines du design, de la technologie et de l’éducation. Son travail sur l’intégration du design et de la technologie sous forme d’art correspond avec cette idée de réflexion sur des usages de la technologie autre qu’utilitaire. 
Le hacking d’objet semble donc momentané. Il sera certainement présent dans le futur puisque subversif, mais circonscrit à des localités précises, à moins que le monde ne se lance dans une campagne mondiale d’hacktivisme matériel contre les méga-sociétés. Le hacking cherche l’ouverture là où elle n’est pas. Les travaux de ce mouvement sont précieux pour le permacomputing qui lui aussi souhaite ouvrir l’informatique. Un autre mouvement, plus engagé encore, reprend les idées du hack d’objets, en les propulsant dans l’océan global du système, pour tenter un sabordage. Quel est cet autre mouvement et comment est-il capable d’aider le permacomputing à s’affranchir des contraintes capitalistes, et se délaisser de l’aliénation actuelle des objets informatiques ?
- 115 - Bartholeyns, Gil, et Manuel Charpy. 2021. L’étrange et folle aventure du grille-pain, de la machine à coudre et des gens qui s’en servent. Carnets Parallèles. Premier Parallèle. p. 59
- 116 - Buožytė, Kristina, et Bruno Samper, réal. 2022. Vesper Chronicles. Science Fiction, Drame, Aventure. Condor Distribution.
- 117 - « Usbek & Rica - Une brève histoire des hackers ». s. d. Consulté le 27 mars 2024. https://usbeketrica.com/fr/article/une-breve-histoire-des-hackers.
- 118 - Un white hat est un hacker éthique qui agit pour le bien commun et légalement, en testant et renforçant la sécurité des systèmes.
- 119 - Un black hat est un hacker malveillant. Il exploite illégalement des failles pour nuire et/ou tirer profit.
- 120 - Steven, Levy. 2013. L’éthique des hackers. Evergreen. Chapitre 2. l'éthique des hackers. p. 37 à 48
- 121 - Bosqué, Camille. 2021. Open design. Fabrication numérique et mouvement maker. B42 éd. Collection Esthétique des données 04. p. 118 : entretien avec Mitch Altman, le fondateur de NoiseBridge, réalisé le 2 mai 2013 à San Francisco.
- 122 - Bosqué, Camille. 2021. Open design. Fabrication numérique et mouvement maker. B42 éd. Collection Esthétique des données 04. p. 119 : entretien avec Mitch Altman, le fondateur de NoiseBridge, réalisé le 2 mai 2013 à San Francisco
- 123 - Oroza, Ernesto. 2009. Rikimbili. Publications de l’Université de Saint-Étienne. Cité du Design. p. 21
- 124 - Crawford, Matthew B. 2009. Éloge du carburateur essai sur le sens et la valeur du travail. La Découverte. p. 188
- 125 - Bartholeyns, Gil, et Manuel Charpy. 2021. L’étrange et folle aventure du grille-pain, de la machine à coudre et des gens qui s’en servent. Carnets Parallèles. Premier Parallèle. p. 59
- 126 - « Petit électroménager réparable - Seb ». s. d. Consulté le 24 février 2024. https://www.seb.fr/produits-reparables.
- 127 - Bosqué, Camille. 2021. Open design. Fabrication numérique et mouvement maker. B42 éd. Collection Esthétique des données 04. p. 62 : entretien avec Romain Chanut réalisé le 21 mars 2013 à Paris.
- 128 - Cf. Chapitre III. 2. La sphère matérielle et sociale du permacomputing.
- 129 - Crawford, Matthew B. 2009. Éloge du carburateur essai sur le sens et la valeur du travail. La Découverte. p. 77
- 130 - Ibid. p. 75
- 131 - Miyazaki, Shintaro, Marloes de Valk, et Ville-Matias Heikkilä. s. d. « Permacomputing ».
- 132 - « Jerry Do-It-Together ». 2024. In Wikipédia. https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Jerry_Do-It-Together&oldid=214550324.
- 133 - Bosqué, Camille. 2021. Open design. Fabrication numérique et mouvement maker. B42 éd. Collection Esthétique des données 04. p. 62 : entretien avec Romain Chanut réalisé le 21 mars 2013 à Paris
- 134 - Oroza, Ernesto. 2009. Rikimbili. Publications de l’Université de Saint-Étienne. Cité du Design. p. 48
- 135 - Ibid. p. 66
- 136 - Grindle, Mike. 2023. « Permacomputing: Tackling the Problem of Technological Waste ». The New Climate. (blog). 31 juillet 2023. https://medium.com/the-new-climate/permacomputing-tackling-the-problem-of-technological-waste-4cc7a4437ad6.
- 137 - « ~Rustic Computing~ | Moddr_ ». s. d. Consulté le 7 novembre 2023. https://moddr.net/rustic-computing/.
- 138 - Heikkilä « Viznut », Ville-Mathias. 2021. « Permacomputing Update 2021 ». 2021. http://viznut.fi/texts-en/permacomputing_update_2021.html.
2. Les pirates et leur combat contre l'obsolescence programmée
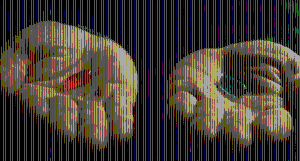
Nous vivons dans une société de surconsommation. Le hacking d’objets permet de remédier à ce paradigme provisoirement. Matthew B. Crawford fait l’état dans son livre Éloge du carburateur, que « comme si l’épanouissement et la liberté personnels ne pouvaient s’exprimer que par l’achat de nouveaux gadgets, jamais par la préservation de ce qu’on possède déjà. « 1 (Crawford 2009) Nous remplaçons nos objets trop rapidement pour d’autres neufs. Si nous les remplacions par des objets dits d’occasions, le problème de la surconsommation serait endigué. Les coûts en matières premières se réduisent, mais aussi en ressources humaines et donc aussi en écologie. Le transport et la logistique seraient sans doute au moins aussi forts. En continuant ce cheminement, un second problème nous pose une embûche : l’obsolescence programmée. En effet, le circuit d’objets d’occasion sera vite essoufflé du fait de leur condition à être remplacé par du nouveau. Deux choix semblent s’offrir à nous : une pilule rouge à ingérer pour choisir de faire avec ces objets comme nous l’avons toujours faits jusqu’à ce jour, et donc de jeter, de recycler, de hacker ou de réparer, ou une pilule bleue à ingérer qui changerait l’industrie mais aussi notre façon de consommer grâce à une longévité programmée. Ou les deux ?
Ernesto Oroza en a fait un constat similaire au sujet de l’économie des objets de Cuba. « Pourquoi ne pas doter les produits d’une vieillesse potentielle. » 1 (Oroza 2009) Les géants de l’informatique commencent seulement à faire émerger cette idée frivole dans leurs têtes, non pas même sur la vieillesse potentielle, mais sur une facilité d'accessibilité à l’ouverture de leurs appareils. L'obsolescence programmée est de fait une péremption anticipée délibérée des industrielles. Elle permet d’entretenir une consommation. Ainsi, « ll est donc toujours possible de produire de nouveaux objets, de les estampiller « durable », « éco-design », « design vert », ou « design soutenable » et de trouver à les vendre : on « consomme autrement », mais on consomme toujours, parfois dans le cadre de l’économie sociale et solidaire. » 1 (Bosqué 2024) Dans le film de 1995 « Hackers : Les Pirates du cyberespace », les jeunes hackeurs (pirates) cherchent les limites de leur pratique encore naissante en se donnant des règles morales : ils se sont concerté et sont venus à la conclusion par exemple qu’ils n’allaient jamais pirater les banques. Ils mettent en place un code d'honneur des pirates. 1 Les pirates marins sont présents depuis bien plus longtemps que nos pirates contemporains du cyberespace et eux aussi avaient leurs règles de bonne conduite et leurs limites. Les marins vivent dans une « hydrarchie ». 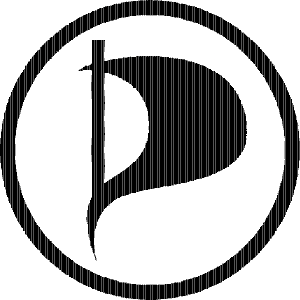
« Pour Gilbert Simondon, philosophe et observateur attentif des techniques des années 1950, ce n'est pas la technique en soi, mais la « méconnaissance de la machine » qui est « la plus forte cause d’aliénation dans le monde contemporain » 1 (Bartholeyns et Charpy 2021). Le hacking domestique avertit sur la composition de nos objets contemporains en les démontant. En ce faisant, les hackers se plient même inconsciemment, à un assujettissement du concepteur initial de l’objet. Or pour les pirates, « nul homme n’a le droit d’asservir son prochain » 1 (Defoe 1728). L'assujettissement indirect est donc obligatoire dans le hacking d’objets, puisque nous nous contraignons dans les formes de son concepteur. Dans le domaine de l’informatique, les développeurs créent des couches logicielles pour nous faciliter l’usage des machines. Toutefois, ces couches ne sont pas malléables par l’utilisateur, sauf si celui-ci dispose de logiciels libres. Dans le cas contraire, l’utilisateur est asservi par la société propriétaire des programmes présents sur sa machine. Dans l’hardware enfin, cet assujettissement est relatif. Les composants se miniaturisent de plus en plus, limitant leur potentielle modularité. Les ordinateurs fixes jouissent de plus de liberté, grâce notamment à leur standardisation de carte mère, rendant les composants gravitants interopérables. Néanmoins, il reste encore à comprendre comment ces composants fonctionnent une fois l’accès ouvert. Certains projets d’ordinateurs portables s'essayent à ces problématiques.
Un ordinateur portable déblaie les possibilités en termes d’ouverture pirate. MTN Reform 1 est un ordinateur véritablement transparent, comme dans les années 1990, avec une coque inférieure en acrylique. Ce fabuleux matériel peut être entièrement ouvert à l’aide d’un seul tournevis. De plus, toutes ses pièces sont remplaçables, même la batterie qui est composée de plusieurs cellules amovibles. Le MNT Reform est en véritable opposition aux géants de la technologie. Il fonctionne sous logiciels libres, est entièrement démontable et réparable, et combat de fait l'obsolescence programmée. Cet objet est certainement l’inspiration première pour un projet de remodelage de coque d’ordinateur portable. Tout dans ce projet est à prendre et est en parfait accord avec les valeurs caractérisées tout au long de cet écrit. Nous reviendrons plus tard sur ce projet fascinant. Certains gros industriels de l'informatique marchent tout de même dans le droit chemin. Dell est en train de concevoir un nouvel ordinateur portable remarquable. « Le constructeur veut que nos ordinateurs portables passent « d’une « utilisation, puis recyclage » à une « utilisation, réutilisation, puis réutilisation et encore réutilisation » jusqu’à la fin de vie réelle de l’appareil. » 1 (géographe 2022)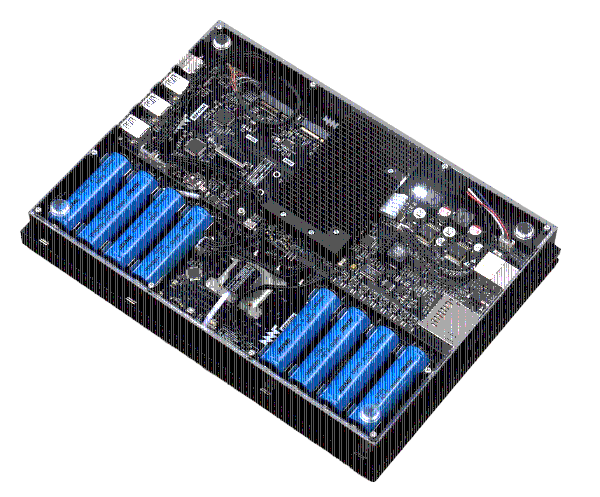
Dell nous propose le Dell Luna, inspiré du Dell Concept Luna. 1 Avec ce produit, Dell veut se positionner comme Fairphone l’ont fait avant eux, en intégrant des considérations éthiques et environnementales dans leurs chaînes de production. Les étapes de cette transition passeront pour Dell par un design de produits modulaires. Les composants ou leurs vis seront simplifiés et standardisés pour pouvoir récupérer des pièces détachées et les réinjecter dans l’économie. Ensuite l’empreinte carbone de leurs produits sera évidemment considérée dès la source, au même titre que les déférences humaines encore négligées. « Les pirates de l’Atlantique cherchent à garantir leur santé et leur sécurité, ils veillent à leur propre « autopréservation » 1 (Defoe 1728). Malheureusement, les mineurs qui excavent nos ressources rarissimes de la terre n’ont pas la possibilité de se revendiquer pirates et de garantir leur santé en exerçant ce travail. Les pirates néanmoins « abolissent la relation salariale propre au procédé d’accumulation capitaliste » 1 (Defoe 1728). Que se passerait-il demain si ces travailleurs se revendiquaient pirates ? Nous serions déjà tous amenés à hacker nos objets.
« Un sondage réalisé en 2016 par l’Ipsos ne demande pas si les objets ménagers rendent heureux, mais quels objets ménagers rendent heureux : l’ordinateur (94 %), le lave-linge, la télévision et l’aspirateur (84 %) sont les quatre équipement qui, aux yeux de sondés, contribuent le plus « aux petits bonheurs quotidiens » 1 (Bartholeyns et Charpy 2021). Ces chiffres affermissent l’impératif de changer notre conception de nos appareils et de l’ordinateur. Comme analysé plus tôt, nous savons déjà que pour y parvenir, la volonté d’engagement de la population doit se croiser au même moment et au même niveau que celle des industriels. Le système social est donc complètement connexe au système technique que nos objets forment. 1 Le système technique est formé par ses objets, mais une technique ne peut pas subvenir à une absence de savoir-faire. Le long héritage d’une culture matérielle que nous transportons depuis le début de l’humanité n’est qu’un processus d’hybridation qui évoluent en fonction de nos besoins et à permis les découvertes que nous connaissons. 1 Olaf Weber définit le « type » en tant que « produit culturel intégratif dans une situation historiquement concrète de développement social. » 1 L’ordinateur en tant que type, est alors un ensemble de standards, à savoir « de règles techniques, qui résultent d’exigences pratiques et techniques. » 1 En d’autres mots, sa forme et son usage actuel a été et est encore conditionné par nos besoins. Seulement aujourd’hui, cette solidarité entre les systèmes sociaux et techniques nous a menés dans une impasse écologique et sociale. La surconsommation, l’accumulation et la comparaison sont le résultat de l’industrialisation du XIXe siècle, où John Ruskin et Henry Cole débattaient déjà de la vision des avancées techniques, de la production de masse ensuite, et enfin du développement du capitalisme le siècle suivant. La réussite sociale est alors valorisée par la possession de biens. « En 2017, le taux d’équipement des ménages français en téléviseur (95 %) équivaut à celui du lave-linge. Les objets de seconde nécessité, comme la radio ou l’ordinateur, devancent des appareils ménagers jugés indispensables tels que le four ou le lave-vaisselle. Et les premiers ont une durée de vie inférieure aux seconds : entre quatre et sept ans pour la caméra, l’imprimante, la télévision (deux ans pour le téléphone), contre huit à onze ans pour l’aspirateur, le réfrigérateur et le four » 1 (Bartholeyns et Charpy 2021). Le remplacement est encore privilégié à la réparation. Il semble que les premiers pas des industriels ne soient pas suffisants pour faire converger le changement de paradigme du système social via le système technique. Forcément, ceci va à l'encontre du système économique actuel et les entreprises doivent s’adapter au changement. C’est à partir de la Dépression dans les années 1930 que les gens, par peur, font durer leurs bien plus longtemps possible : habits, meubles, outils … L’obsolescence est alors perçue pour les industriels comme la solution à cette volonté de faire durer, de prendre soin de ce qui nous appartient. Les industriels ont réussi à créer le besoin de renouvellement, le besoin de consommer dans une société devenue marchande.
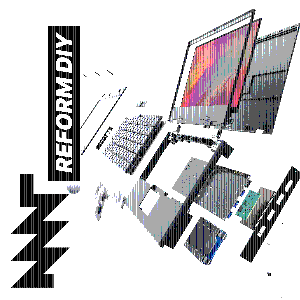
La compétition et la comparaison de la réussite sociale sont fâcheusement au centre de la mode de la cherté. La distinction sociale se fait au travers des esthétiques de nos objets, et non pas sur leurs valeurs sémantiques. Deux objets peuvent réaliser les mêmes tâches mais instantanément catégoriser son acquéreur dans des cases complètement différentes. « Il existe ainsi des grille-pain à 9,99 euros en hypermarché et à plus de 500 euros dans les boutiques chic. L’un comme l’autre « grille, décongèlent, réchauffent » 1 (Bartholeyns et Charpy 2021). Les différences notables, au-delà de leurs fonctions similaires, sont de l’ordre de la durabilité, qui est intrinsèquement liée au mode de production de l’objet et de ses matériaux. La cherté fait donc l’attraction. La « pauvreté » est-elle donc le rejet ? En quoi serait-ce le cas si les deux grille-pains possèdent les mêmes fonctions ? Il s’agit de l’importance que nous donnons à nos objets. Cette perception est différente d’un individu à un autre en fonction de l’objet. Tous les objets ne se valent cependant pas comme nous l’avons vu, l’ordinateur est toujours en tête du classement. Ainsi, quand le startupper arrive dans son open-space et dégaine son ordinateur portable Thinkpad des années 2010, un jugement de valeur est immédiatement émis par ses collègues l’entourant, disposant eux d’un macbook dernière génération. La comparaison est plus notable dans l’imaginaire collectif que réel, puisque Lenovo reste une société chinoise, qui a racheté en 2005 la division informatique de IBM, qui produisait les premiers Thinkpad et Thinklight.
Mais alors est-ce que l’on peut créer de l’attraction différemment ? Par exemple grâce à des objets non plus de cherté, mais de fierté ? Fier de l’avoir fait nous-même, ou bien fier de l’avoir réparé, customisé, ou hacké ? Le mouvement pirate et la culture du hacking pourrait être une solution vers une société de l’autonomie et de la responsabilité citoyenne, avec comme alliés le permacomputing au côté de la sobriété et de la décroissance, qui peuvent aussi « agir à rebours de la compétition, du statut par l’argent, des signes ostentatoires de richesse, qui nous dressent les uns contre les autres au profit des dominants qui en tirent leurs profits et leur emprise. » (Corinne Morel Darleux, s. d.) 1
- 139 - Crawford, Matthew B. 2009. Éloge du carburateur essai sur le sens et la valeur du travail. La Découverte. p. 78
- 140 - Oroza, Ernesto. 2009. Rikimbili. Publications de l’Université de Saint-Étienne. Cité du Design. p. 9
- 141 - Bosqué, Camille. 2024. Design pour un monde fini. Carnets Parallèles. Premier Parallèle. p. 23
- 142 - Softley, Iain, réal. 1995. Hackers : Les Pirates du cyberespace. Action, drame, thriller. United Artists
- 143 - Defoe, Daniel. 1728. Libertalia, une utopie pirate. La Petite littéraire. Libertalia. p. 102
- 144 - Defoe, Daniel. 1728. Libertalia, une utopie pirate. La Petite littéraire. Libertalia. p. 103
- 145 - Ibid. p. 102-103
- 146 - Ibid. p. 103
- 147 - Bartholeyns, Gil, et Manuel Charpy. 2021. L’étrange et folle aventure du grille-pain, de la machine à coudre et des gens qui s’en servent. Carnets Parallèles. Premier Parallèle. p. 1
- 148 - Defoe, Daniel. 1728. Libertalia, une utopie pirate. La Petite littéraire. Libertalia. p. 104
- 149 - « MNT Reform ». s. d. Crowd Supply. Consulté le 9 février 2024. https://www.crowdsupply.com/mnt/reform.
- 150 - géographe, Yohan Demeure, expert. 2022. « VivaTech : Dell présente sa vision d’un laptop durable avec le concept Luna ». Sciencepost. 20 juin 2022 https://sciencepost.fr/vivatech-dell-laptop-durable-luna/.
- 151 - Dell Technologies France, réal. 2022. VIVATECH 2022 - Le concept Luna se dévoile. https://www.youtube.com/watch?v=Eu37xaN_Ca4.
- 152 - Defoe, Daniel. 1728. Libertalia, une utopie pirate. La Petite littéraire. Libertalia. p. 108
- 153 - Ibid. p. 107
- 154 - Bartholeyns, Gil, et Manuel Charpy. 2021. L’étrange et folle aventure du grille-pain, de la machine à coudre et des gens qui s’en servent. Carnets Parallèles. Premier Parallèle. p. 154
- 155 - Ibid. p. 180
- 156 - Ibid. p. 195
- 157 - Weber, Olaf. 1982. « Über das Verhältnis von Standard und Typus in der Architektur ». https://doi.org/10.11588. p. 115-116
- 158 - Bertrand, Gwenaëlle, et Maxime Favard. 2022. « « Typen », maître-mot du design industriel ». Appareil, no 24 (juillet). https://doi.org/10.4000/appareil.4325.
- 159 - Ibid. p. 160
- 160 - Ibid. p. 53-54
- 161 - Ibid. p. 56
- 162 - Ibid. p. 104
- 163 - « « Il nous reste environ trente ans de numérique devant nous » ». s. d. Consulté le 1 décembre 2024. https://usbeketrica.com/fr/article/il-nous-reste-environ-trente-ans-de-numerique-devant-nous.
3. Déconstruction de la fameuse boîte noire
Pierre Damien Huyghe, dans sa définition du design, dit que si nous le pratiquons « pour entretenir le même rapport que celui que nous avons déjà, alors on prétend faire du design sans en faire. » 1 S’il s’agit plutôt d’augmenter une tendance qui n’a pas besoin d’exister, à savoir du versioning, alors ce n’est pas le design qui nous intéresse. Le sujet de l’attractivité esthétique et cosmétique plutôt que l'usage des objets est de retour sur la table. Prenons un exemple concret de cette conférence des Journées du Design. Si vous vous rasez la barbe par exemple, celle-ci disparaît, mais vous et votre personne restez inchangés. Le vélo sans chaîne de Peugeot par contre, utilise un changement dans la moyen de transmission de l’énergie. La chaîne disparaît au profit d’un générateur électrique dans le moyeu. 1 Cette différence est initialement non-cosmétique, ce qui n’en fait pas du versioning. Jonathan Ive, designer responsable des produits Apple entre 1996 et 2019, « produit des objets logiques, discrets et peu encombrants qui effacent toute trace de superflue à leur surface pour garantir une « évidence dans l’usage », une légèreté et une efficacité. » 1 (Bosqué 2021) Ive a donc participé à la création de ces boîtes noires contemporaines, qui, sous leurs coques, cachent leurs méandres d’électronique et de métaux rares. Toutefois, Jonathan Ive et les autres designers du monde de l’informatique avaient leurs raisons de penser les coques ainsi.
La déconstruction de la boîte commence par son ouverture et son observation, tel un perma-agriculteur qui observe son terrain avant de l'aménager. Il existe globalement deux terrains en ce qui concerne les ordinateurs portables : les MacBook et les ordinateurs portables. L'agencement des composants à l'intérieur d'un MacBook présente plusieurs différences par rapport à un ordinateur portable classique. Apple utilise un design plus compact avec des composants souvent soudés directement à la carte mère pour réduire l'encombrement et améliorer l'efficacité énergétique. Cela permet une meilleure gestion de l'espace et une réduction de l'épaisseur globale de l'appareil. Contrairement aux ordinateurs portables classiques qui offrent généralement des options d'extension comme des emplacements pour RAM ou disque dur, les MacBook privilégient des solutions plus fines, comme des SSD et de la RAM soudée, ce qui augmente la compacité mais peut limiter les réparations et la possibilité de mise à niveau ou de mise à jour. Les composants suivent des standards induits par leur connectique, s’ils ne sont pas soudés. Il est possible par exemple de récupérer la dalle d’un écran de 17 » (pouces, pour l’unité de mesure de la taille d’un écran) d’un ordinateur portable, et de la réutiliser pour son ordinateur de 15 ». La dalle dépassera de la coque, mais elle fonctionnera tout de même. L’objet sera défiguré par la réparation.
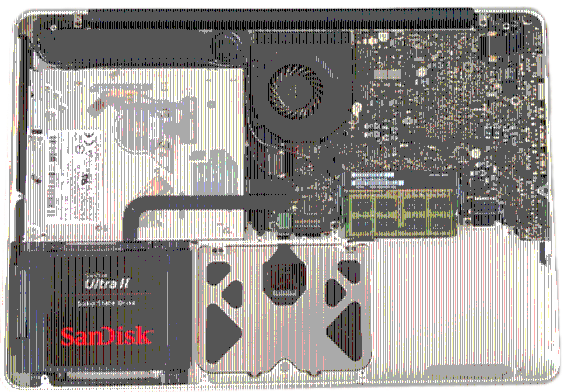
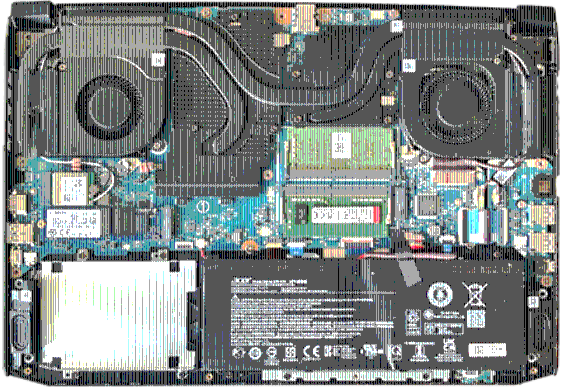
Un objet ne peut pas par définition être affranchi de sa dépendance à sa conception. Toute conception induit des choix, des formes, des couleurs, … Il dépend de chacun et de chacune à trouver et à se donner des limites en ces termes. Une publicité de juillet 2007 dans le magazine Motor Cyclist, pour la moto Yamaha Warrior, utilise un slogan qui résonne avec cette fausse idée de choix du consommateur : « La vie est ce que vous saurez en faire. Commencez à la faire vôtre. » […] « La Yamaha Warrior 1670cc à moteur à injection. C’est nous qui l’avons fabriquée. C’est vous qui la faites vôtre. » En caractère encore plus petits, on peut lire : « Il n’y a qu’une vie - autant ne pas la gâcher. Alors si vous achetez la AMA Prostar Hot Rod Cruiser Class Champion Warrior, procurez-vous aussi les nombreux accessoires Star Custom, vous ne regretterez pas le résultat : impressionnant et très personnalisé » 1 L’argument de vente de cette moto était sa customisation par l’achat d’options standardisées supplémentaires. On se retrouve alors dans le contre-exemple parfait de ce qu’il faut éviter pour ne pas asservir son utilisateur. Effectivement, le motard pourra certes personnaliser son engin, mais au travers de choix prédéfinis par le constructeurs. Or choisir n’est pas créer, et encore moins synonyme de liberté. Appelons alors cet effet la semi-liberté. Cette semi-liberté fait partie volontairement de l'ADN de Framework et son Framework Laptop. La liberté de personnalisation et d’ouverture n’existe qu’au travers des différents modules interchangeables en fonction de nos besoins et de l’agencement des parties supérieur tel que le clavier, le trackpad et les quelques accessoires cosmétiques disponibles. Or, « Si nous n’avons plus à fourrager dans les entrailles de nos machines, nous sommes désormais libres de nous contenter d’en faire l’usage qui nous agrée. » « Mais dans un autre sens, le conducteur est en fait devenu plus dépendant. » 1 (Crawford 2009) Encore une fois le droit de trancher reviendra au consommateur final. L’industriel de son côté, qui imagine ces contraintes, ces standards, ces formes, … doit être conscient que ce sont ceux-ci qui créeront potentiellement de l’attrait. La balance entre les valeurs idéales d’un projet et de son attrait pour le public doit être pesée à tout instant lors de sa conception. 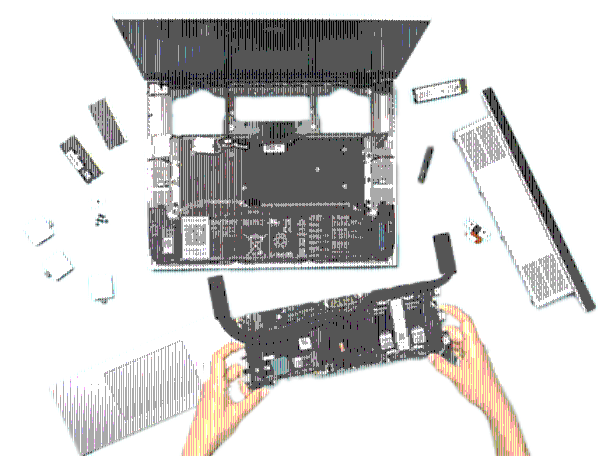
Entre les années 1950 et 1970, les objets du quotidien comme les télévisions ou les phonographes se dissimulent derrière des systèmes escamotables, du placage en acajou, ou des battants. 1 La culture se meut et l’on dissimule alors la technicité des objets. « la technique nue paraît obscène dans l’espace meublé » 1 (Bartholeyns et Charpy 2021). La technologie à droit à ce traitement en même temps. La radio TS 502, conçue par Marco Zanuso et Richard Sapper en 1964 pour Brionvega, est un objet emblématique du design italien. Son esthétique minimaliste et sa forme compacte en coquille pliable ont marqué l'histoire du design industriel récent. Combinant fonctionnalité et élégance, elle intègre des matériaux modernes pour l'époque, comme le plastique ABS. Les designers souhaitaient un objet qui ne paraisse pas technologique quand il n’est pas utilisé. On cherche à cacher sa fonction, son attrait n’en est alors qu' accrue. Ensuite, les premiers ordinateurs de l'époque étaient construits tel des bedrock computer si nous les regardons au travers de nos technologies actuelles. Des composants simplement alignés sur une planche. Ils étaient même vendus en kit, ce qui laissait libre court à l’imagination à la manière du Jerry Do-It-Together pour l'assemblage et la personnalisation. 
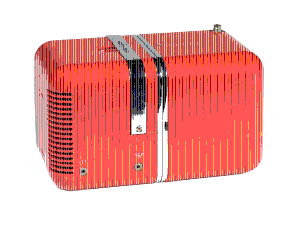
L’histoire des deux géants de l’informatique commence, avec le Macbook et l’ordinateur (pas encore portable à ce moment), qui sont partis au même moment et d’idées similaires à l’époque. D’un côté de ce terrain, le Altair 8800, lancé en 1975 par la société MITS (Micro Instrumentation and Telemetry Systems), offre un fascinant aperçu de l'émergence de l'informatique personnelle et de l'engouement pour la micro-informatique à la fin des années 1970. L'Altair 8800 était le premier ordinateur personnel disponible sur le marché en kit, offrant aux amateurs d'électronique la possibilité de construire leur propre machine à domicile, en diminuant le coût pour l’acheteur au minimum. Conçu par Ed Roberts, le Altair 8800 était basé sur le microprocesseur Intel 8080 et ne disposait pas d’écran ou de clavier intégré. Il nécessitait plutôt l'utilisation de commutateurs et de LED pour l'interaction. Malgré ses limitations, le Altair 8800 a suscité un enthousiasme considérable parmi les passionnés d'informatique. 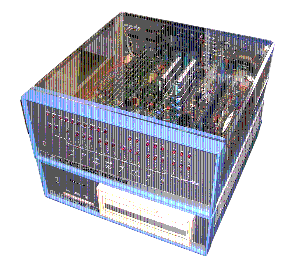
De plus, il a été largement crédité pour avoir stimulé l'intérêt pour la programmation et l'électronique chez les amateurs. Son influence a été immense, inspirant des innovateurs tels que Bill Gates et Paul Allen, marquant ainsi le début de Microsoft en tant que leader de l'industrie informatique. 1 De l’autre côté du terrain, le Apple I représente un jalon tout aussi important dans l'histoire de l'informatique personnel. Conçu par Steve Wozniak et Steve Jobs en 1976 dans le garage des parents de Jobs, l’Apple I était un ordinateur personnel révolutionnaire pour son époque. Le défi des Steves était de créer un système informatique complet et fonctionnel en utilisant des composants électroniques disponibles dans le commerce et à destination de la sphère domestique. Le produit devait être à la fois abordable et accessible pour les amateurs d'informatique, tout en étant suffisamment puissant pour répondre à leurs besoins. Basée sur un microprocesseur MOS 6502, celui-ci permettait aux utilisateurs de construire leur propre ordinateur aussi à partir d'un kit. Le Apple I a été un succès immédiat, marquant le début de l'aventure d'Apple en tant que leader mondial de l'innovation technologique. 1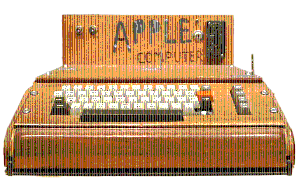
Les histoires du Altair 8800 et du Apple I mettent à l’époque en lumière le potentiel révolutionnaire de la technologie sur notre société moderne, et posant les bases de l'industrie de l'informatique personnelle telle que nous la connaissons aujourd'hui. Certains projets contemporains veulent retrouver cet aspect de simplicité que possèdent le bedrock computing et le permacomputing. On peut citer MTN Reform, un ordinateur portable DIY, modulable et open-source. 1 Tout est documenté concernant cet appareil. Tout peut être changé et remplacé. C’est certainement aujourd’hui l’ordinateur portable le plus modulable et le plus ouvert matériellement et logiciellement. Dans un autre registre, mais tout aussi important pour le permacomputing, la sauvegarde de données à distance par le nuage (cloud). Cloud of Cards « est un kit DIY d'informatique domestique pour se réapproprier ses données, et est le principal résultat de « Inhabiting and Interfacing the Cloud(s) », un projet conjoint de design et de recherche ethnographique. Il est accompagné de deux livres en impression à la demande et de PDF gratuits qui documentent sa création. » 1 (« Cloud of Cards », s. d.) L’intention de ce projet est de rendre le consommateur de données en ligne conscient de la technologie derrière le nuage. Le cloud est un mot bien choisi, puisque les données nous sont visibles depuis n’importe où, comme si elles se baladaient de nuages en nuages jusqu’à nous. Ces derniers projets documentent leurs processus pour que les utilisateurs puissent recréer chez eux, à leur manière, les mêmes protocoles. À la manière de la machine à coudre de Thimonnier, qui, en 1854, détaillait déjà toutes les défaillances possibles de la machine ainsi que ses résolutions possibles. 1 La notice d’explication au montage et aux usages existe grâce à l’essor de la vente par correspondance. Aujourd’hui, dans l’informatique, seules des notices de montage existent pour les ordinateurs fixes et leurs composants. L’ordinateur portable arrivant monté, nul besoin de produire ces notices. L’importance du retour des notices pour une informatique ouverte est indispensable, sans quoi la transition du système social vers ce domaine ne sera jamais complète.
Le permacomputing veut nous permettre de retrouver le contrôle de nos machines et de nous faire prendre conscience de l’impact global des terminaux utilisateurs. Face à l'obsolescence programmée et à l’opacité des appareils, le permacomputing doit emprunter des idées de l’esprit pirate pour que la déconstruction de l’informatique devienne un outil pour imaginer des objets plus ouverts, durables, économes en ressources, et adaptés à nos usages qui deviendront ainsi raisonnés. L’attrait cosmétique d’un objet est également inévitable, permettant de créer un pont entre le système social et le système technique. Ainsi, l’idée d’un projet compilant tous ces enjeux semble judicieux. Certains géants de l’informatique commencent même des travaux connexes.
La suite de cette recherche mène à projet, le « Strata » compilant toutes ces idées, ces principes et ces mouvements, permettant de repenser l’ordinateur portable, à partir de composants déjà existants. Il faut réinventer sa peau, sa coque, qui est conçue pour protéger, cacher, et se distinguer. La nouvelle mue de l’ordinateur portable devra être ouverte et ouvrable. Elle devra utiliser du plastique recyclé issu des déchets ainsi que de l’aluminium, recyclable à hauteur de 100 %. Plus qu’un objet banal, ce nouvel ordinateur portable nous redonnerait le pouvoir de l’objet, comme nous le doit tout outil. Enfin, il devra éliminer la cause principale d'obsolescence matérielle : le refroidissement actif. Pour ce faire, la coque en aluminium absorbera la chaleur générée par les composants cruciaux : le processeur et éventuellement la carte graphique. Ainsi, un système passif et adaptatif de liaison entre la coque et ces organes devra être conçu. L’ordinateur portable se basera sur la taille la plus courante du marché, quinze pouces.
- 164 - Journées du Design, 29 et 30 juin 2024 au Petit Perchoir, à Rieux-Volvestre, Toulouse, France ; organisé par Damien Guizard. Pierre-Damien Huyghe donne une conférence nommée « Point de vue sur une des définitions du design ».
- 165 - « Sans chaîne, ni courroie : comment fonctionnent ces vélos « hybrides » à entraînement numérique ? » 2023. clubic.com. 16 juillet 2023. https://www.clubic.com/electric-bicycle/actualite-477964-sans-chaine-ni-courroie-comment-fonctionnent-ces-velos-hybrides-a-entrainement-numerique.html.
- 166 - Bosqué, Camille. 2021. Open design. Fabrication numérique et mouvement maker. B42 éd. Collection Esthétique des données 04. p. 65
- 167 - Ibid. p. 92
- 168 - Weber, Olaf. 1982. « Über das Verhältnis von Standard und Typus in der Architektur ». https://doi.org/10.11588.
- 169 - Crawford, Matthew B. 2009. Éloge du carburateur essai sur le sens et la valeur du travail. La Découverte. p. 81-82
- 170 - Ibid. p. 77 et 75
- 171 - Bartholeyns, Gil, et Manuel Charpy. 2021. L’étrange et folle aventure du grille-pain, de la machine à coudre et des gens qui s’en servent. Carnets Parallèles. Premier Parallèle. p. 39
- 172 - Ibid.
- 173 - « Altair 8800 ». 2023. In Wikipédia. https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Altair_8800&oldid=205789258.
- 174 - « Apple I ». 2023. In Wikipédia. https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Apple_I&oldid=209836568.
- 175 - « MNT Reform ». s. d. Crowd Supply. Consulté le 9 février 2024. https://www.crowdsupply.com/mnt/reform.
- 176 - « Cloud of Cards ». s. d. ECAL Shop (blog). Consulté le 15 avril 2024. https://ecal-shop.ch/produit/cloud-of-cards/.
- 177 - Bartholeyns, Gil, et Manuel Charpy. 2021. L’étrange et folle aventure du grille-pain, de la machine à coudre et des gens qui s’en servent. Carnets Parallèles. Premier Parallèle. p. 60
V. Un ordinateur Frankenstein
1. L’agencement des organes d’un ordinateur portable
L’introduction de ce billet de blog décrit le permacomputing comme une recherche visant « à optimiser notre utilisation du numérique pour qu’elle ait le moins d’impact possible sur la planète [...] : prolonger la durée de vie des appareils, réduire la consommation d’énergie, et repenser nos habitudes de consommation. » 1 Cependant, il n’est pas forcément voulu d’optimiser notre utilisation. Par définition, optimiser revient à donner les meilleures conditions de fonctionnement à quelque chose. De ce fait, si l’on optimise notre utilisation d'un objet, nous pouvons le consommer davantage. On appelle ce phénomène « l’effet rebond ». 1 L'effet rebond désigne une situation où les gains d'efficacité énergétique ou matérielle sont compensés, voire annulés, par une augmentation de la consommation. Une voiture moins gourmande en carburant peut inciter à rouler davantage, réduisant ainsi les bénéfices environnementaux attendus. Effectivement, notre « priorité doit être d’organiser les conditions du changement : montrer qu’il n’y a pas de fatalité, que c’est possible, et que c’est politique. » 1 (Ouassak 2024) C’est pourquoi la volonté de créer cette nouvelle coque d'ordinateur portable doit exister, pour proposer des conditions de changement, sans pour autant se voiler la face sur ses futures utilisations.
La genèse de ce projet « Strata » se trouve dans la légende de Frankenstein, du roman « Frankenstein ou le Prométhée moderne » en 1818, de Mary Shelley. Le roman est inspirée par des débats scientifiques d'époque sur l'électricité et la réanimation des corps. L'histoire raconte le destin tragique du docteur Victor Frankenstein, qui crée une créature monstrueuse à partir de morceaux de cadavres. Rejetée par son créateur et la société, la créature se venge en semant la mort autour d'elle. L’analogie montrant l’idée littérale de recomposition de corps à partir de morceaux et les effets que cela produit sur la société est très intéressante. Aujourd'hui encore, le neuf est privilégié, et le reconditionné est envisagé. Dans les deux cas, les enveloppes de ces matériels sont globalement comme neuves, alors que l’intérieur est une charpie de composants. Tout doit pouvoir se contenir dans la coque, c’est la seule règle. Une question émerge alors : comment repenser une coque d’ordinateur portable à partir de composants issues du réemploi, facilement réparable et évolutive, nous redonnant le pouvoir sur l’objet ?
L’intelligence artificielle Midjourney a créé, sur la base d’un script que je lui ai remis, ce à quoi pourrait ressembler mon projet. Le script en question : « imagine un ordinateur modulaire ». Voici trois résultats marquants. Une esthétique inspirée du Lego est immédiatement reconnaissable. Peu étonnant vis-à-vis du langage engagé dans le script. Un deuxième est transparent, ce qui est étonnant. L’intelligence artificielle a fait un lien entre la modularité et la transparence. Un troisième enfin qui ressemble à ce que pourrait être un appareil Frankenstein sans peau. Ou plutôt, qu’il s’agisse des composants eux-mêmes qui deviennent la peau. On note les inspirations fortes aux briques Lego modulaires, et aussi à la transparence souvent attachée aux configurations onéreuses des gamers. 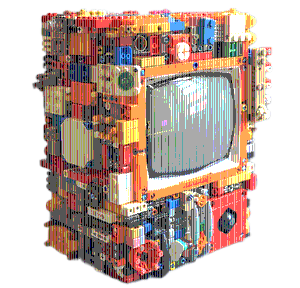
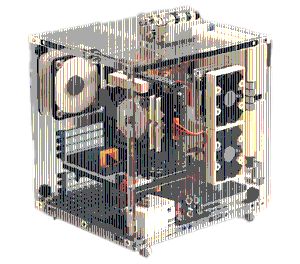
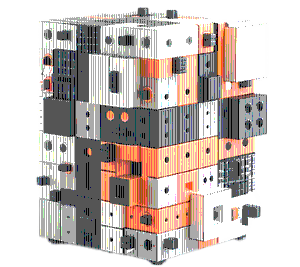
Comment repenser l’agencement de composants existants dans une nouvelle coque d’ordinateur portable ? Cette question se pose tous les jours en Inde dans les ateliers de résurrection (rise) d’ordinateur portable Frankenstein Ces marchands récupèrent des composants et ne s’arrêtent pas simplement à les revisser dans une coque. Ils dessoudent et ressoudent même des condensateurs ou transistors aux cartes mères. La demande de ces appareils vendus à faible coût est en hausse dans ce pays. Un vrai marché parallèle est en place, empiétant sur les zones grises de la législation locale. Toutes les parties seraient gagnantes à autoriser la récupération et le réemploi de ces composants, qui finissent enfouies la plupart du temps.
En Occident, certains réagencent déjà les organes d’ordinateurs portables et partagent leurs aventures sur des sites de makers. 1 En 52 étapes commentées et imagées, la personne nous explique tous ses choix. Ce procédé est indigeste et réservé aux connaisseurs. Dans les commentaires de ce projet, d’autres utilisateurs parlent même « d’une grande entreprise ». Néanmoins, le temps consacré par ces personnes à ce type de projet démontre la possibilité d’un ordinateur Frankenstein. Les fabricants ne leur simplifient pas la tâche : vis propriétaires, soudures, architecture interne différentes entre chaque modèle de même marque… L’histoire d’amitié entre Frankenstein et les ordinateurs portables n’est étonnamment pas si récente. Sur les forums des années 2000-2010, des internautes partagent leurs besoins en pièces détachées de Thinkpads, afin d’améliorer les performances de leurs machines. 1 Ces ordinateurs se font appeler « FrankenPad ». « Franken » du mot « Frankenstein », « Pad » pour « ThinkPad ». L’interopérabilité des Thinkpads était remarquable et permettait le changement de pièces provenant d’autres séries d’ordinateurs. Malheureusement, après le rachat de la branche des Thinkpads d’IBM par Lenovo en 2005, les choix stratégiques de la marque changent. Celle-ci privilégie la réduction des coûts au détriment de la robustesse et de l’ergonomie renommée des anciens modèles. La miniaturisation des composants impact directement leur modularité.
La miniaturisation est le premier élément qu’il faut adresser. Pour la création du projet Strata, l’utilisation de composants amovibles est nécessaire (RAM non soudée, processeurs détachables). Ce choix technique soulève notre premier standard technique. Ces standards sont obligatoires pour la création de biens en tant que type. Un ordinateur typique de ces standards pourra alors se recomposer, de la même manière que les FrankenPad, ou encore les unités centrales. Le réagencement de composants déjà existants n’est pas chose facile. Les constructeurs conçoivent leurs machines sans imaginer que celles-ci seront ouvertes pour un façonnage quelconque. De ce fait, la carte mère, qui est le squelette du corps, définit la répartition de tous les autres organes. Sur trente squelettes, aucune n’est correspondante.
Représentation au trait de trente cartes mères. Légende : Vert : connectiques externes, Noir : branchement de la batterie, Violet : branchement du disque dur en SATA, Bleu : système de refroidissement actif.
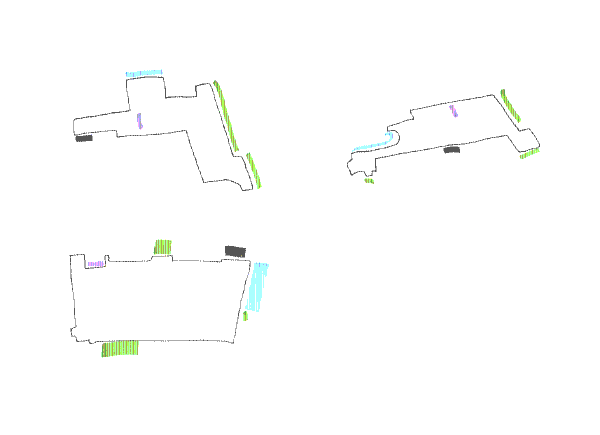
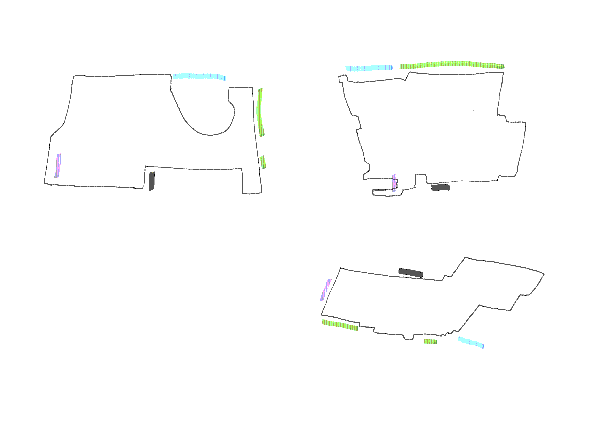
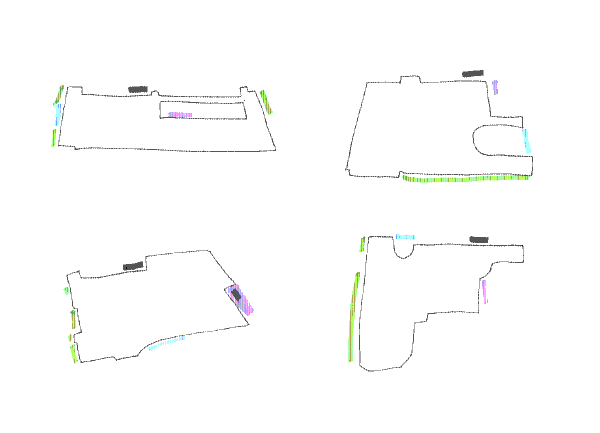
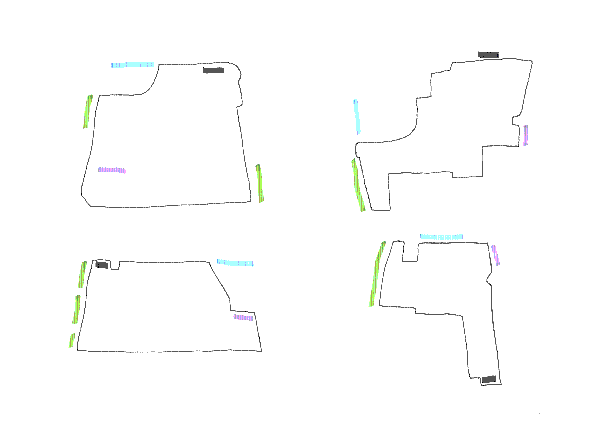
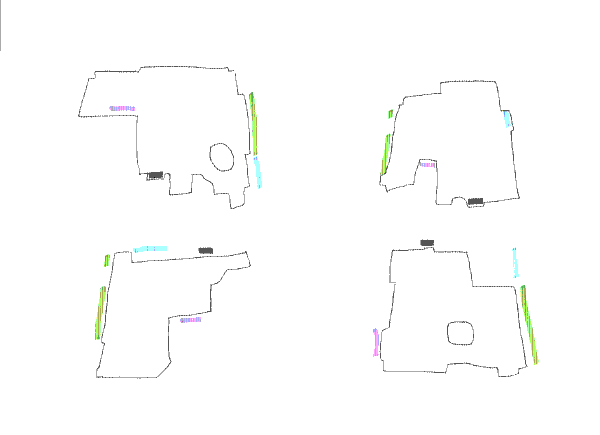
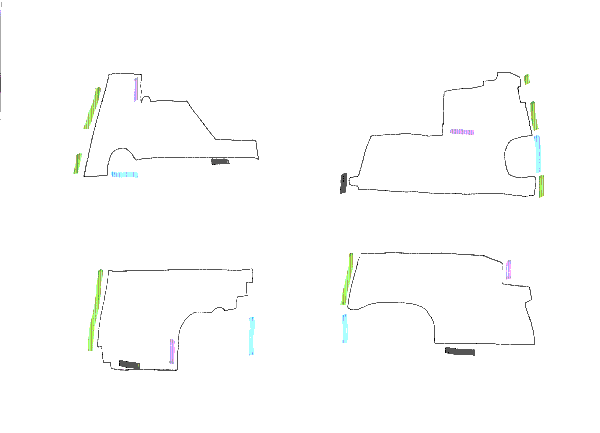
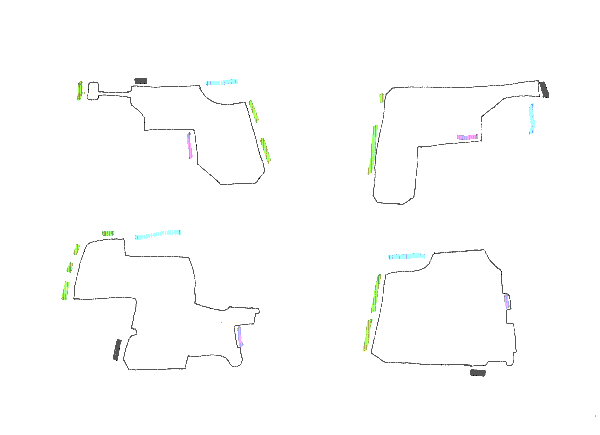
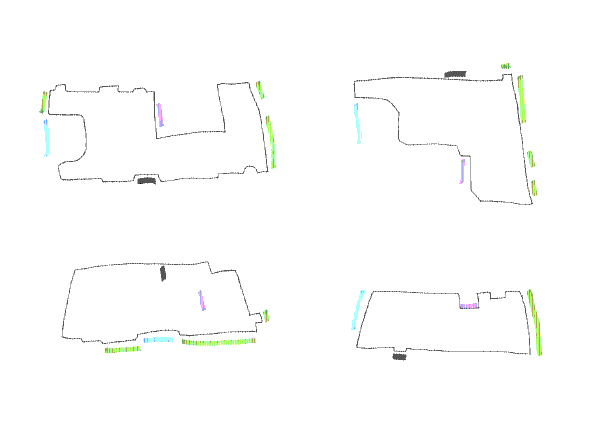
Aucun motif ne se répète. Tous les cas de figures sont différents. Si nous voulons créer un système adaptatif de refroidissement, nous devons standardiser un système qui ne l’est pas. Il faut trouver les pièces à refroidir.Encore une fois, les constructeurs ne se concertent pas et produisent des architectures non typiques. La puissance des composants est la cause principale de cette observation. Plus le processeur est puissant, plus celui-ci aura tendance à chauffer. Le refroidissement doit s’adapter à cette contrainte, pour chaque configuration matériel d’un PC. Ce tableau récapitule les formes et les tailles en millimètre du système de compression par vis, des processeurs et des cartes graphiques.
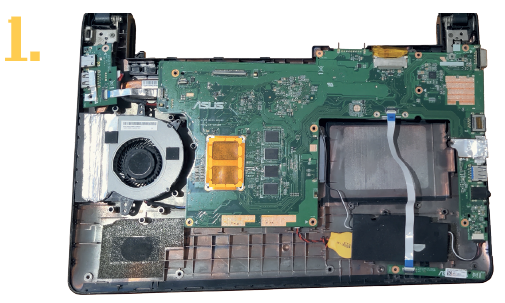
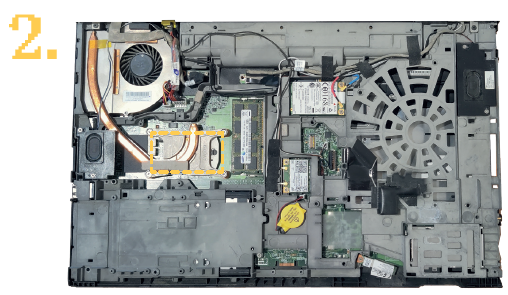
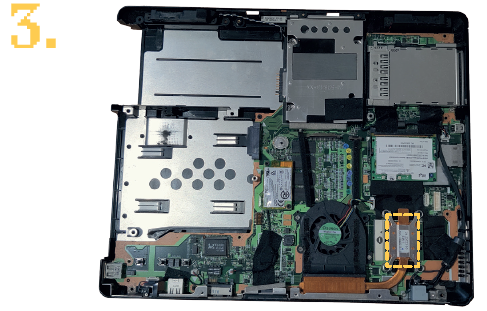
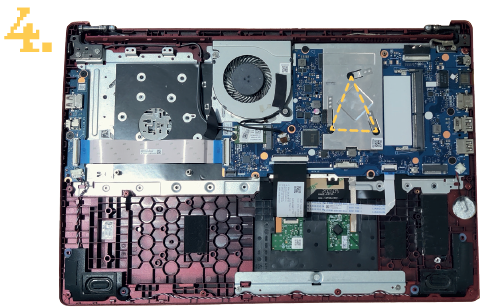
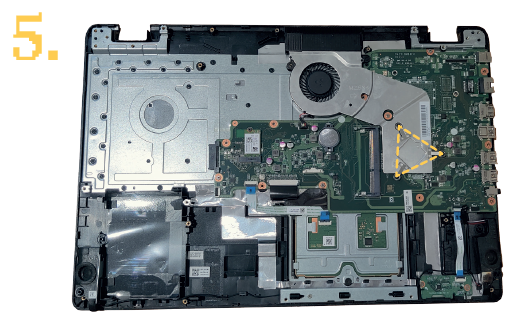

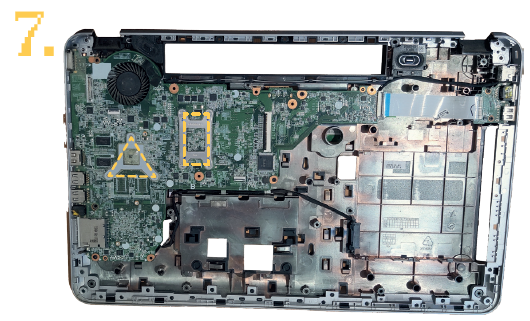
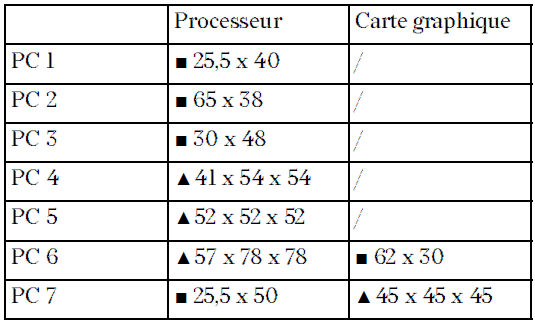
Plusieurs aspects sont remarquables. Le système de compression par vis prend deux formes : rectangulaire ou triangulaire. Ensuite, une donnée tend à être arrondie et sort du lot, puisque CPU et GPU oscillent globalement entre 40 mm et 60 mm. Enfin, deux composants doivent être refroidis sur certaines machines. Étant les éléments sur lesquels nous intervenons, il est judicieux de se baser sur leurs données. D’après les observations, les processeurs sous ces systèmes d’accroches font soit 40mm de côté, soit 25 mm. Il serait important d’évaluer à une plus grande échelle cet échantillon. De plus, au-delà de penser à un système de refroidissement adaptatif, il nous faut éventuellement repenser la réorganisation des organes. Dans le cadre de la conception d’une nouvelle monstruosité, une équipe serait de mise : un designer et un ingénieur électrotechnicien dialoguant pour trouver des réponses adéquates ensemble. 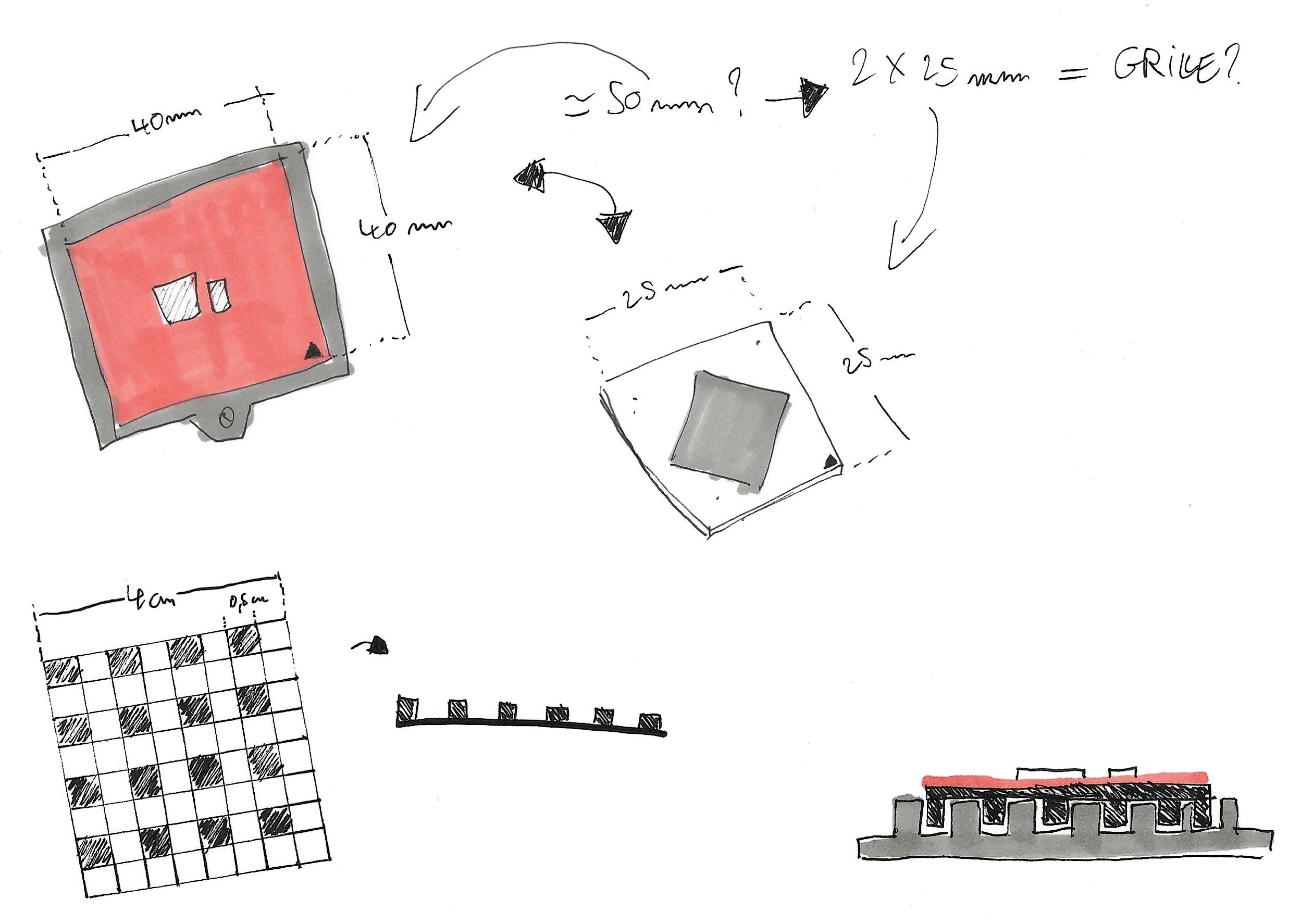
Ici les composants d’un ingénieur existent déjà. Nous l’avons observé, les composants ne sont jamais aux mêmes endroits. Comment créer un système standard d’implémentation de composants dans notre nouvelle coque ? Une boîte de dérivation ou des pieuvres d’électriciens qui existent dans le monde du bâtiment peuvent-être des idées. 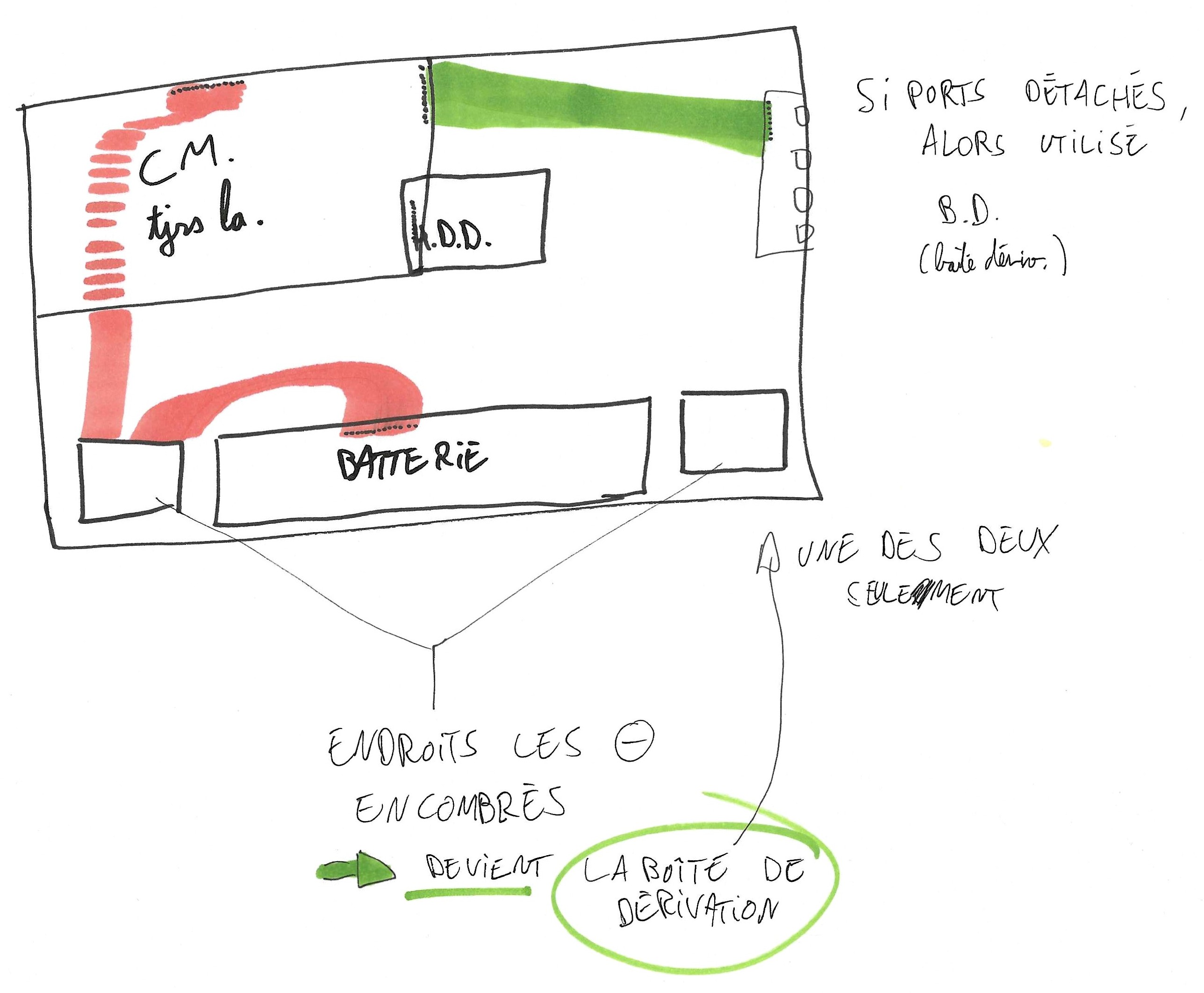
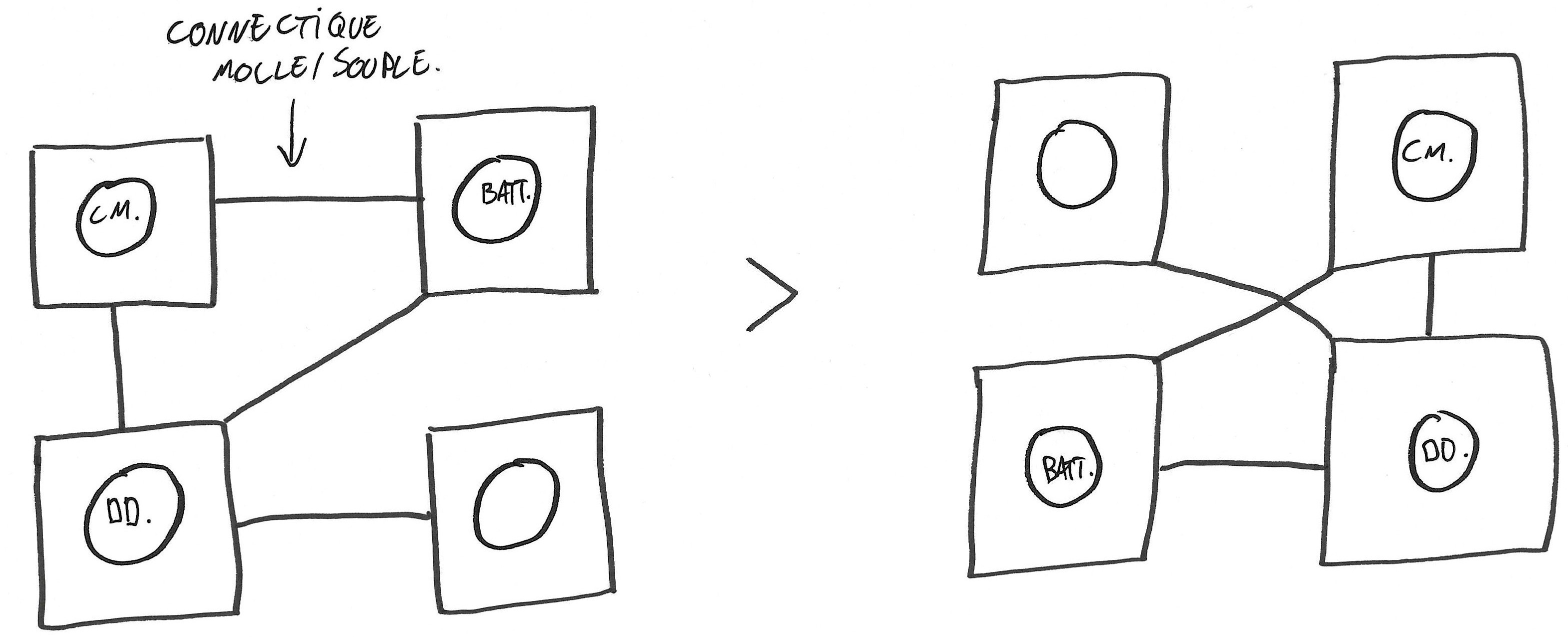
Il faudrait créer des rallonges, des jonctions, entre les organes. La boîte de dérivation serait alors l’endroit de branchement univoque. En partant du principe que chaque organe dispose d’un encombrement maximal, le réagencement devient un jeu de puzzle.
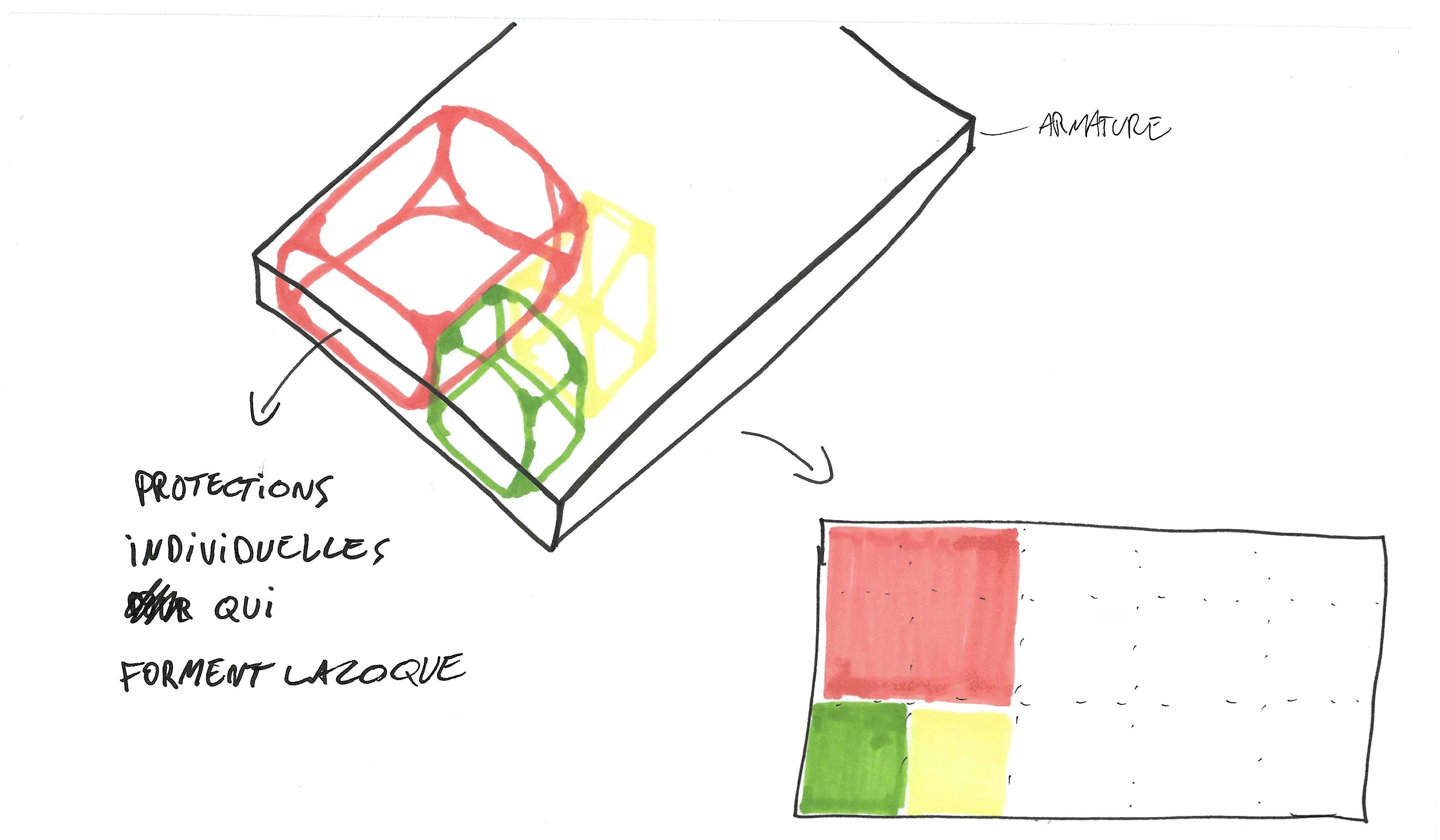
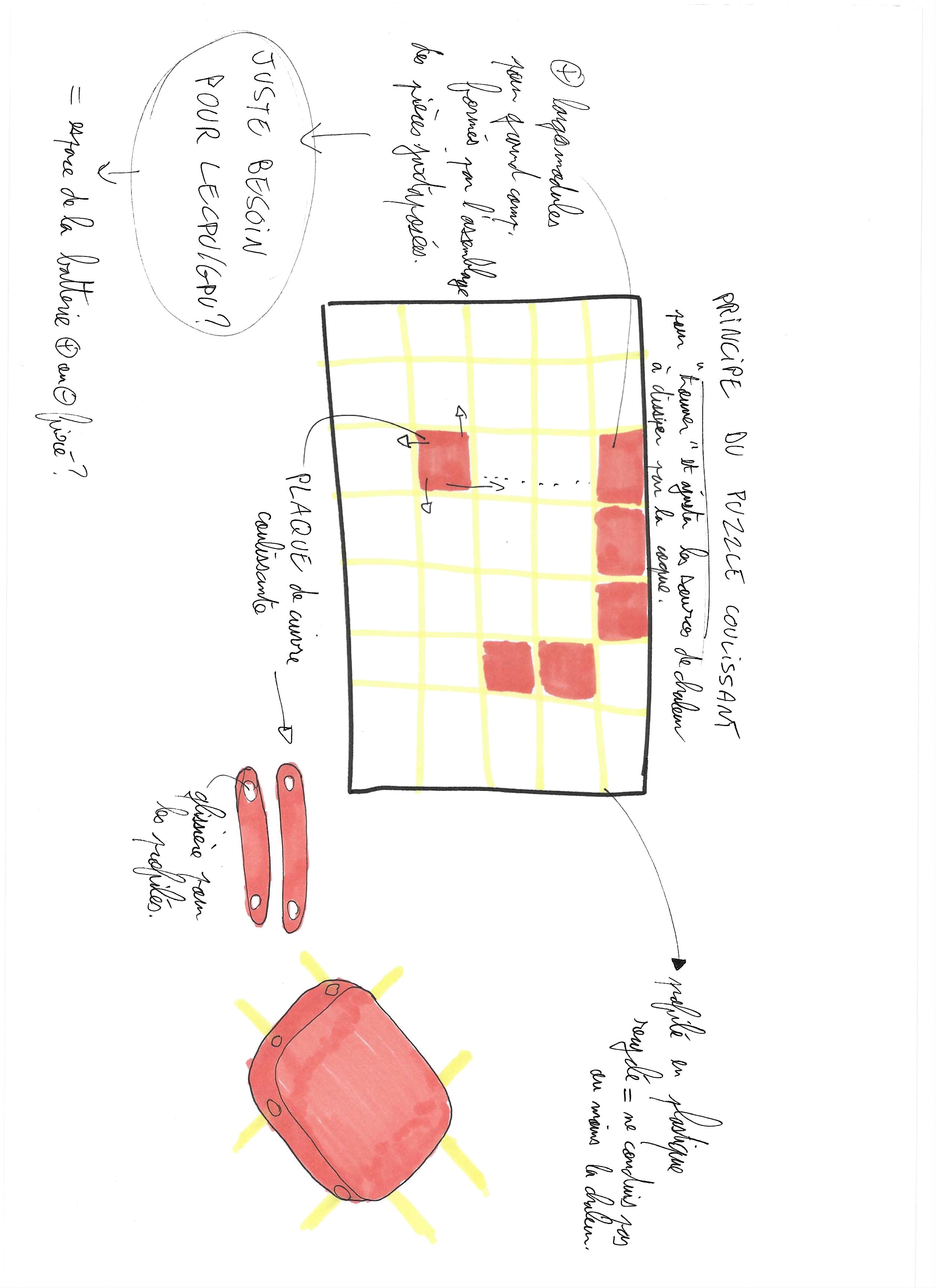
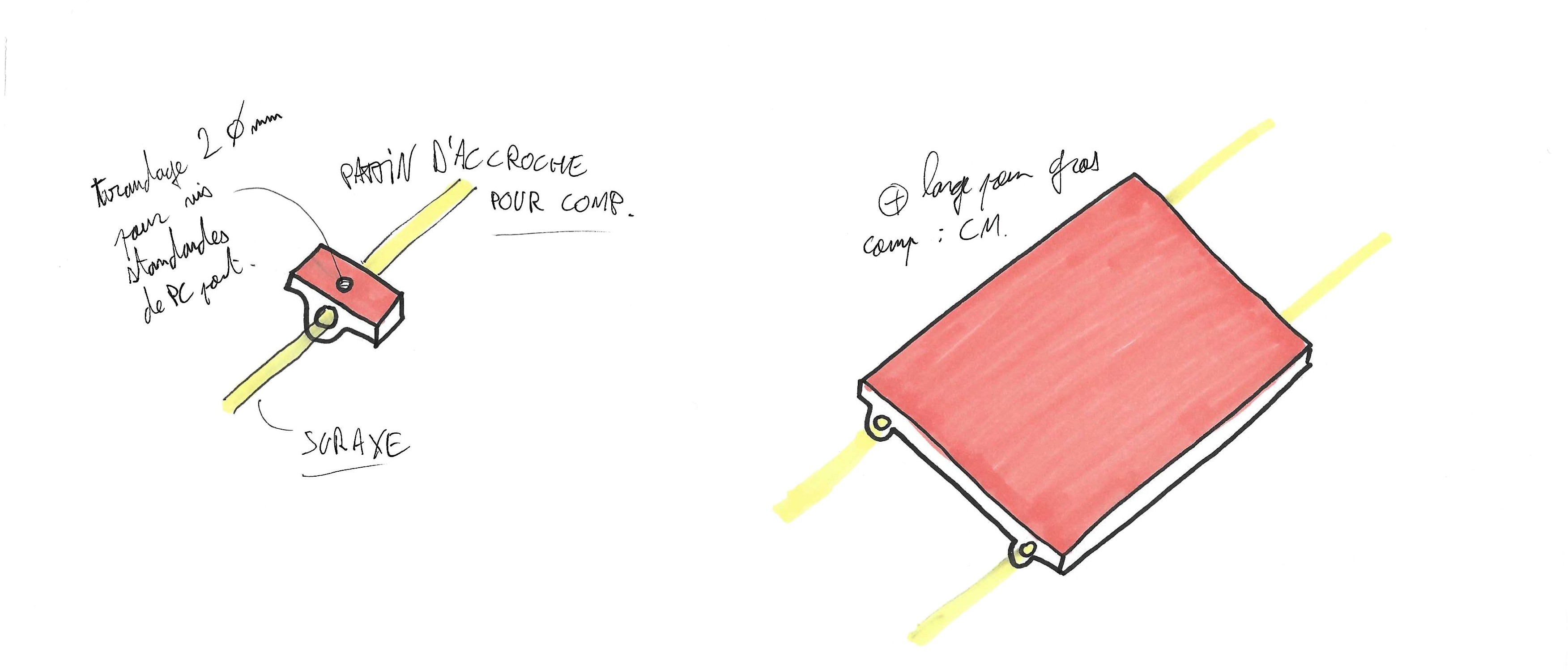

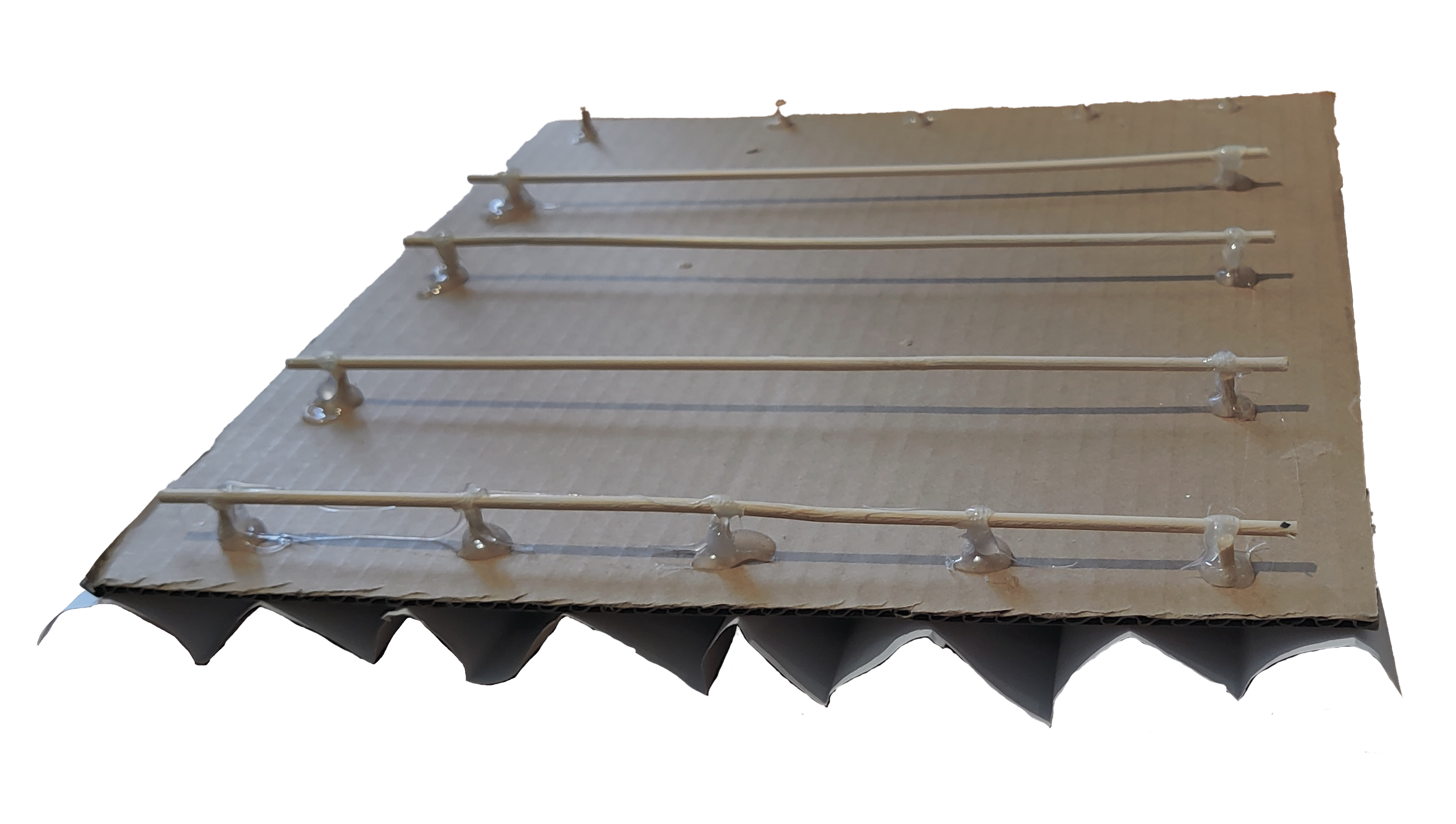
Le système d’accroche de l’organisme est la vis. En étudiant l’emplacement des vis des sept ordinateurs précédents, un nuage de point se forme. Ce nuage de point est diffus. Seuls quelques-uns sont conglomérés dans les coins supérieurs, il s’agit de l'emplacement des charnières. La taille de ce nuage de point est représentée par l’encadré noir. Celui-ci est long de 360 mm et large de 250 mm.
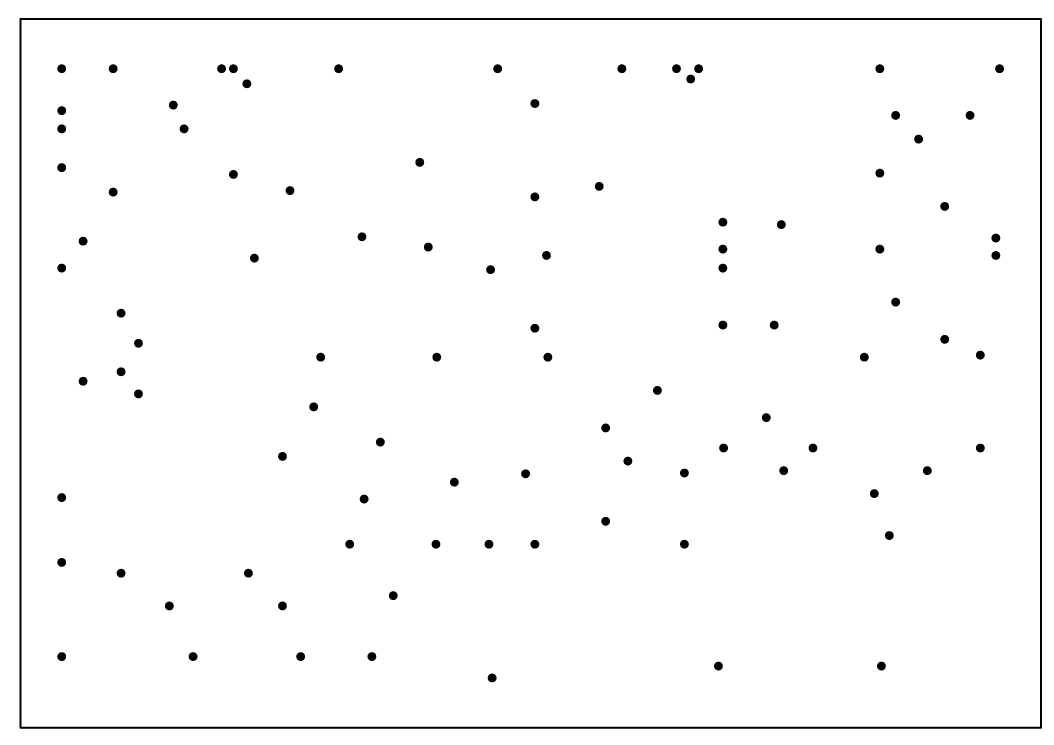
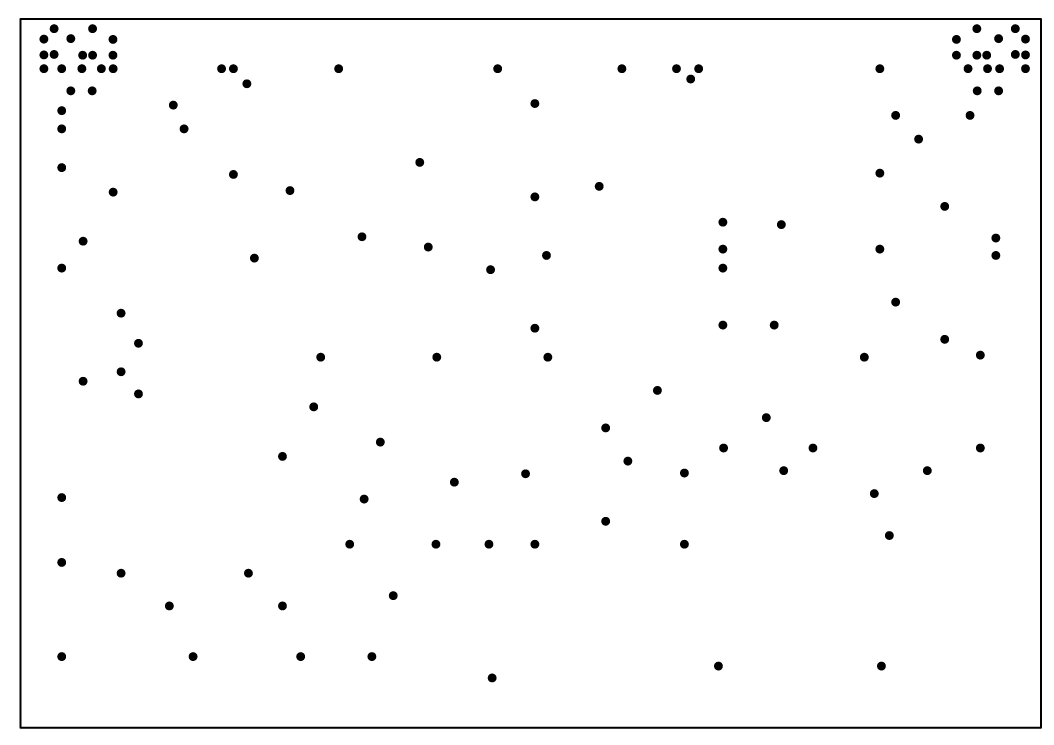
À partir de ces données standards (processeur et nuage de vis) nous pouvons envisager une grille typique. Les composants à refroidir des sept ordinateurs portables coïncident pratiquement à la grille. 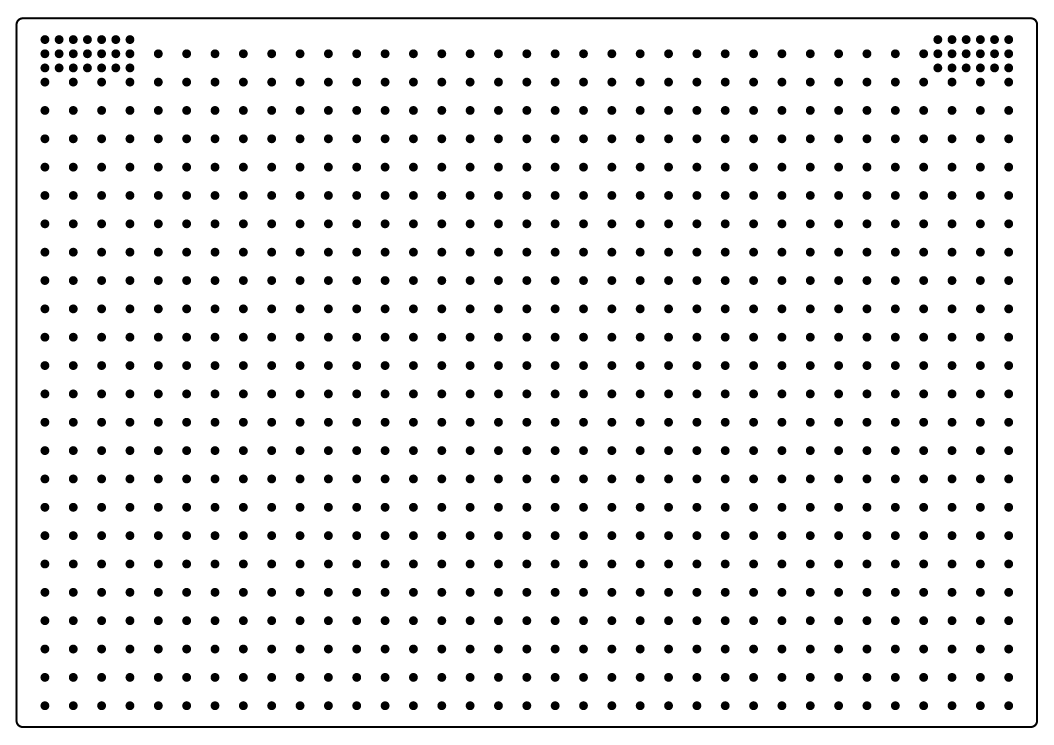
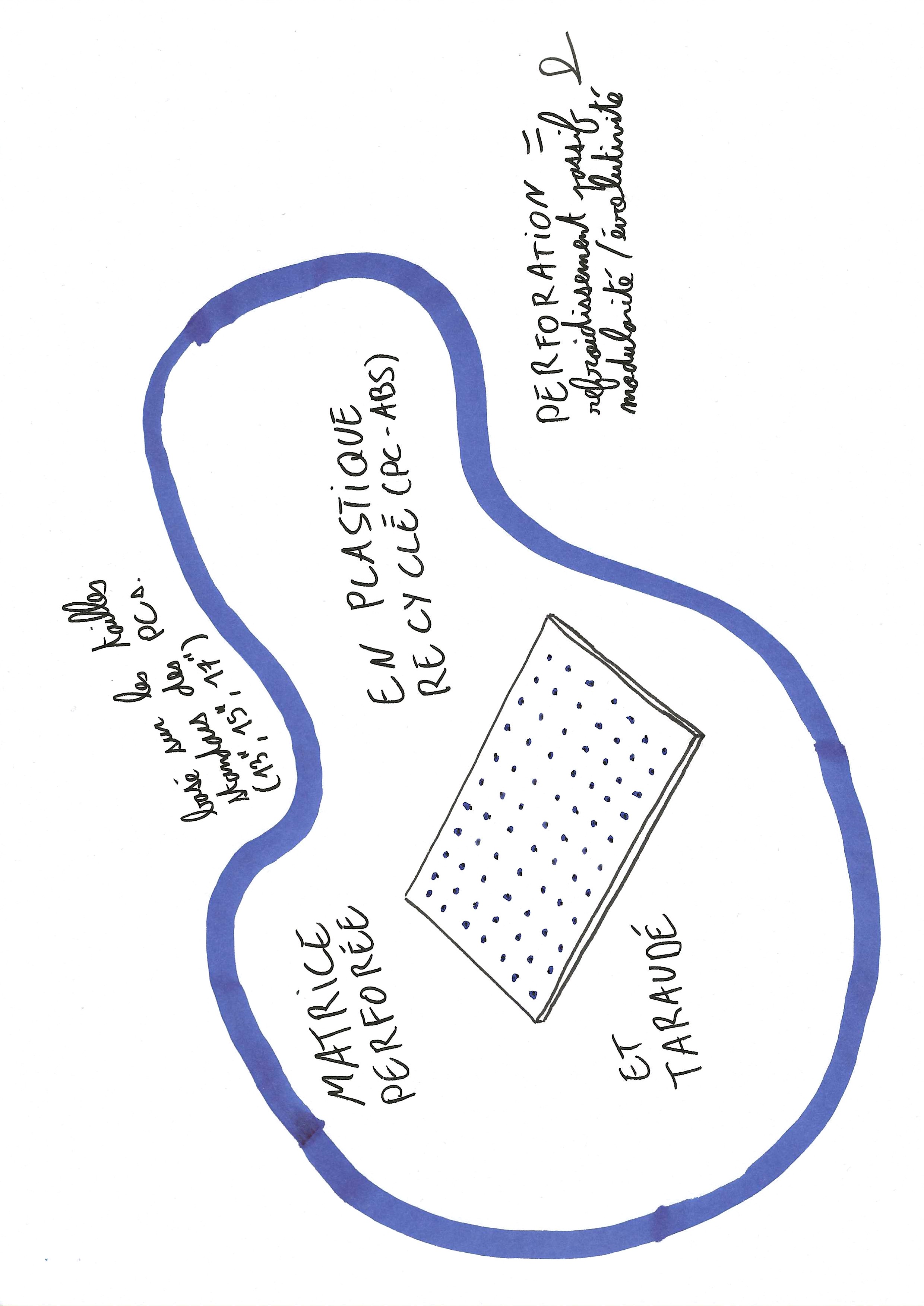
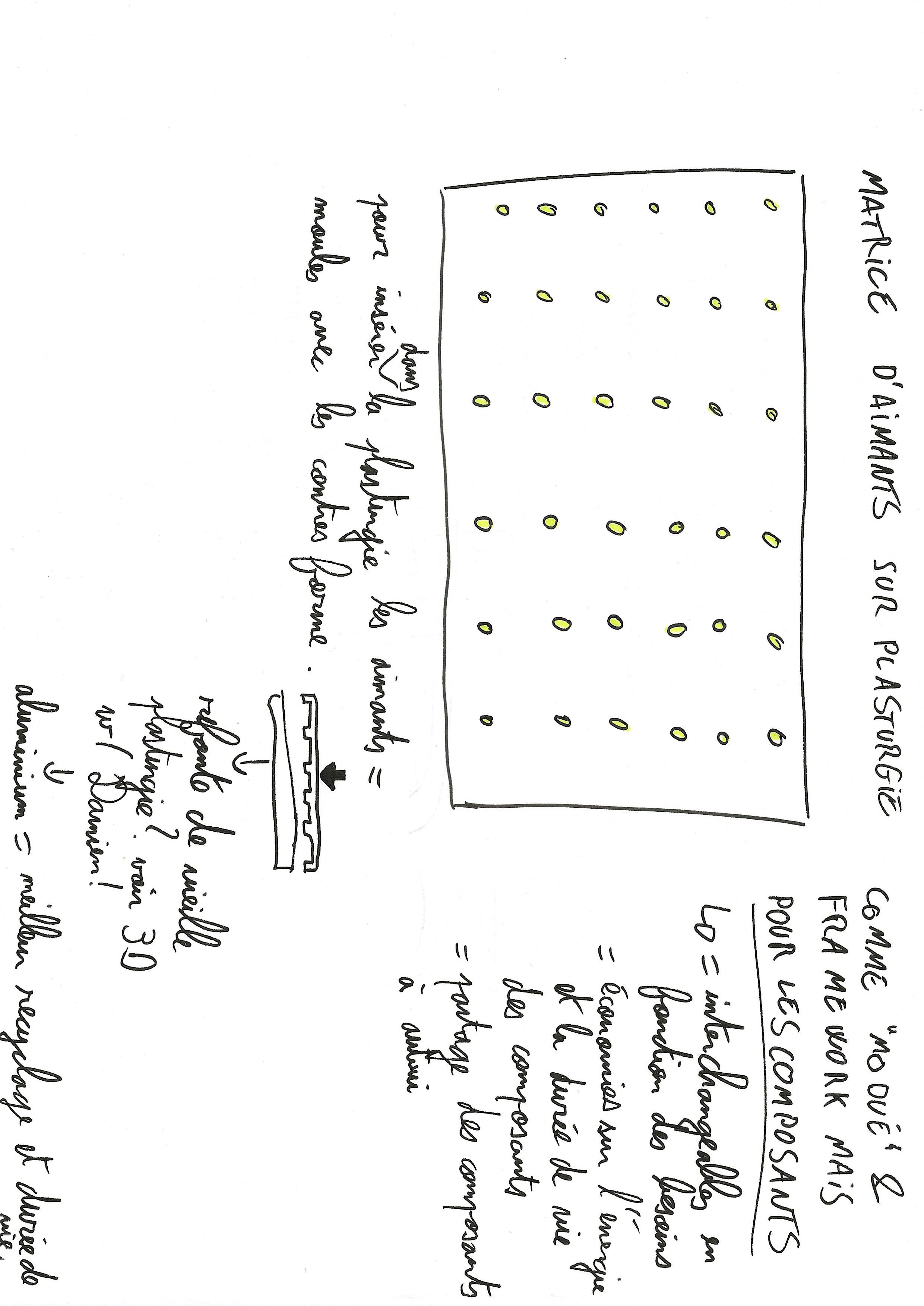
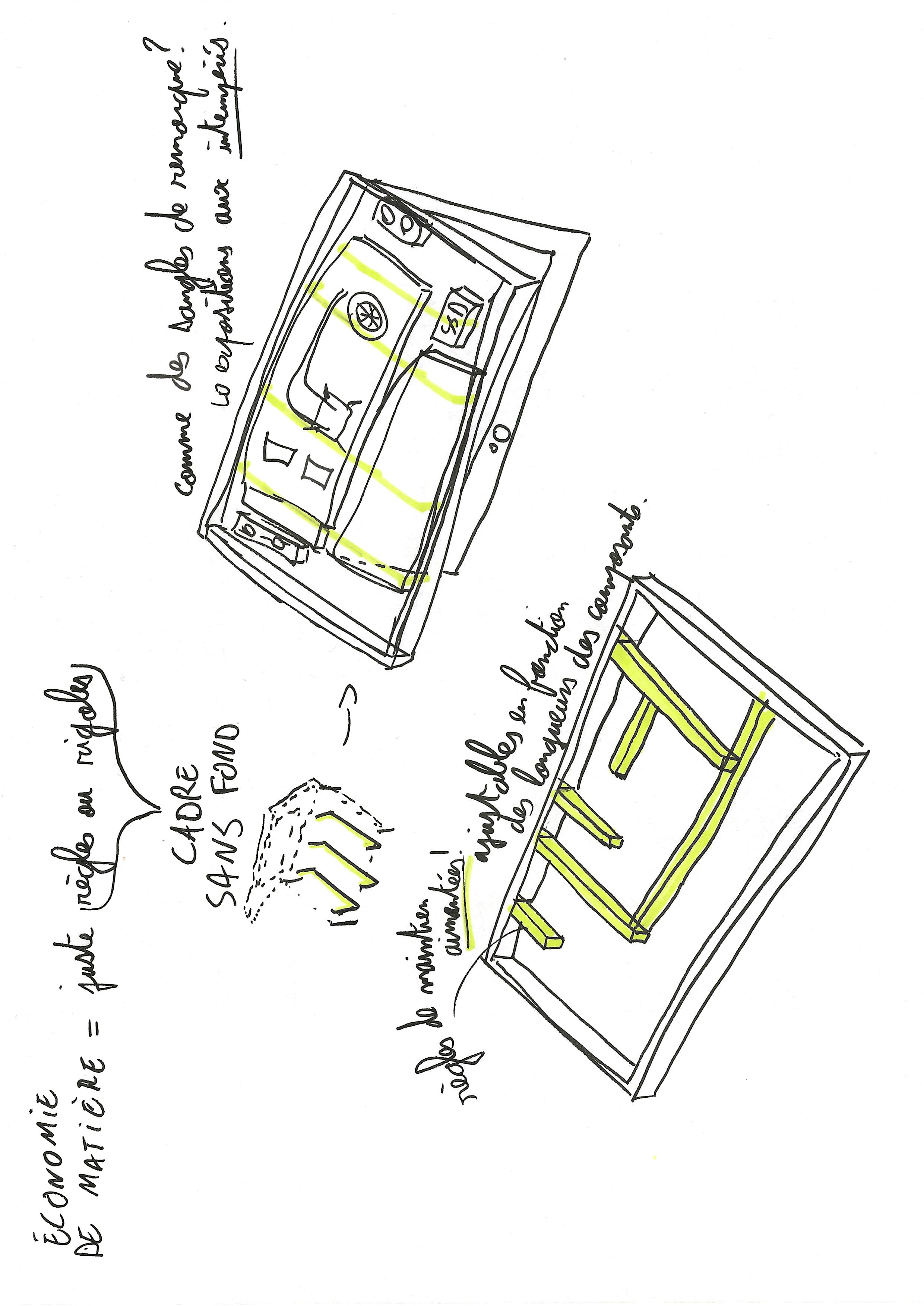
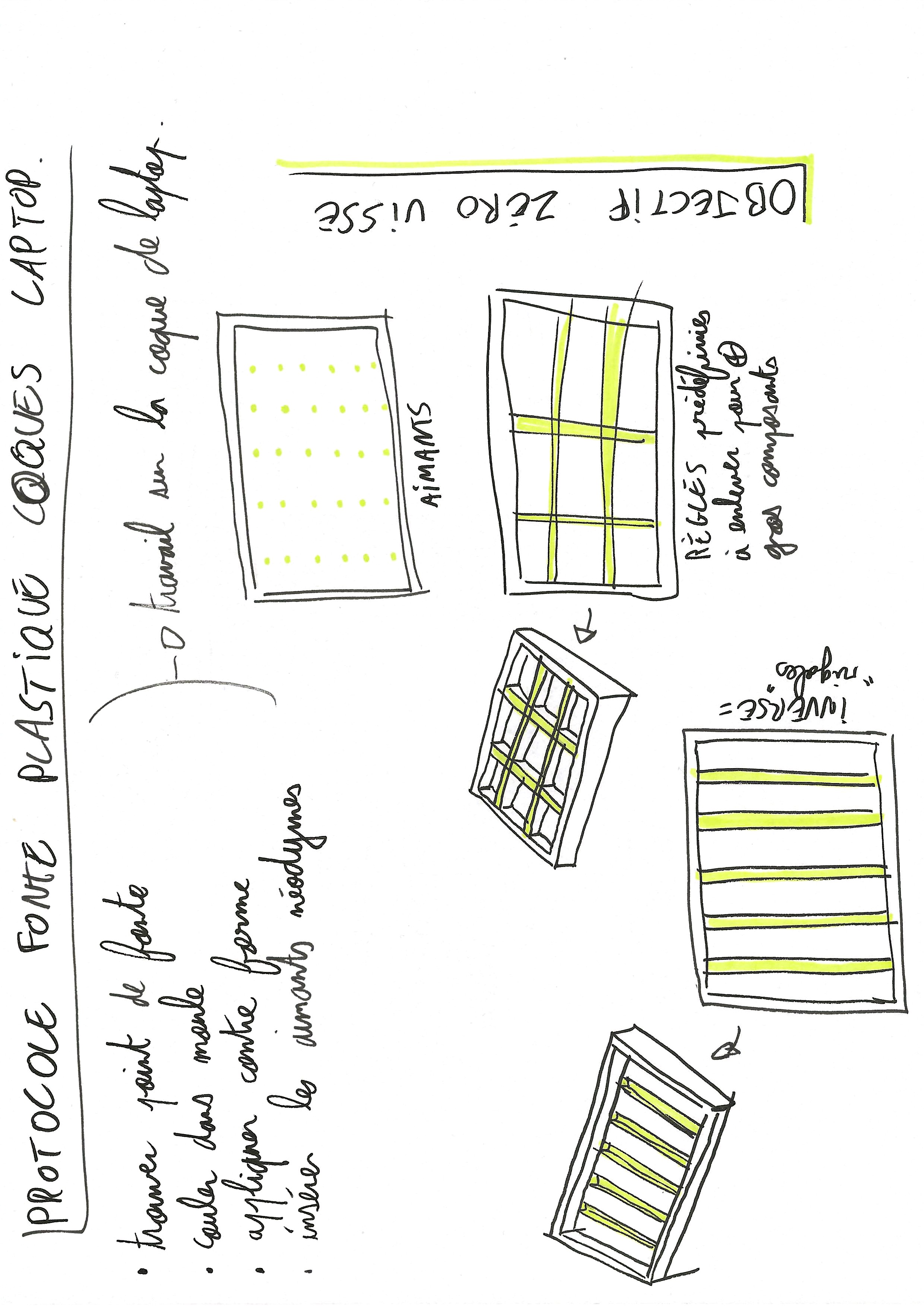 <
<
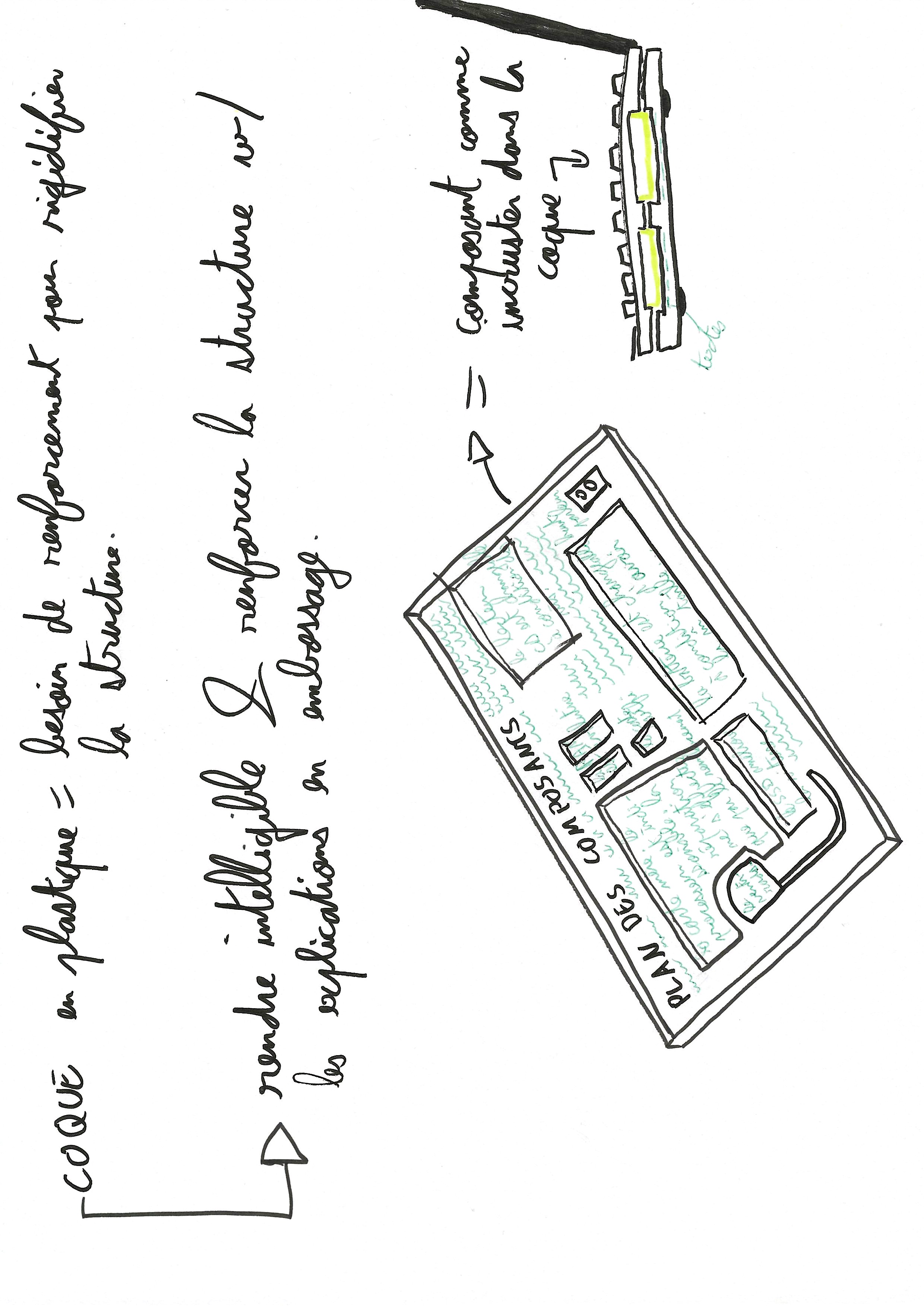
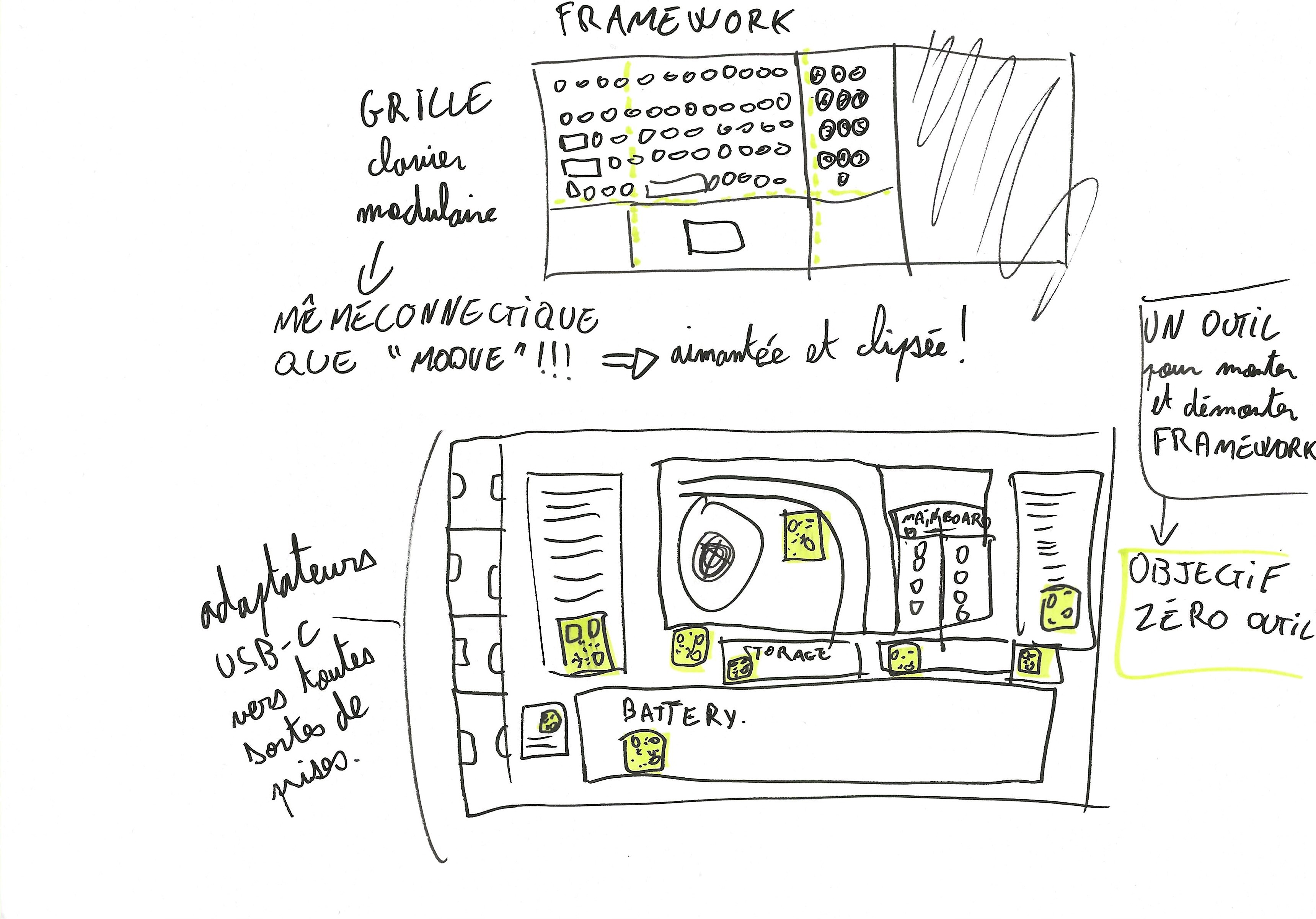
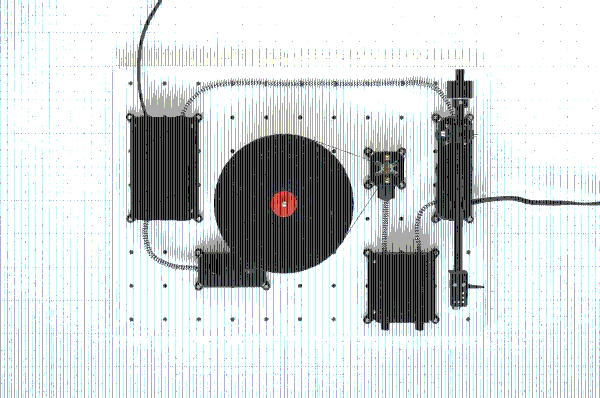
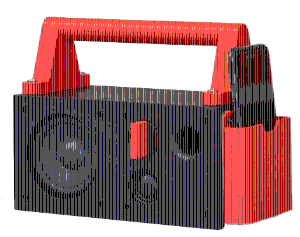
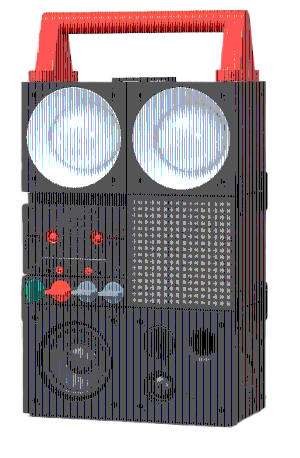
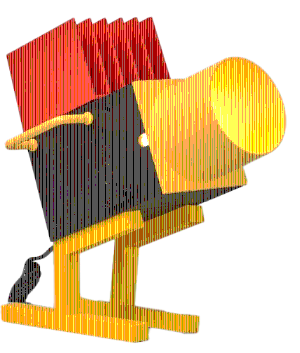
La typification des composants à refroidir à partir de la grille de nuage de points est donc également nécessaire, à la manière des jouets d’assemblage pour enfants. Pour satisfaire un large panel de cas de figures, il faut créer plusieurs pièces rectangulaires ou triangulaires capables de ne faire plus qu’un avec la matrice. 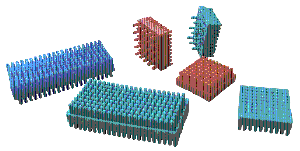
Quelques jouets Picot rabotés afin de tester de nouveaux assemblages
Alt est une grande source d’inspiration à la différence que celui-ci est une unité centrale combinée. Les composants sur mesure sont enfermés à l’intérieur de Alt. Pour créer la jonction thermique entre les organes chauffants et la coque, Brice Genre a imaginé un système de « pontets ». Cette excroissance interne de la peau touche le processeur. Accompagné d’une pâte thermique, le pontet est capable d’absorber les calories pour les diffuser sur toute la surface de la coque en aluminium. 
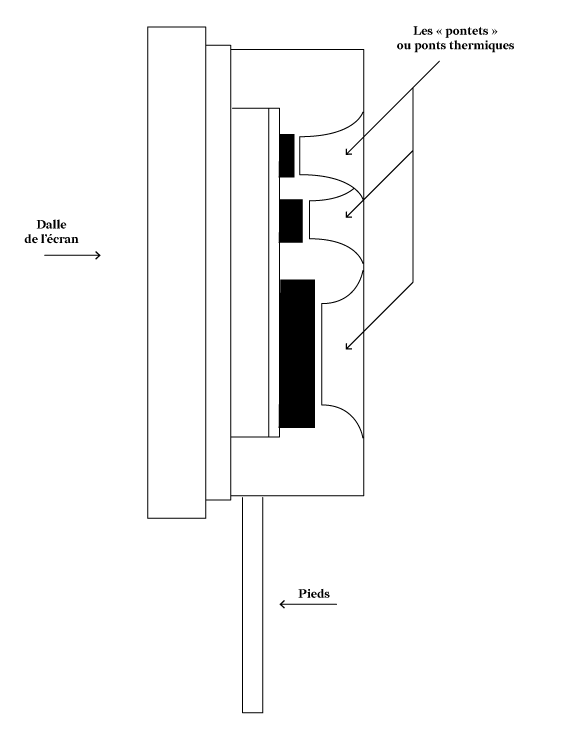
À l’inverse de monsieur patate et de la matrice sur laquelle sont composés les éléments, Alt utilise ses organes comme forme première de sa peau. Le pontet doit alors être conçu différemment. Comment faire une jonction entre la coque en aluminium et l’organe à refroidir ? La réponse réside dans la matrice qui devient la peau et le pontet qui s’accorde grâce à un système d'emboîtement mâle / femelle. Des projets extrêmes comme le boîtier d’ordinateur SG10 utilise le refroidissement passif pour les tours ultra haute performance. Le refroidissement devient partie intégrante du boîtier. Le parti pris est radical et osé mais fonctionne parfaitement. 

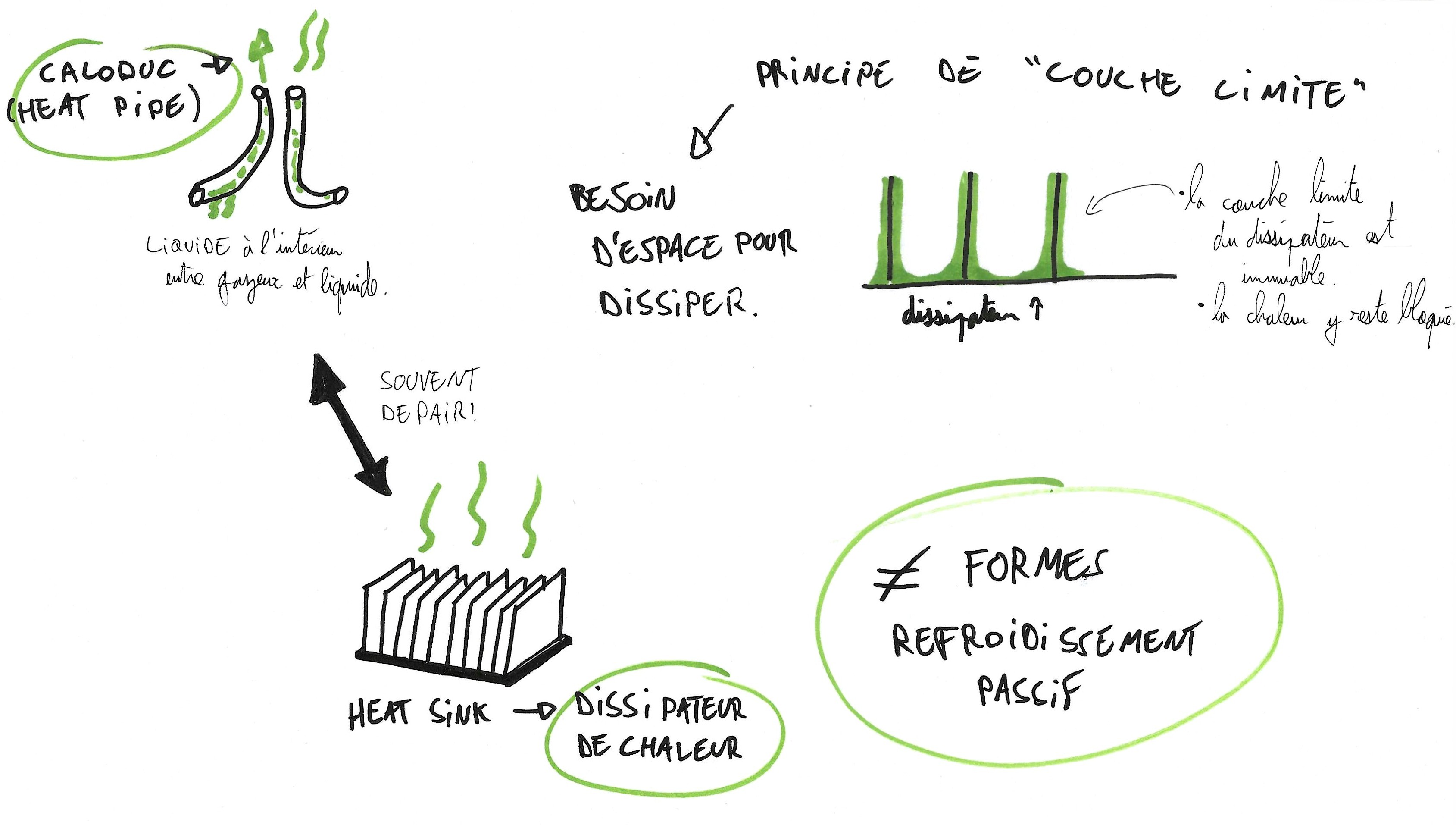
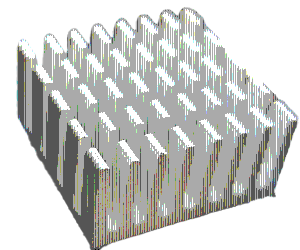
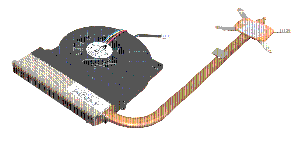
Ici en bois, les rainures fragilisent la pièce, la faute au fil de la matière. À plus grande échelle, le constat est le même. Les rainures sont plus longues et d’autant plus fragiles, voire parfois cassantes. Leur assemblage est impossible. Les mêmes pièces en aluminium n’auraient pas les mêmes contraintes techniques, permettant facilement leur assemblage. 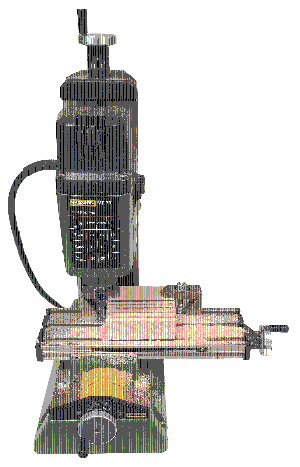

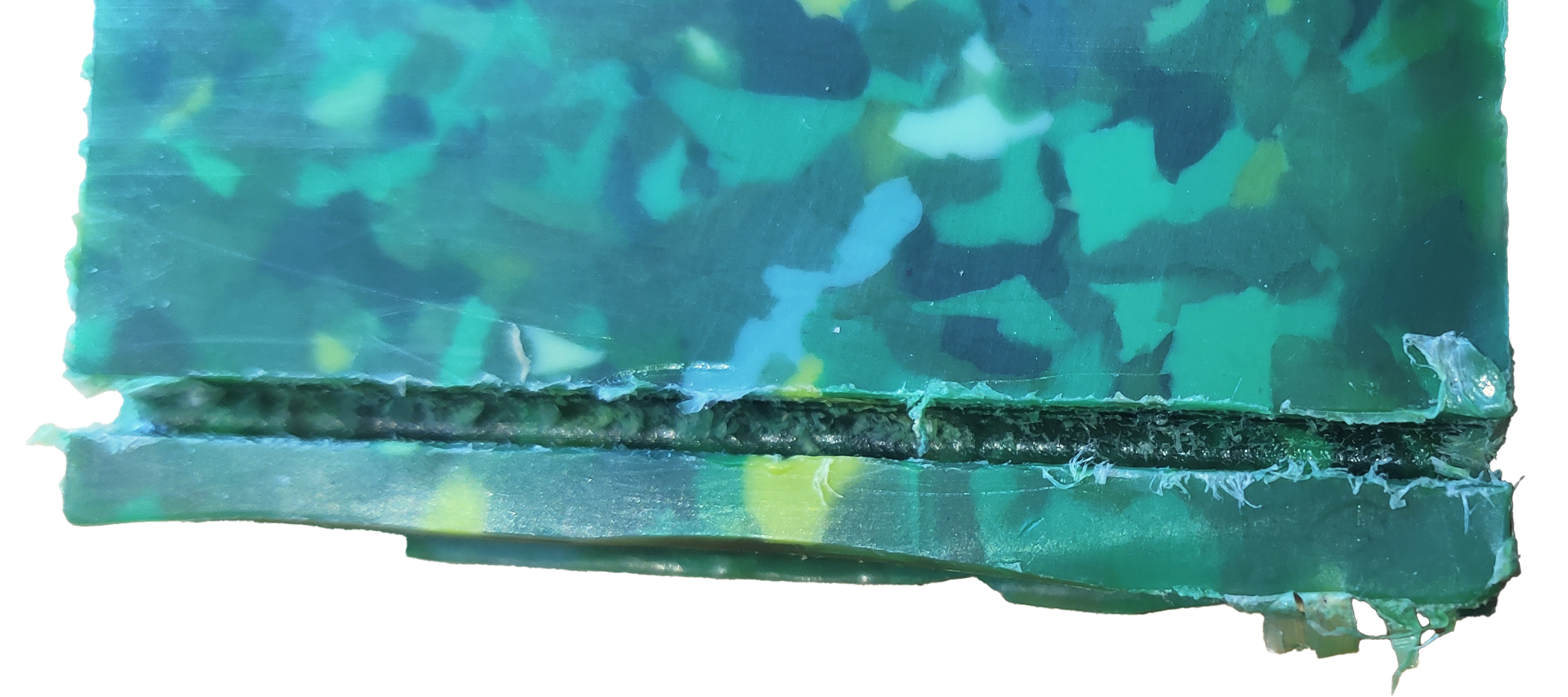
Ci-contre des essais infructueux de changement de formes des dissipateurs thermiques. Les formes courbes n’ont pas leur place. La réflexion ici n’est pas autour de l’optimisation énergétique de la forme, mais plutôt envers le système d’assemblage de la matrice. Pour simplifier l’usinage, il n’y a aucun intérêt de complexifier ces formes. Néanmoins, ces formes peuvent inspirer celle de la partie inférieure de la coque. C’est à partir de ce moment que la question de l’optimisation énergétique fait son retour. Si la coque est conçue comme un dissipateur thermique géant elle-même, des ailettes peuvent être intéressantes pour refroidir plus efficacement l’ensemble. Pour abaisser encore la chauffe des composants, il est possible d’utiliser un système d’exploitation allégé comme Linux. Le processeur qui gère tous les calculs de la machine, en effectuera moins et prendra donc plus de temps à chauffer. De plus, il est possible de diminuer l’arrivée électrique initiale de l’alimentation dans le BIOS de l’ordinateur. Cette manipulation appelée le sous-voltage oblige le processeur à travailler avec moins de courant électrique de base, retardant encore une fois la chauffe.
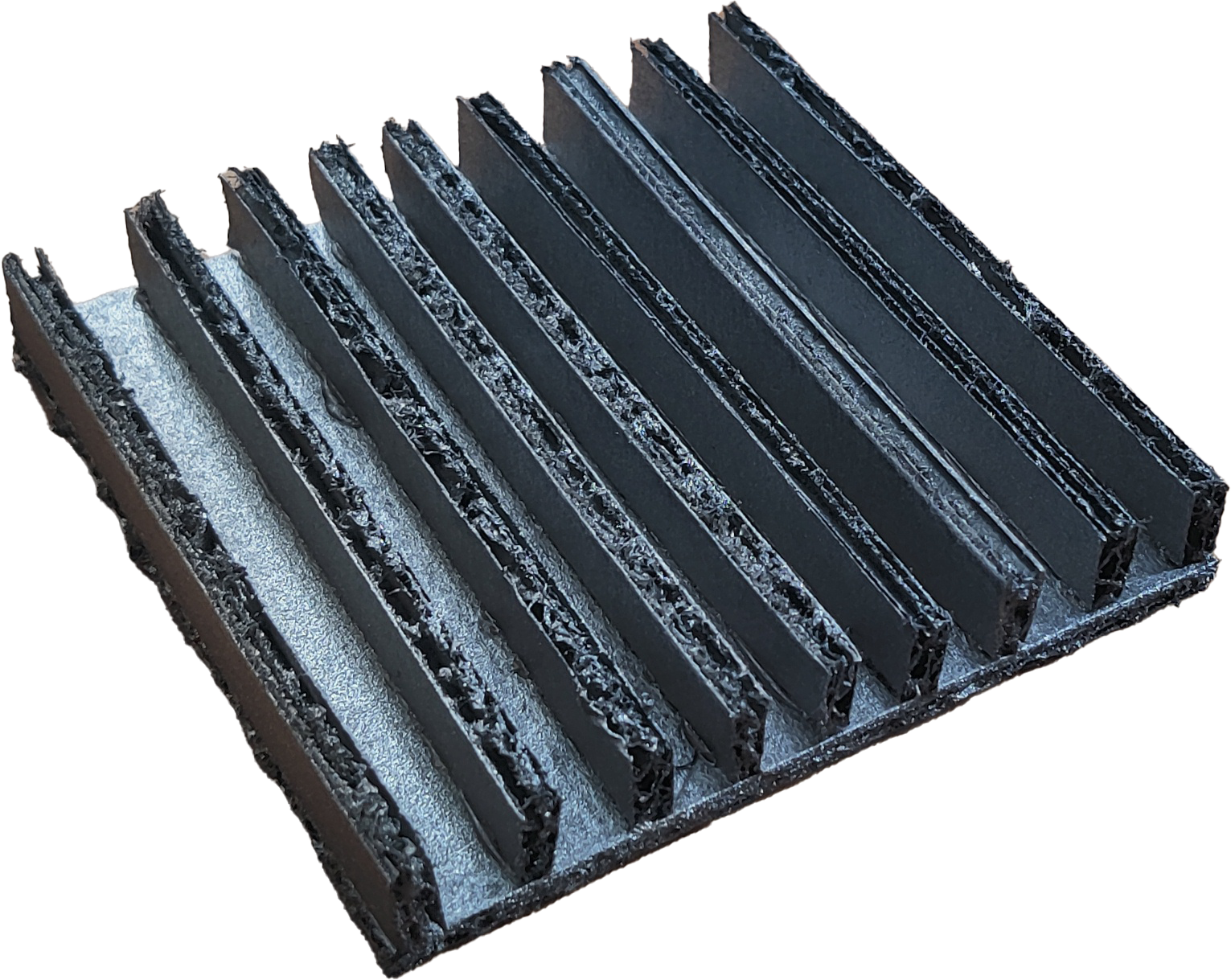
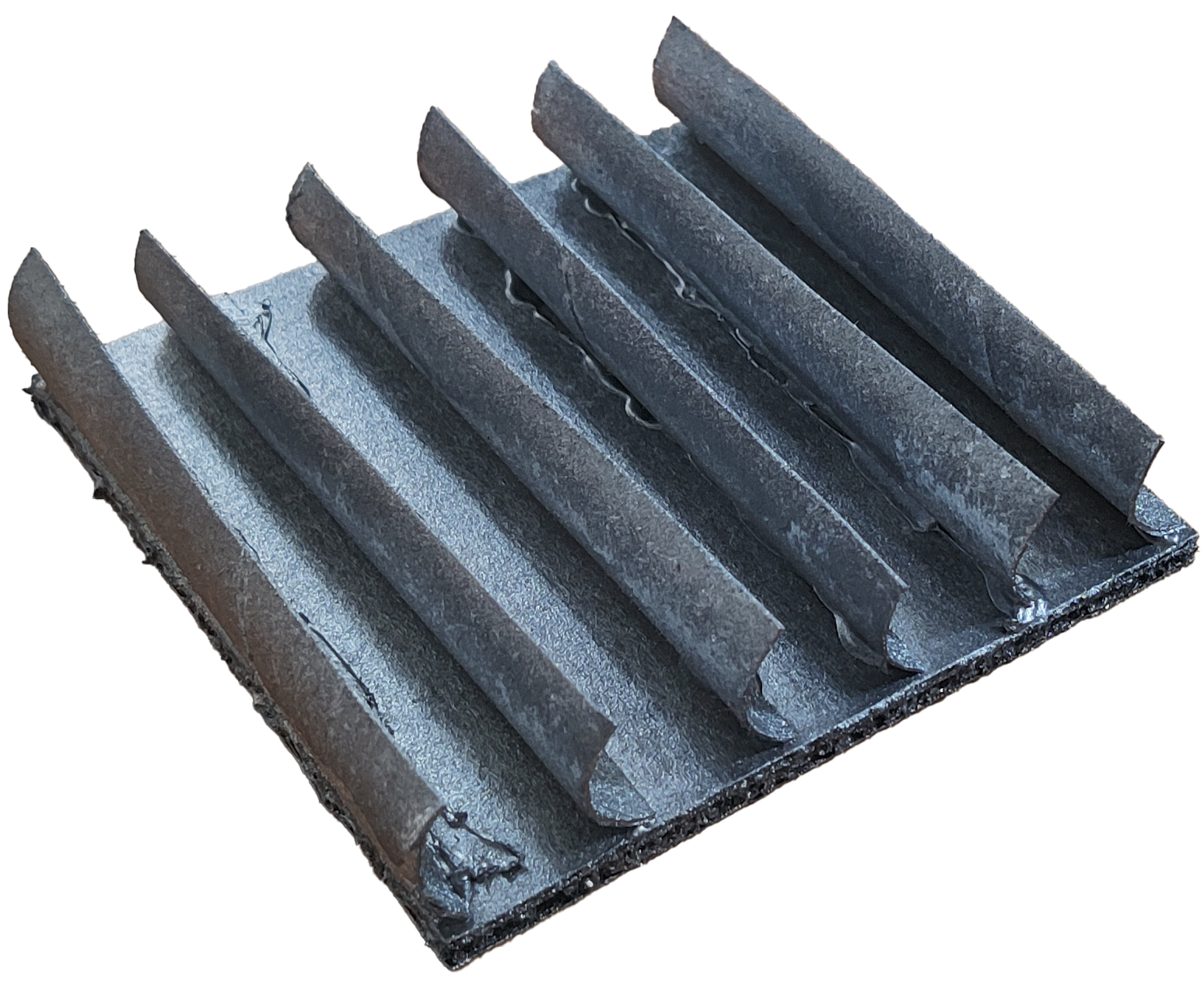
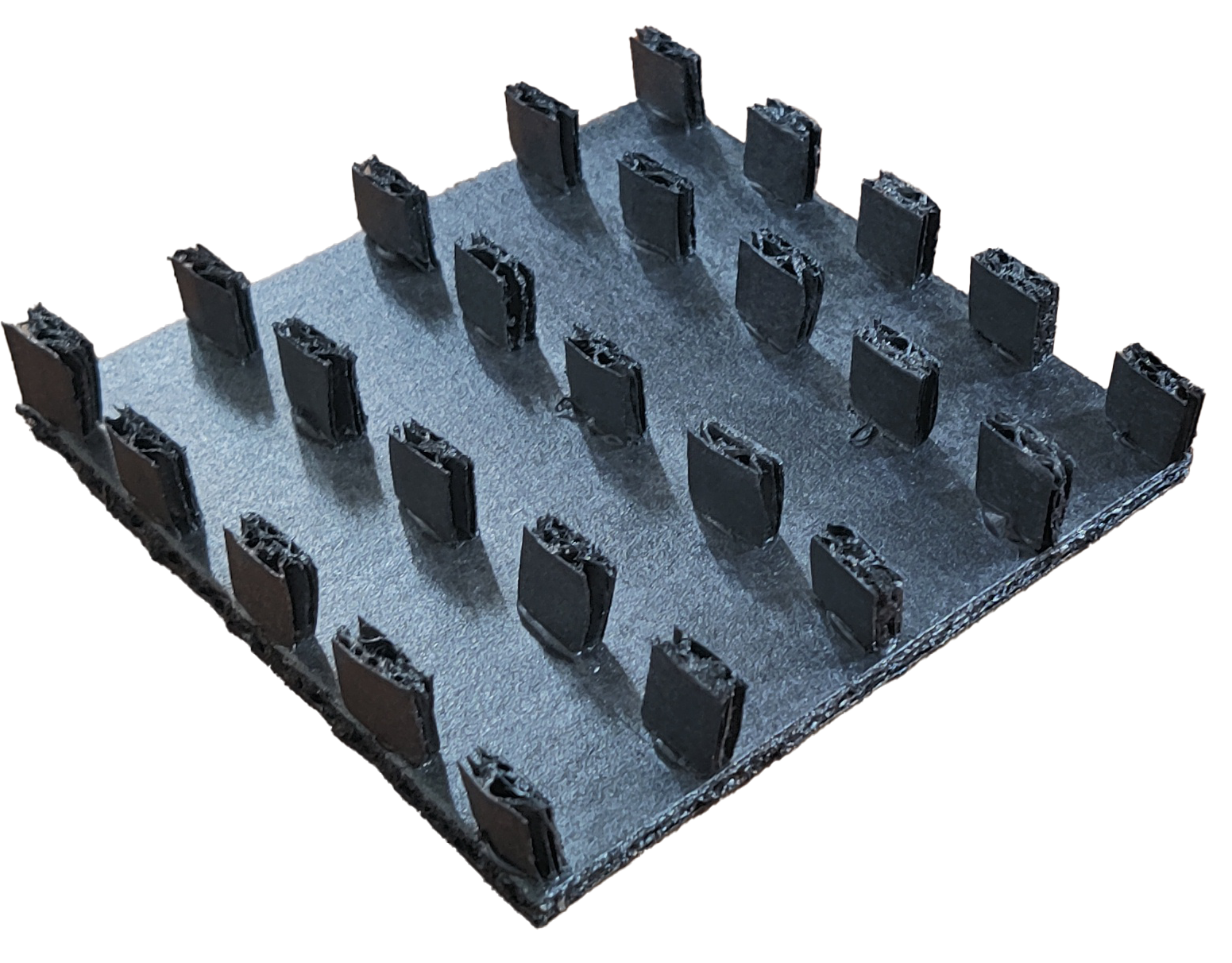
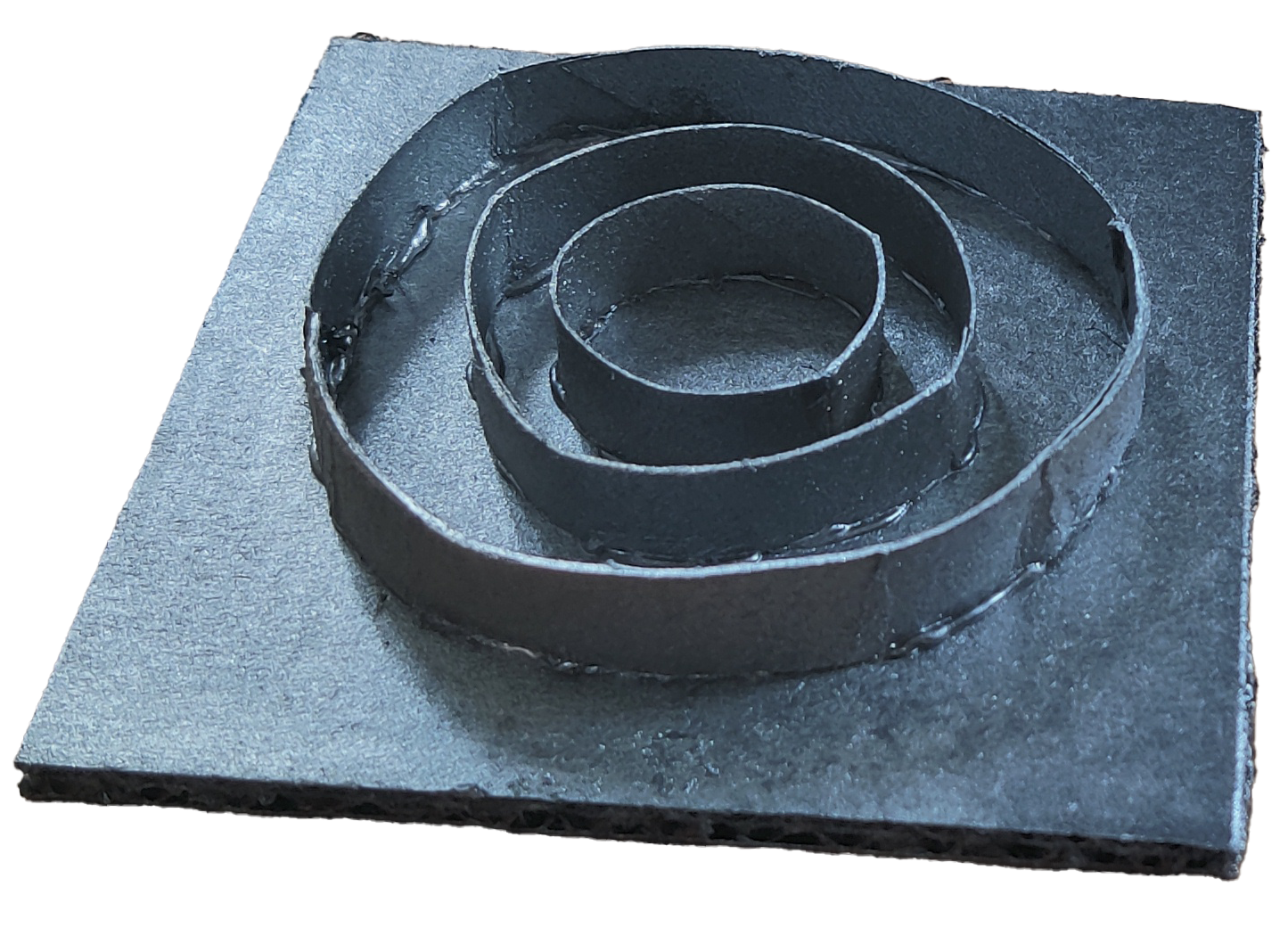
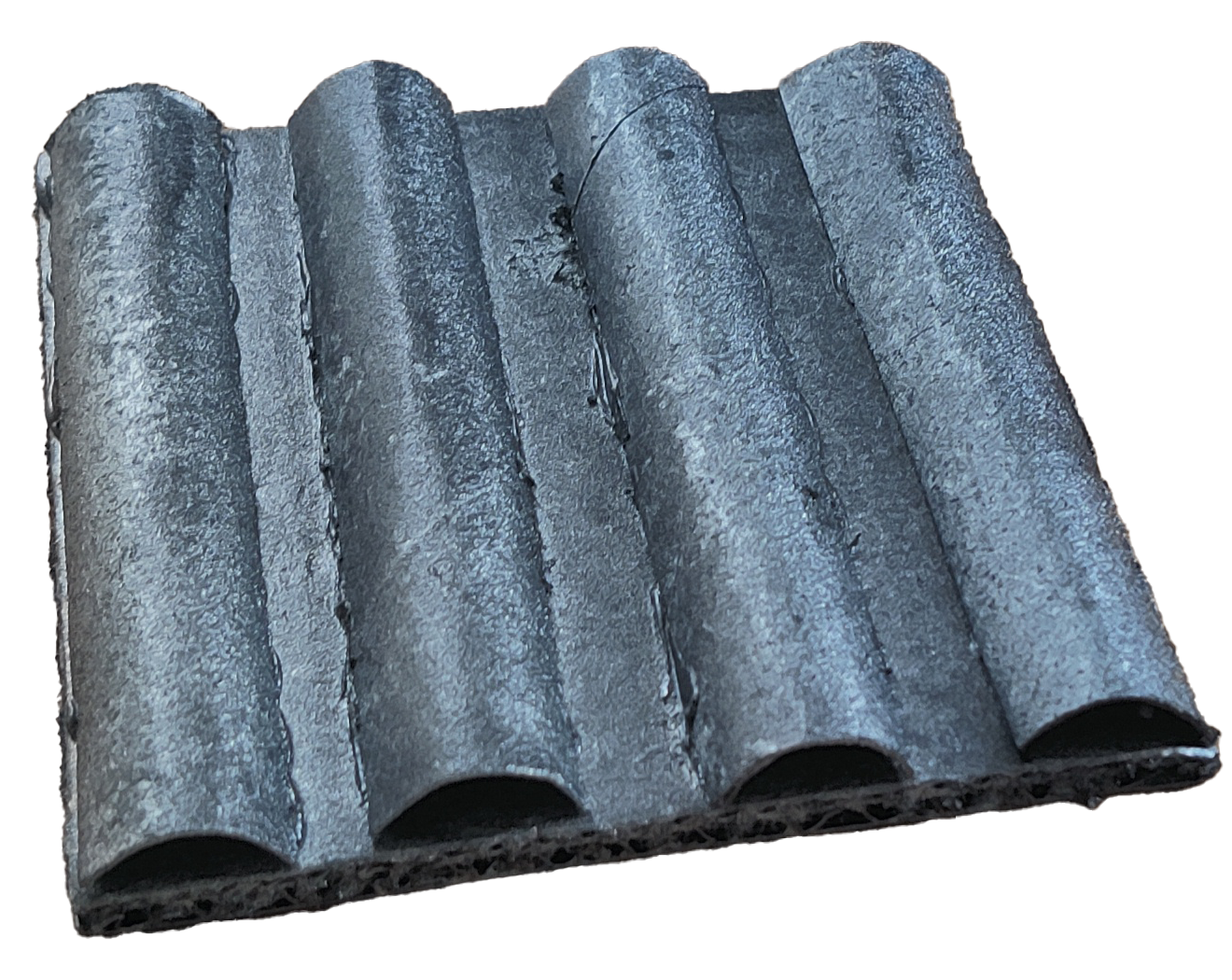
Les problématiques réelles inhérentes à l’agencement des organes peuvent se contourner grâce à la standardisation. La connectique de chacun de ses organes arrive dans un second temps. Des contraintes électroniques issues des connectiques sont tout de même propulsées aux premier plan, à savoir l’ampérage et le voltage de la machine. Ceci est régi par la carte-mère et son alimentation. Subséquemment, la batterie est difficilement adaptable à notre solution si elle ne provient pas du même squelette d’origine, de la même carte mère. Elle sera évincée de l’équation pour le moment. Il en va de même pour d’autres composants. Nous n’avons parlé que de la partie immergée de l’iceberg, et non pas de tout ce qui est de l’ordre de l’interaction usuelle avec la machine. Le clavier, le trackpad, mais aussi le bouton d’allumage, les connectiques extérieures, ou encore l’écran sont tant d’organes qui n’attendent que les points de sutures.
- 178 - « Permacomputing : une tech plus verte et durable pour réduire notre empreinte numérique ». 2024. 7 novembre 2024. https://www.angrymum.fr/le-permacomputing-quand-la-tech-sinvite-en-mode-ecolo-chez-soi/.
- 179 - « La fresque du numérique », à laquelle j’ai participé. 13 mai 2025
- 180 - Ouassak, Fatima. 2024. Pour une écologie pirate. Points Féminisite. Points. p. 96
- 181 - Zaffar, Hanan. 2025. « The Rise of ‘Frankenstein’ Laptops in New Delhi’s Repair Markets ». The Verge. 7 avril 2025. https://www.theverge.com/tech/639126/india-frankenstein-laptops.
- 182 - brian03079. s. d. « Thinkpad W701DS Lattepanda Alpha + KVM Conversion ». Instructables. https://www.instructables.com/Thinkpad-W701DS-Lattepanda-Alpha-KVM-Conversion/.
- 183- « T60/T61 FlexView FrankenPad Questions - Thinkpads Forum ». s. d. Consulté le 8 avril 2025. https://forum.thinkpads.com/viewtopic.php?t=90020.
- 184 - « OpenStructures ». s. d. Consulté le 31 mai 2025. https://openstructures.net/.
- 185 - « OpenStructures – Nicolas Hervé ». s. d. Consulté le 31 mai 2025. https://nicolas-herve-design.fr/openstructures/.
- 186 - « Frekvens ». s. d. Teenage Engineering. Consulté le 19 avril 2025. https://teenage.engineering/designs/frekvens.
- 187 - Weber, Olaf. 1982. « Über das Verhältnis von Standard und Typus in der Architektur ». https://doi.org/10.11588.
- 188 - Cf. 2. Entretien avec Brice Genre en annexes.
2. Les peaux du matériel informatique comme ouverture intelligible
La peau, la mue, le tégument ou la coque de l’ordinateur portable est indispensable pour son intégrité. C’est elle qui assure une protection lors des déplacements de la machine, qui limite l’arrivée de la poussière dans les composants, et qui de par ses formes nous plaît esthétiquement. Elle distingue son utilisateur. Lors de mon stage à la Rebooterie, j’ai été surpris par la quantité de coques d’ordinateur en plastique jeté chaque semaine. Je me suis d’abord demandé pourquoi ? Parce que le plastique est un matériau dont nous avons dompté le processus industriel depuis plusieurs dizaines d’années, et qui est, de surcroît, bon marché. Les caractéristiques techniques du plastique lui permettent d’être mélangé. Le composite ainsi obtenu est gagné en capacité mécaniques. Je me suis questionné s’il n’était pas possible de les recycler en de nouvelles coques d’ordinateurs. Le plastique qui compose ses peaux se trouve être en grande majorité composées de PC-ABS (polycarbonate acrylonitrile butadiène styrène). Ce composite de plastique est idéal pour nos appareils électroniques. Le polycarbonate permet d'abord une grande résistance à la chaleur, parfait pour tempérer les composants et éviter que ces derniers fasse fondre la structure de notre objet. L'acrylonitrile butadiène styrène, lui, est facilement malléable pendant l’usinage. En fin de chaîne, il est léger, rigide et à une bonne tenue aux chocs.
En usinant des copeaux de PC-ABS issus de coques, j’ai essayé de reformer des plaques réutilisables par la suite. Le premier essai avait pour but de tester la résistance à la chaleur du PC-ABS, sachant que sa température de fonte est située à 250°C. Des copeaux brisés de coques d'ordinateurs à la main rassemblés sous les charnières d’un gaufrier pour tenter de les « ressouder », ou en tout cas de reconstituer une plaque. Les brisures se sont effectivement ressoudées. Cependant, la température de chauffe n’était pas suffisante, ou les brisures étaient trop grosses. Toutefois, la pression du moule à gaufre permet une surface plane et relativement lisse. La structure reste fragile, les résistances mécaniques sont faibles. Traction, compression, ou torsion laissaient entendre de malheureux craquements de douleurs. Il faut que le broyat soit plus fin et mélangé. De cette manière, la chauffe sera plus homogène et les copeaux formeront une structure rigide. La pression permet à la fois d’aider à la fusion des brisures, ainsi qu’à l’aspect final de la pièce. On pourrait alors imaginer une presse en relief pour texturer la pièce ou même la signer, par exemple.
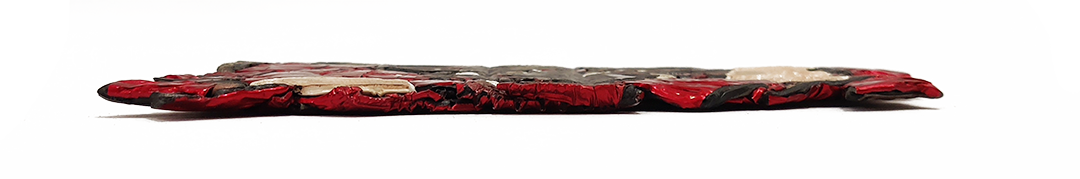




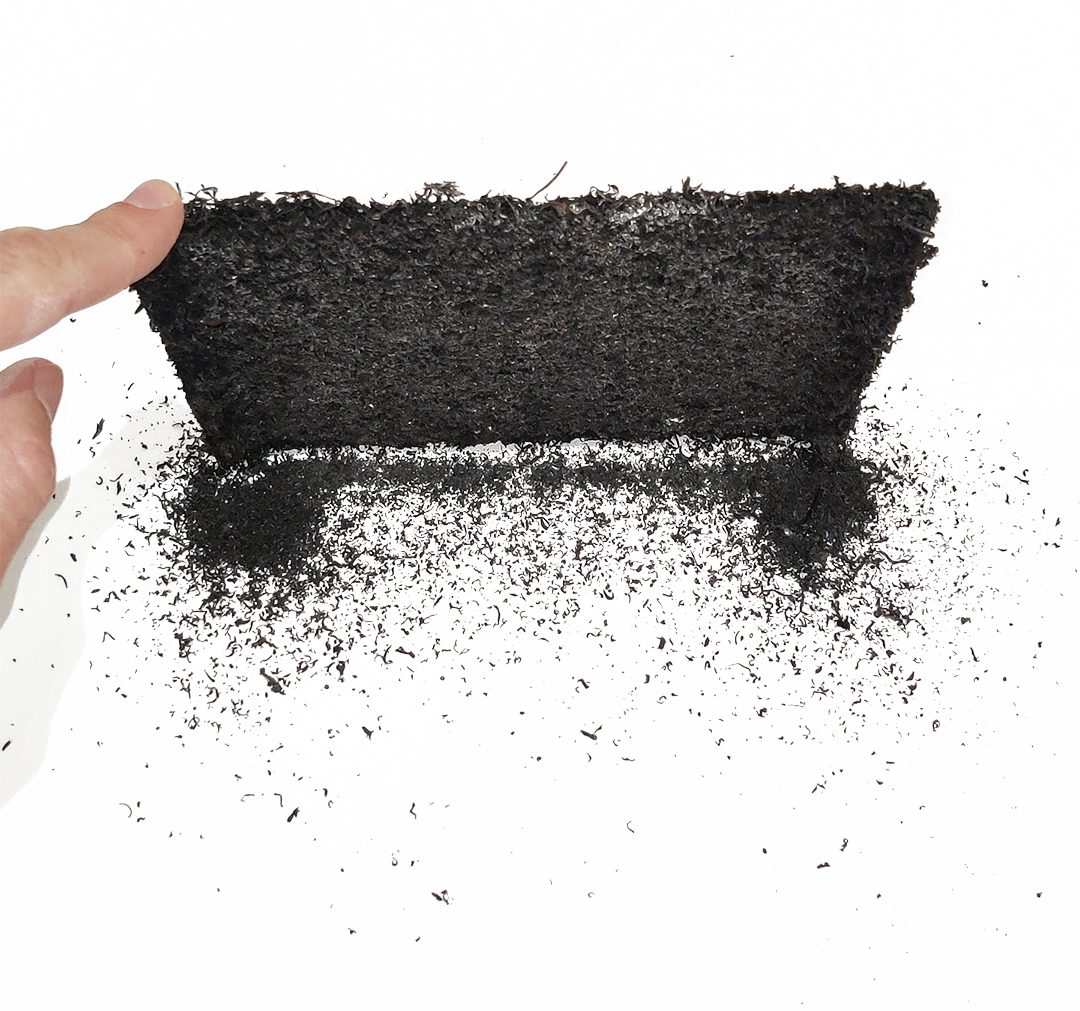

Quelques remarques à l’issue de ces essais. Le volume de copeaux doit être plus important que le volume de la pièce finale à cause de la compression, il conviendrait de calculer précisément le volume de la plaque souhaité vis-à-vis du grammage de la quantité de broyat. Des copeaux homogènes ainsi qu’un refroidissement sous presse sont préférables pour ne pas que la pièce finale se voile. La force des mains, même sur ces pièces de petite taille n’est pas satisfaisante.
Une autre technique, celle du moulage en plâtre, habilite à la création de séries de pièces. Créer un moule en plâtre de fonderie permet de reproduire facilement une série d’objets en conservant des détails précis à chaque reproduction. Ce procédé est moins coûteux que les moules métalliques et est idéal pour de petites séries ou des prototypes. Le plâtre peut être façonné facilement et résiste aux températures de certains métaux à bas point de fusion. Pour notre PC-ABS et son point de fonte à 250°C, ceci est amplement suffisant.
Le moule en plâtre s’est brisé, à cause des vibrations et des déplacements qui ont dû le fragiliser, mais surtout car ce processus est plus adapté à la coulée que pour la presse. Il est toutefois intéressant de noter que les cassures se sont ouvertes sur les points les plus fragiles, à savoir là où l’épaisseur du moule est la plus fine. Le moule en plâtre est très intéressant pour produire des séries d’objets. Il convient toutefois qu’il soit irréprochable, ce qui n’était pas mon cas. Les trous d’éjections de la pièce avaient été perforés en ligne, ce qui fragilise le moule. Ces derniers ont été refaits en triangle, encore une fois par trois. Deux auraient été suffisants. La plus grosse contrainte du moule en plâtre était lors de la chauffe. Son épaisseur empêchait les copeaux de chauffer correctement. Il faudrait alors peut-être perforer ou micro-perforer le dessous du moule pour laisser passer la chaleur. Cela semble beaucoup d’usinage. Une autre solution serait de créer un moule en deux pièces, qui servirait à injecter la matière. Ainsi, le problème de chauffe est résolu puisqu’il se déroule dans un premier temps. Dans le second, la matière chaude et malléable est injectée dans le moule. Il faut cependant injecter à plusieurs endroits afin que la matière se répande effectivement. L’injection peut aussi résoudre les deux autres observations. La première par rapport au pressage des pièces à la sortie du four. Cette étape est évitée en utilisant l’injection. Le moule en deux parties peut aussi être texturé. Des calculs de volumes auraient permis de comprendre en profondeur les résistances mécaniques. Le rapport entre le volume initial et final de copeaux est aussi évité avec l’injection, puisque la matière injectée est déjà homogène. Aussi, les copeaux doivent être déchiquetés de manière automatique à l’aide de machines dédiées pour obtenir une matière homogène. Enfin, une presse à vérin est obligatoire pour le refroidissement à froid.
Afin d’améliorer mon expertise autour du plastique et de son processus de recyclage, je suis allé à la rencontre de Marlène dans son atelier, au sein de l’association Cadavres Exquis, à Toulouse. L’association est basée au quartier Bellefontaine et prend place chez les Imaginations Fertiles. « Acteur historique de l’écosystème des tiers lieux et du design social à Toulouse et en Occitanie depuis 2012, la SCIC les Imaginations Fertiles a développé et anime aujourd’hui un tiers lieu au cœur du quartier du Mirail à Toulouse favorisant l’échange de compétences et le développement de projets collectifs entre acteur.rice.s de l’innovation sociale, de l’artisanat, du design, habitant.e.s, les collectivités et entreprises locales. Elle sort aussi de ses murs pour animer ou accompagner une multitudes de projets sur des territoires et thématiques variées mais toujours engagées… » 1 L’endroit dans lequel est basé Cadavres Exquis est parfaitement adéquat au développement de l’association.
Au-delà des ateliers de sensibilisation, Marlène travaille le plastique en plaque. Après les étapes de récupération, de nettoyage dans sa machine à laver elliptique, de tri par catégorie, de trie par couleur et de broyage, elle utilise sa presse à t-shirt pour presser des plaques de plastique. Ces plaques sont composées soit de PP (polypropylène), soit d’HDPE (polyéthylène haute densité). Respectivement des thermoplastiques utilisés par exemple pour les bouchons ou pot de yaourts et pour les bouteilles de lait ou flacon de lessive. Leur abondance dans notre quotidien est flagrante. Les réemployer en tant que puits de pétrole déjà extrait reste une solution à moyen terme. L’idéal serait de trouver une solution à ces plastiques.



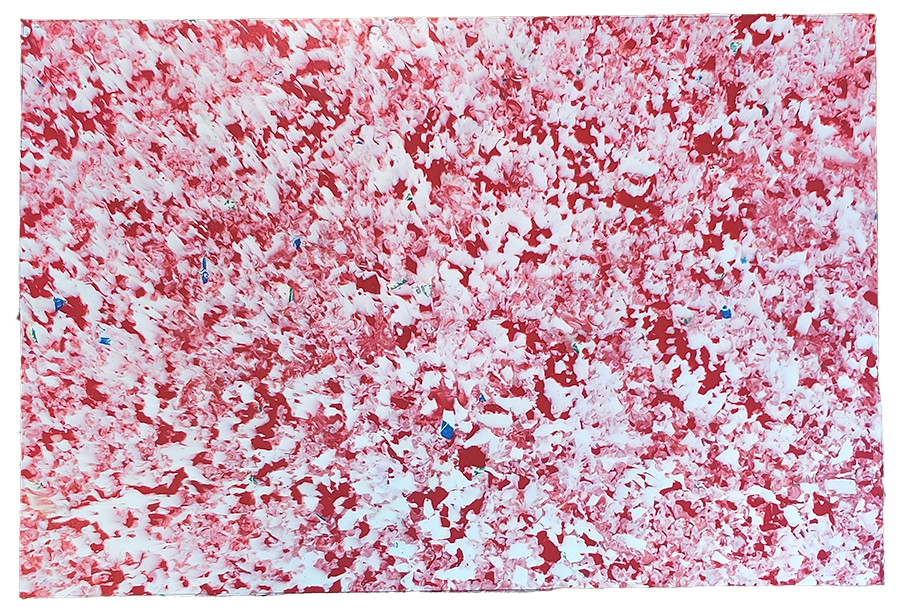
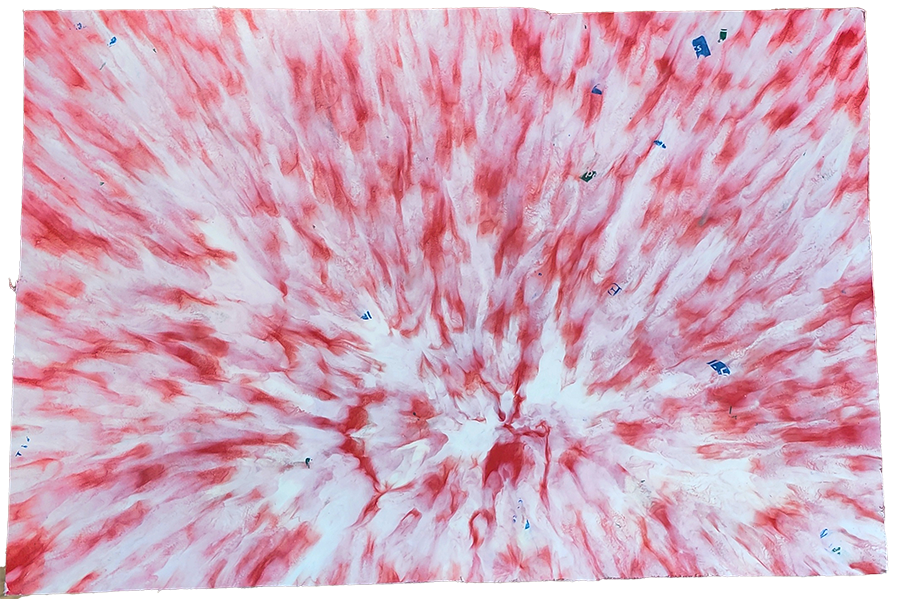
En attendant, les plaques de Marlène m’ont éclairées sur le mode de production de Strata, l’ordinateur Frankenstein. Pourquoi ne pas simplifier, pour ne pas dire standardiser la peau de l’ordinateur en plaques ? Il serait tout l'inverse de cette coque qui épouse la forme des organes d’un Raspberry Pi, ce qui contraindrait fortement l’évolutivité de l’appareil. Ainsi, une plaque inférieure viendrait recueillir les composants, et une autre supérieure viendrait emprisonner les tout. Cette idée, Méta IT et son ordinateur Alt l’on appliqué. Est-il alors possible de recycler les anciennes coques d’ordinateur portable en nouvelle plaque ? La réponse est négative, du moins à l’échelle de Cadavres Exquis. Les additifs présents dans ces plastiques sont trop disparates entre eux et ne permettent pas une recomposition saine de plaque. 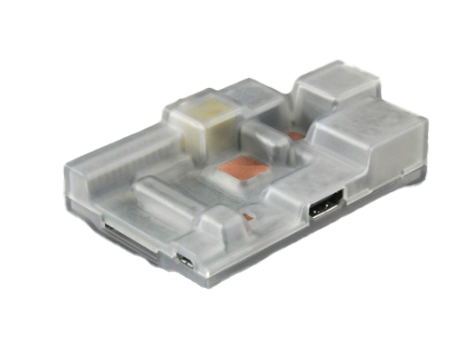
Le matériau plaque recyclé (PP ou HDPE) est usinable comme du bois. Si la partie inférieure de Strata est en aluminium afin de conduire et de dissiper la chaleur, la partie supérieure peut être en plastique recyclé. En plus d’apporter un esthétisme unique pour chaque Strata, le plastique sert d’isolant thermique entre l’utilisateur et la chaleur généré par les organes. Teenage Engineering utilise le principe de la plaque, également pour un ordinateur. 
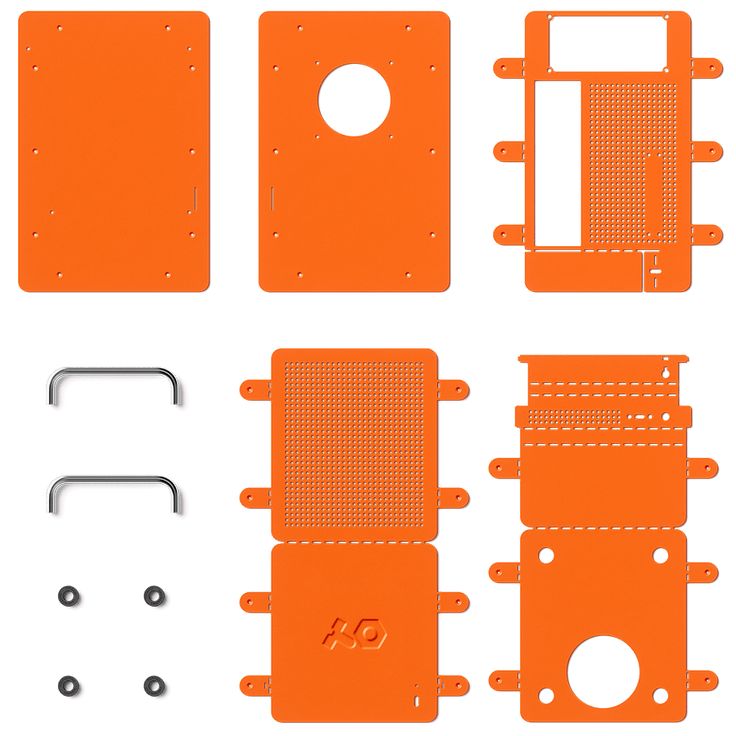
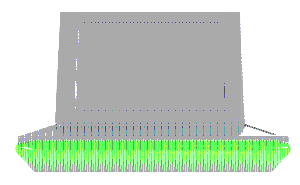
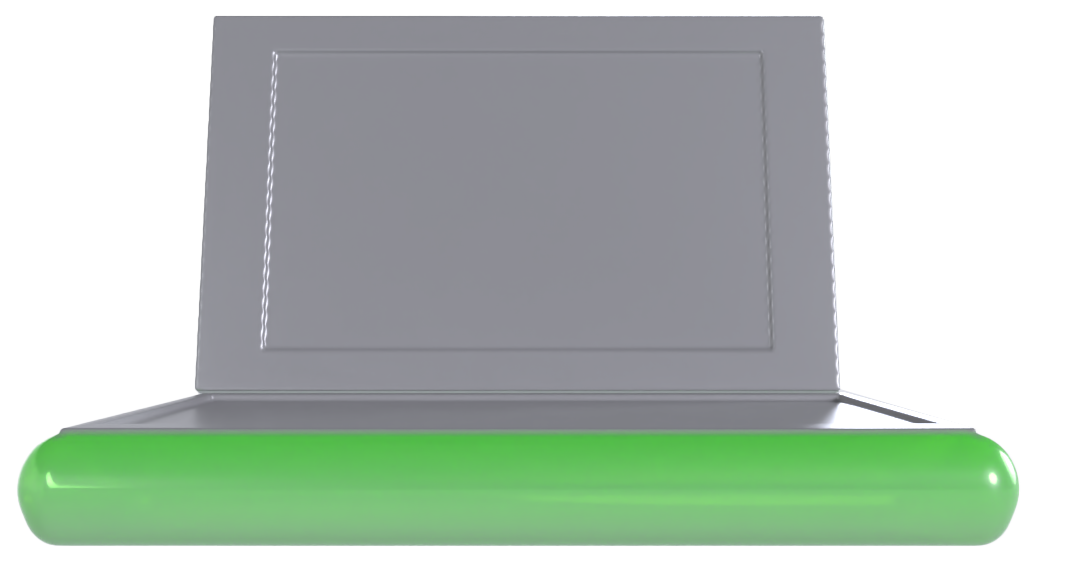
En suivant les préceptes de John Maeda dans son livre The Laws of simplicity, « Loi 1 : Réduire. À quel point pouvez-vous le simplifier ? À quel point cela doit-il être complexe ? » 1 (Maeda 2006) Les standards que nous avons dégagé jusqu’à présent sont : le système d’accroche des composants grâce au nuage de points à partir des vis, une matrice utile à la fois pour les accroches mais également pour un dissipateur thermique modulaire, et enfin le système de plaques inférieures et supérieures. De plus, la liste de composantes indésirables est grandissante : ruban adhésif, autocollants, joints thermiques collées, clips fragiles, caches, …
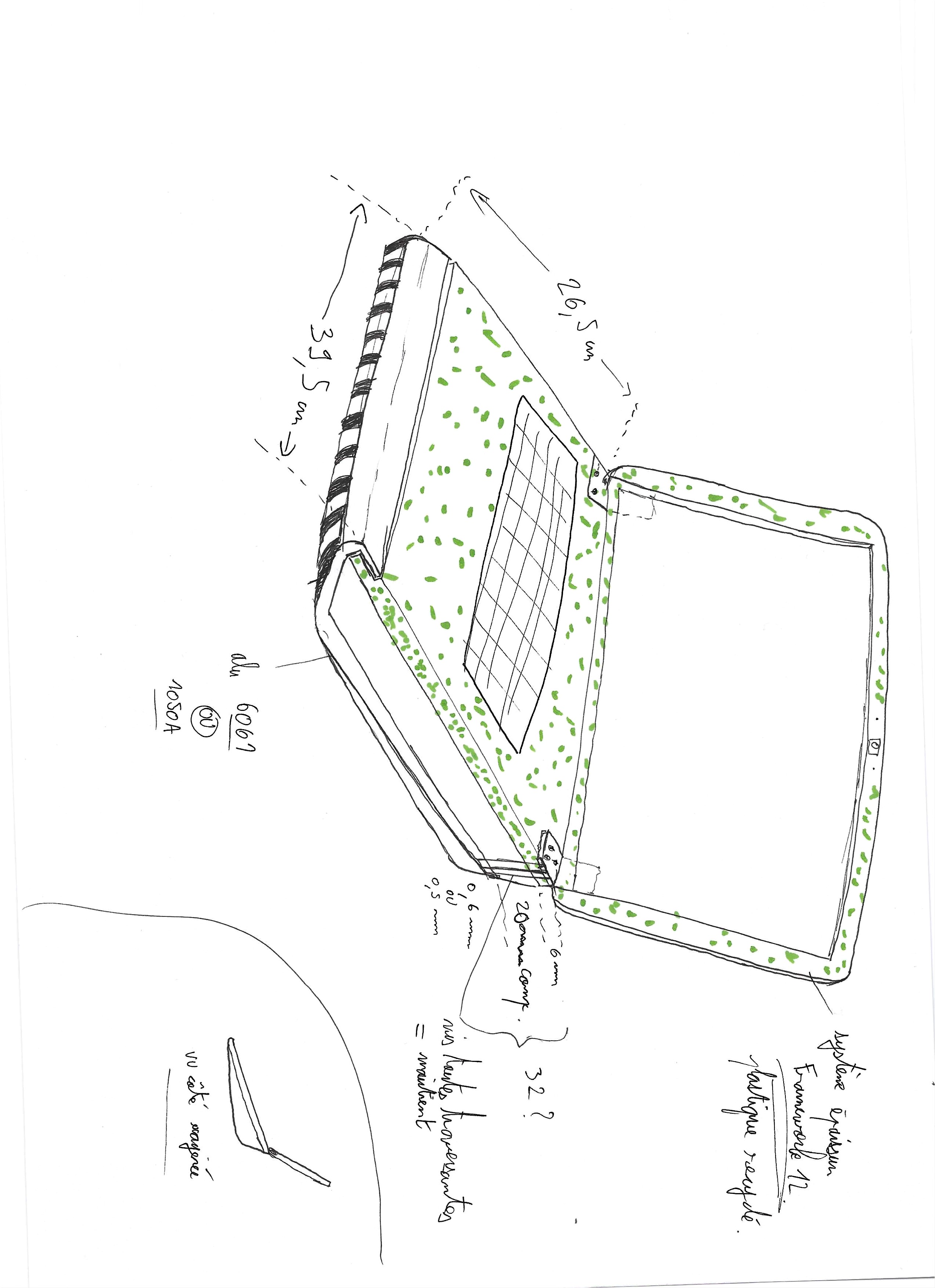
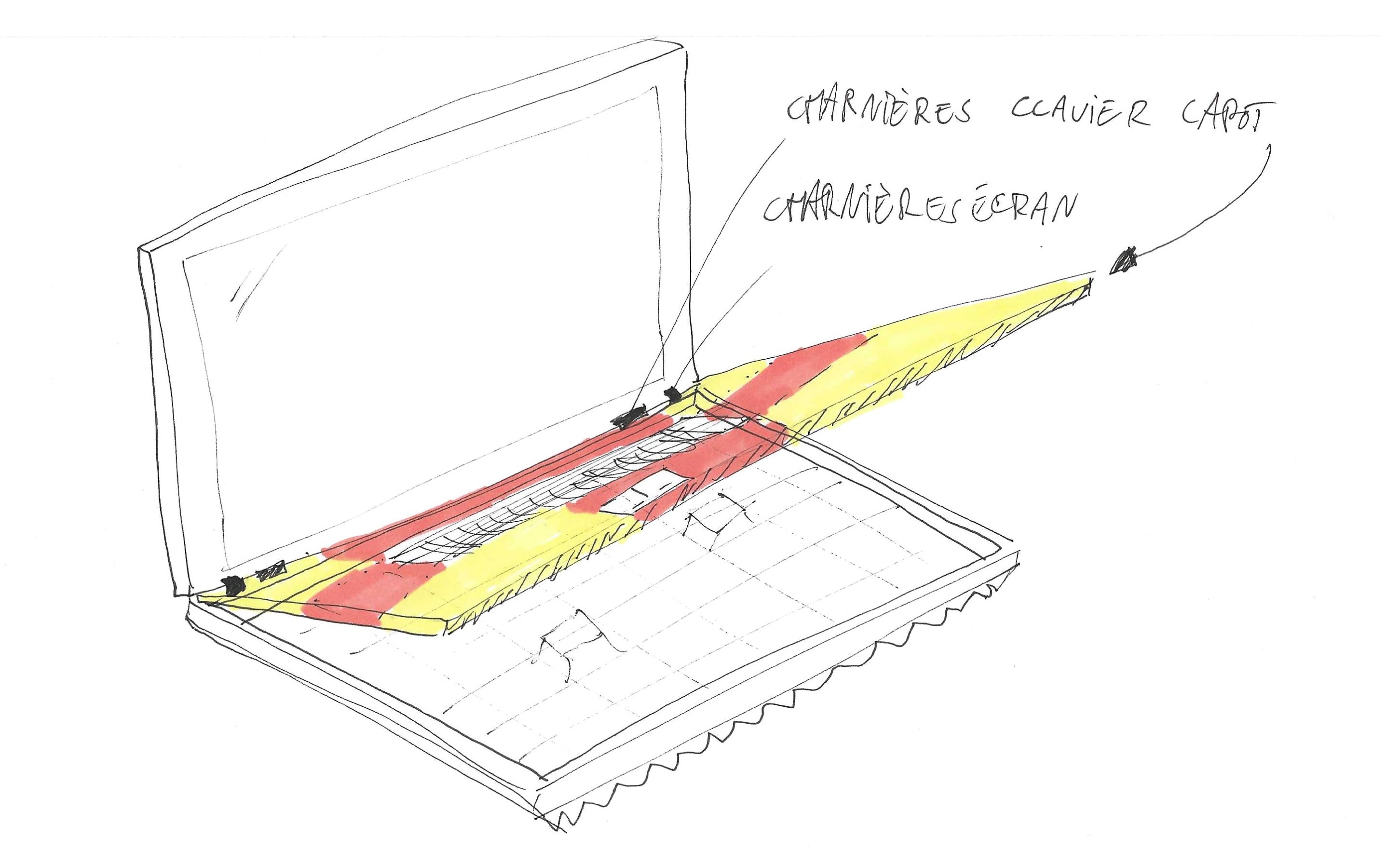
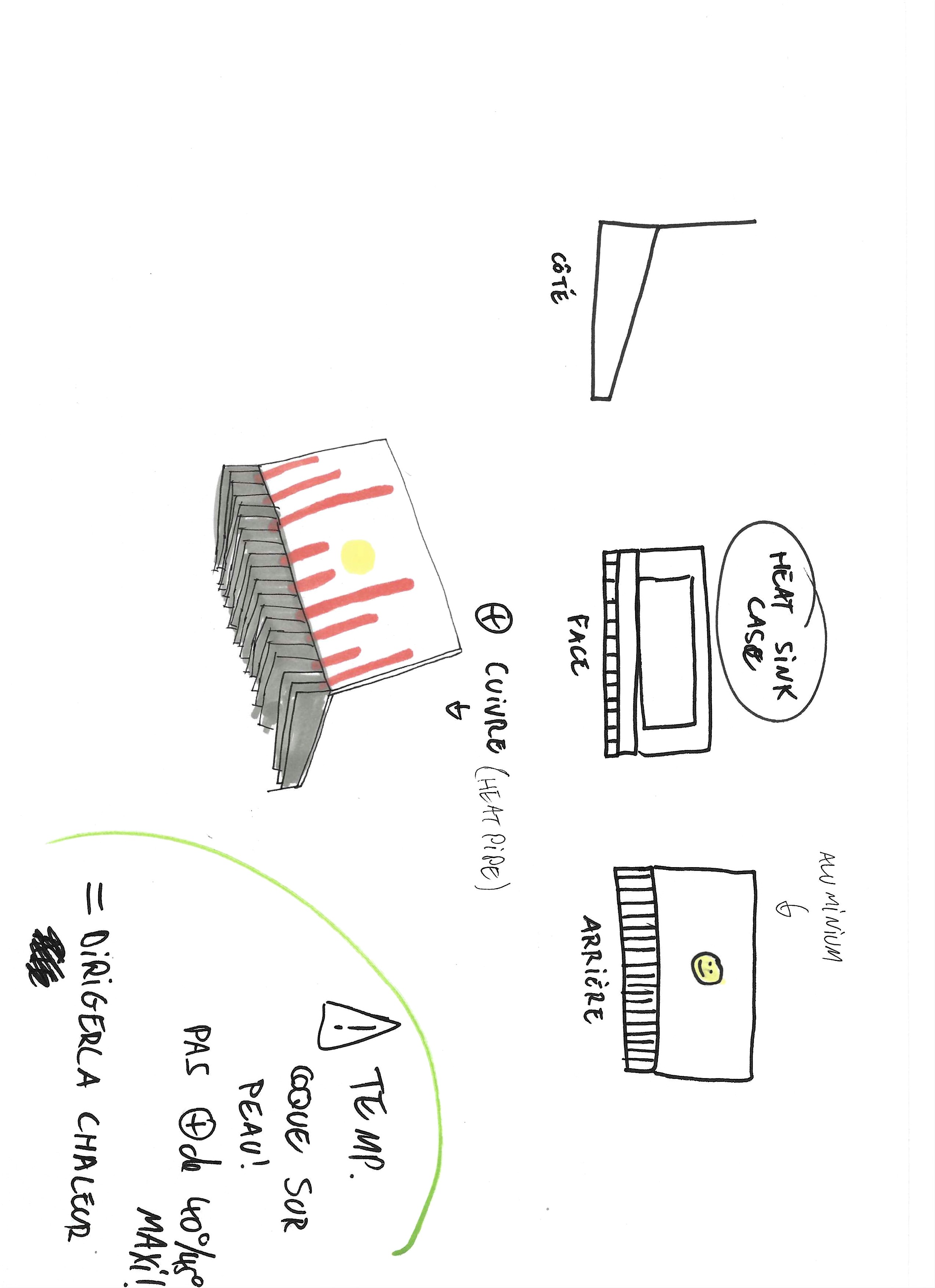
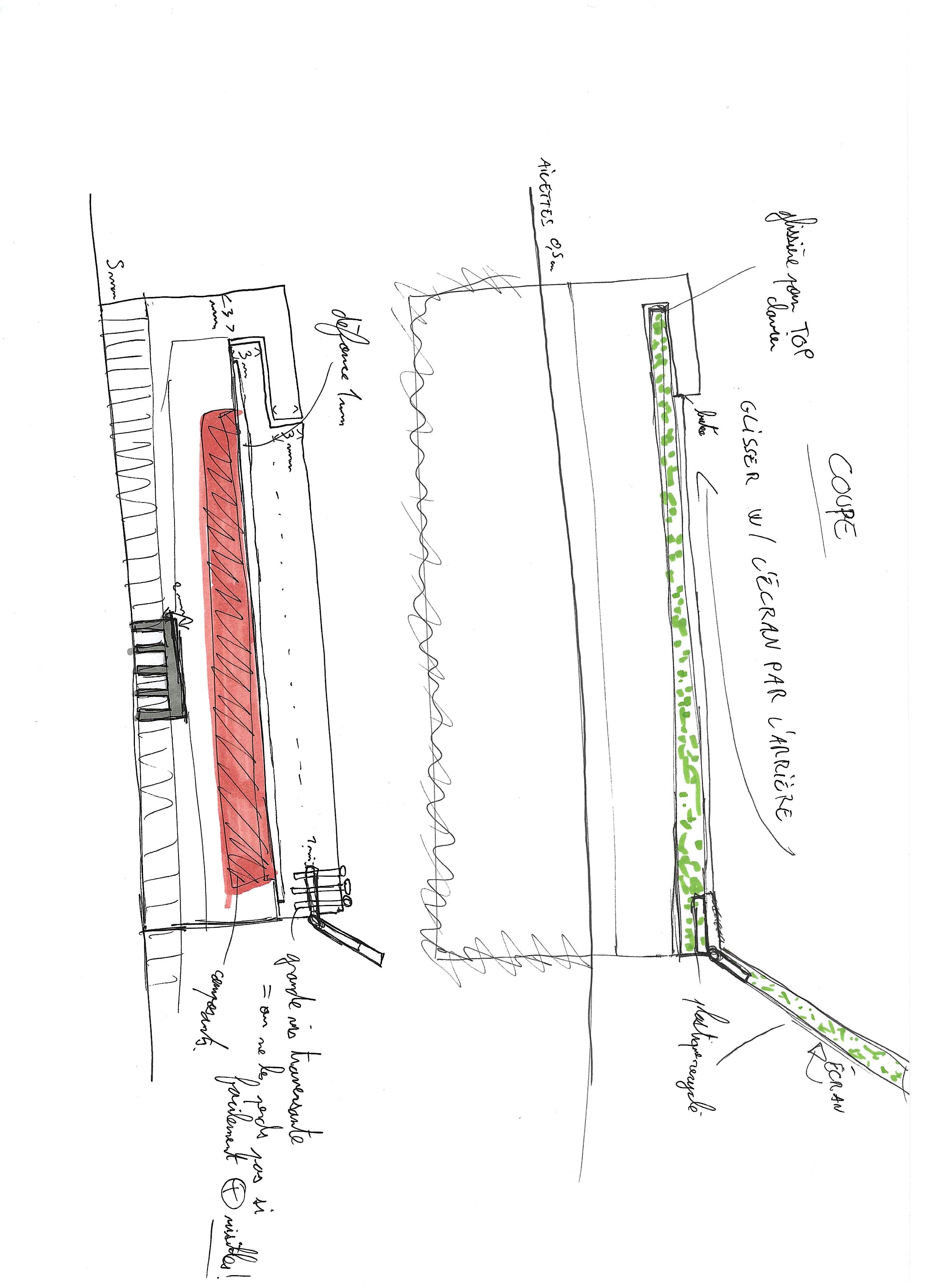
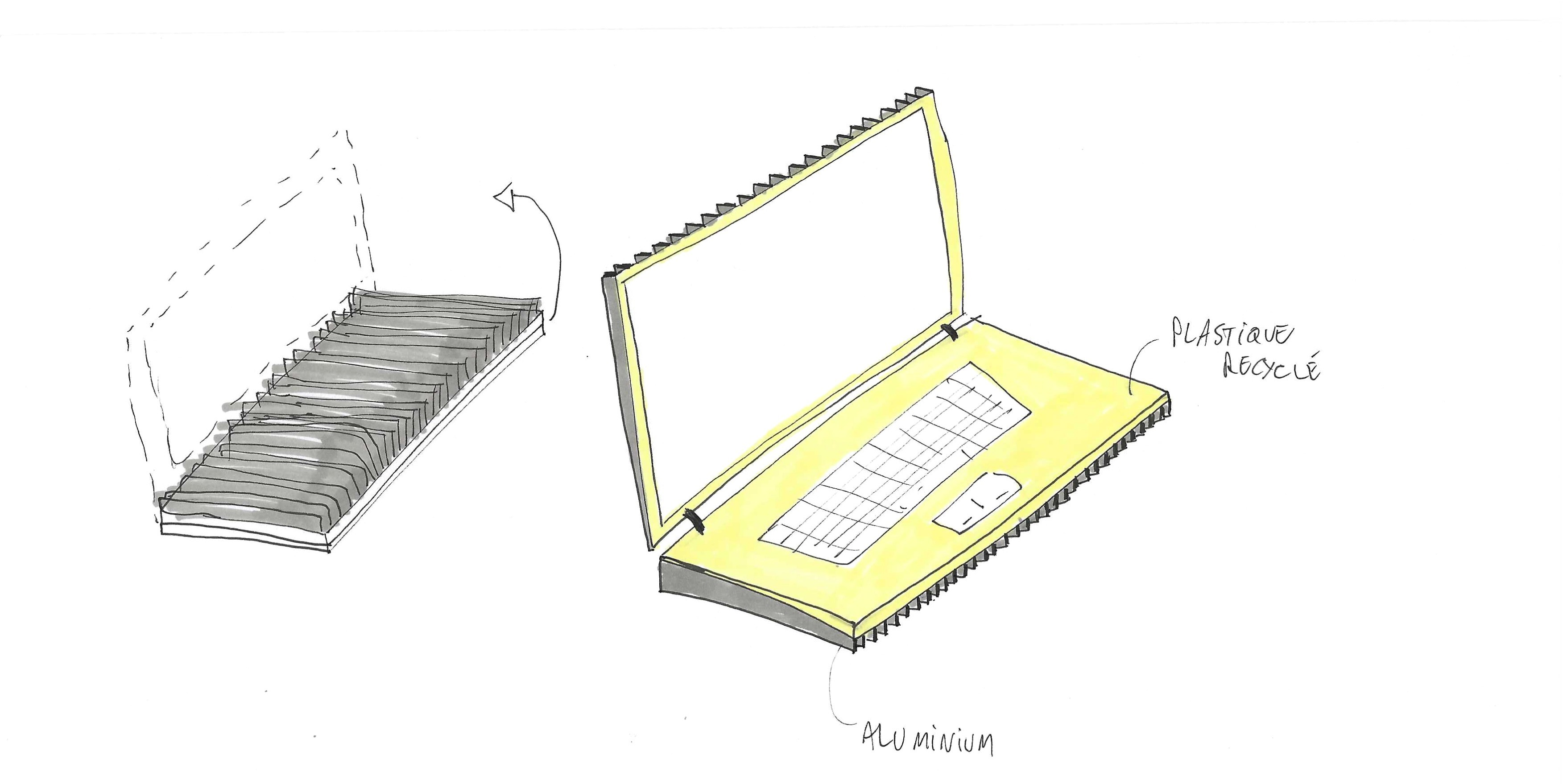
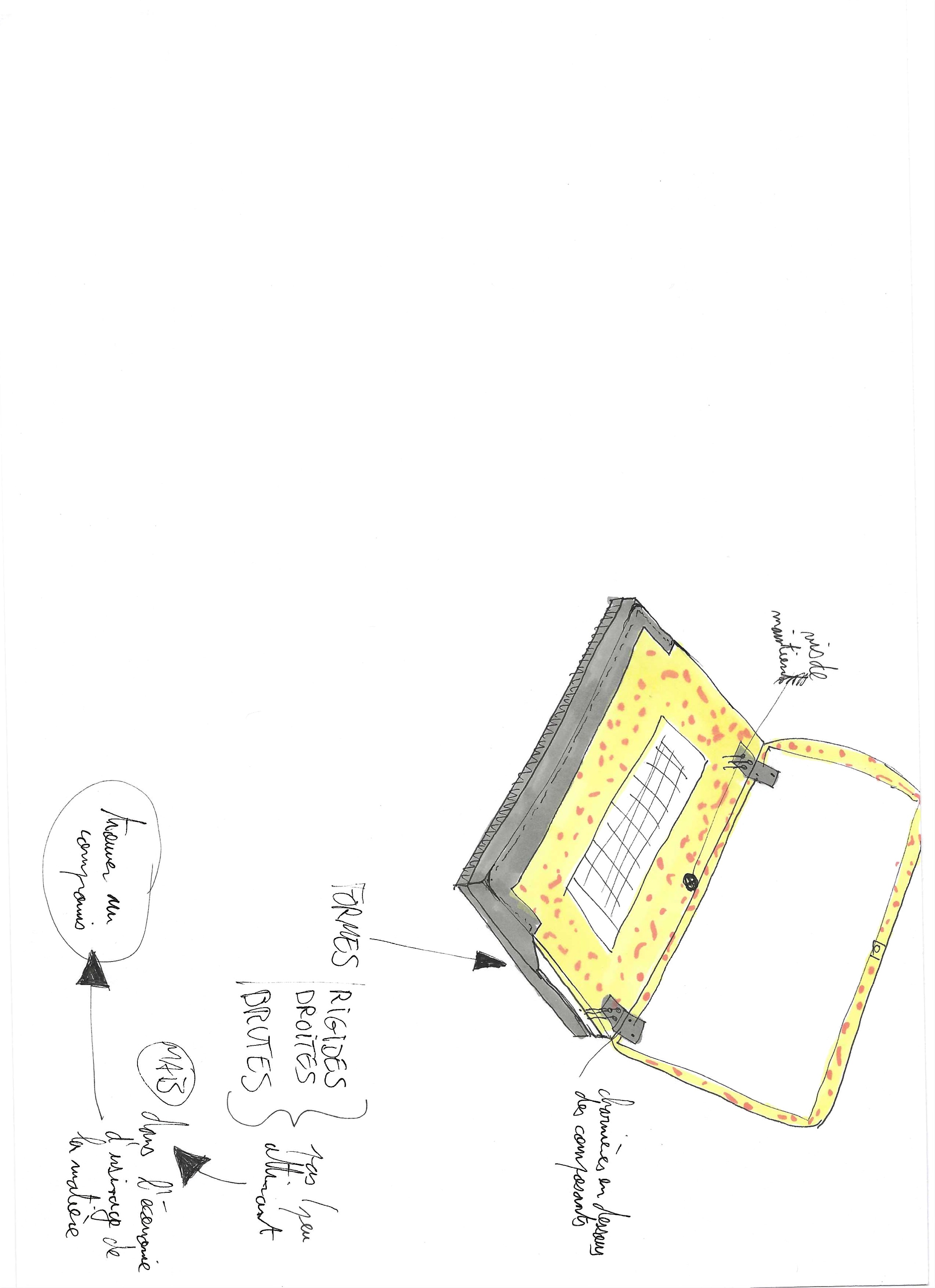
Une approche véritablement transformative repose sur une logique bottom-up, où les besoins et initiatives des utilisateurs influencent les décisions industrielles. Il ne s’agit plus seulement de concevoir des produits à la vente, mais de proposer des modèles ouverts et adaptables. Cependant, il est crucial de distinguer entre transparence et ouverture. Si la transparence facilite la compréhension d’un système, elle n’implique pas nécessairement une possibilité d’intervention ou de modification. Comme le montrent des initiatives telles que MTN Reform, l’enjeu réside dans la réconciliation de ces deux dimensions pour offrir à la fois intelligibilité et action. Les smartphones de la marque Nothing proposent 

En 2022 Apple lance son nouveau programme « Self-Service » permettant aux consommateurs de produits de la marque de réparer eux-mêmes leur iPhone, seulement aux États-Unis pour le moment. Des pièces détachées sont mises à disposition, ainsi que des outils et des manuels officiels pour être autonome dans sa réparation. Comme Dell le fait avec son nouvel ordinateur Luna, les géants commencent doucement à entrouvrir la porte du raisonnable. Ce mode d’existence des objets et des dispositifs techniques est le résultat d’un lent processus de séparation entre conception et usage, production et consommation. 1 Ils transforment la réparation en valeur économique en raison de la pression de l’opinion. L’anticipation des scénarios d’usage s’impose comme une méthodologie essentielle en conception technique, notamment pour maximiser l’efficacité et réduire la complexité des interventions des utilisateurs. Cette démarche est similaire à celle de Barthélemy Thimonnier avec sa machine à coudre, où la simplicité d’usage et l’efficacité d’exécution étaient des objectifs fondamentaux. Dans un contexte contemporain, cette philosophie résonne avec les réflexions de Matthew B. Crawford dans Éloge du carburateur. Il souligne : « Avant de commencer à ressusciter une vieille moto, il faut réfléchir minutieusement et logiquement à la séquence précise d’investigation et d’opérations qui vous permettra de déceler les problèmes les plus sérieux le plus tôt possible. » 1 (Crawford 2009) Le diagnostic vise à identifier les points critiques avant d’engager des ressources, et constitue ainsi la base méthodologique à la conception d’outils technologiques. Crawford met également en lumière une problématique centrale : l’intelligibilité des objets techniques. À travers l’exemple du joint moteur, il illustre la difficulté d’interpréter les mécanismes internes lorsque la conception n’est pas immédiatement explicite : « est-ce que le joint tenait en place uniquement grâce à un ajustement serré dans son logement du bloc moteur, ou bien est-ce qu’il y avait une gorge interne, se terminant par un collet ? » 1 (Crawford 2009) Cette interrogation révèle l’importance cruciale de concevoir des appareils qui soient compréhensibles et manipulables par les utilisateurs.
Un objet démontable est un objet rassurant. Un objet démonté à l'inverse peut être effrayant. Offrir la possibilité des clés du pouvoir de l’objet à son utilisateur permet à ce dernier de reprendre le contrôle sans se perdre. Si l’envie de s’approprier la technique de l’objet est présente, grâce à l’accessibilité de ses entrails, alors l’ouverture est un succès. Un succès en tant que concept matériel faisant partie de la technicité d’un objet typique, et un succès d’avancement d’ordre social. La société Framework à bien compris la condition sine qua non à ce succès, en parlant de son dernier lancement le Framework laptop 12. « L’informatique doit et peut être plus amusante. » (computing should and can be more fun) 1 (Framework 2025) « Comment réconcilier une vision du monde fondée sur la régénération des écosystèmes avec des technologies intrinsèquement extractives, gourmandes en ressources et conçues pour l’obsolescence ? C’est précisément cette tension que le permacomputing tente d’habiter, sans la résoudre, mais en en faisant le moteur d’un imaginaire politique. » 1 Au-delà de l’amusement et de la joie que l’on pourrait ressentir en démontant un appareil électronique, il est question d’opinion politique au regard de nos objets techniques. 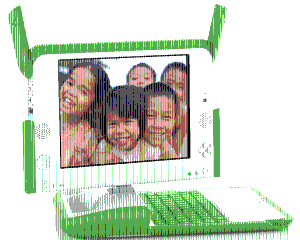
Conçu en 2006 par Yves Béhar dans le cadre du projet One Laptop per Child, l’ordinateur XO incarnait une ambition radicale : repenser entièrement un ordinateur portable pour les enfants des pays émergents. Sa conception répondait à des impératifs d’usage et de contexte, c’est-à-dire des matériaux résistants, une couleur verte distinctive pour décourager le marché noir, une interface utilisateur simplifiée (Sugar OS), et même une manivelle pour pallier au manque d’énergie électrique. Pourtant, ce projet destiné à bousculer l’industrie par son idéalisme, s’est heurté à la réalité. Les enfants utilisaient peu ses fonctions collaboratives, les machines étaient souvent abandonnées, et le modèle économique peinait à s’imposer face aux produits conventionnels. Les échecs de l’ordinateur portable XO est comparable à Alt de Méta IT et révèle les limites d’une approche purement idéaliste : son ouverture (au sens de rendre accessible et de créer un pont entre technologies et populations) s’est perdue dans les contradictions entre utopie et marché.
Réexaminer notre projet Strata en incluant de l’ouverture et de la transparence au sens littéral est-il une bonne chose pour son intelligibilité, mais surtout pour son acceptation dans nos habitudes ? La technologie colorée et transparente des années 1990 possédait déjà tous les critères que nous énumérions depuis un moment. à la manière du MTN Reform, mais aussi du Computer-1, la visibilité des organes aide à l’appréhension de l’entièreté du corps matériel et idéologique. 
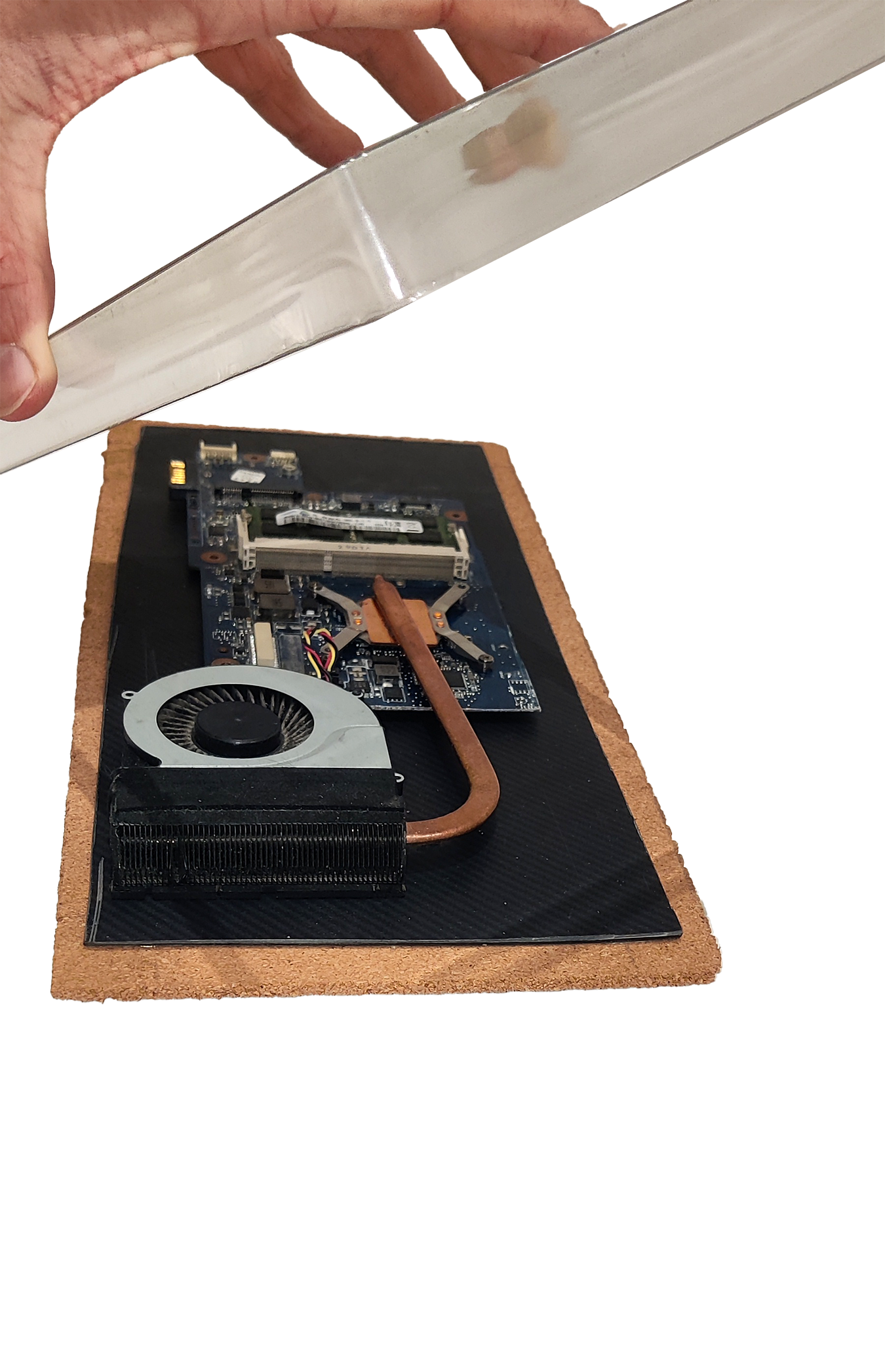

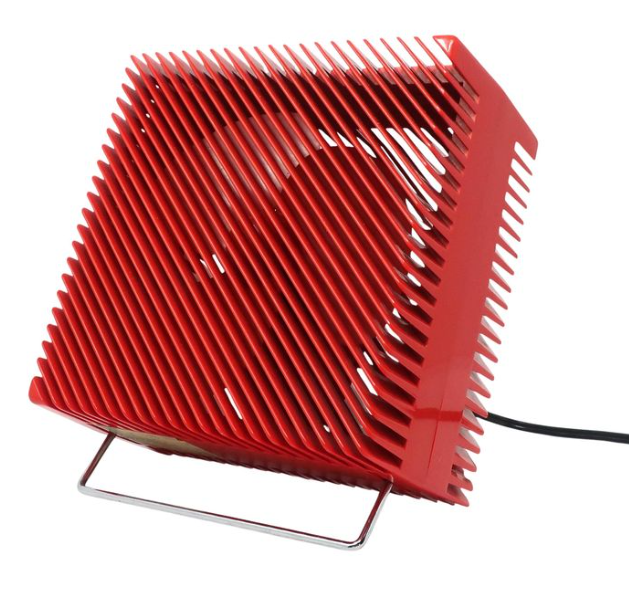

Le projet Strata, un ordinateur portable "Frankenstein", explore la modularité et la réparabilité pour réduire l’impact environnemental du numérique, tout en évitant l’effet rebond. Inspiré par les FrankenPad des années 2000 et les ateliers indiens de réemploi de composants, il s’attaque aux défis techniques liés à l’absence de standardisation (emplacements variables des vis, cartes mères incompatibles, refroidissement hétérogène). Pour y parvenir, il propose une matrice de fixation universelle (inspirée des Lego et de projets comme OpenStructure), un refroidissement passif intégré à la coque, et l’utilisation de systèmes d’exploitation allégés comme Linux. La structure envisagée est en en deux plaques d’aluminium pour dissiper la chaleur et de plastique recyclé pour l’isolation, s’inspirant de designs modulaires comme ceux de Teenage Engineering. L’enjeu dépasse la technique : il s’agit de rendre l’objet intelligible tout en évitant les pièges du marketing, à la façon des coques transparentes de Nothing, esthétiques mais peu modifiables. Strata incarne ainsi une vision où la technologie devient durable non seulement par son design, mais aussi par la manière dont elle redonne du pouvoir à l’utilisateur sur ses appareils.
- 189 - « Qui sommes-nous ? » s. d. Les Imaginations Fertiles (blog). Consulté le 3 mai 2025. https://www.imaginationsfertiles.fr/nous/.
- 190 - Maeda, John. 2006. The law of simplicity.
- 191 - Nothing, réal. 2025. Introducing Phone (3a) Series | Nothing TV. https://www.youtube.com/watch?v=ZizbGaSnIUE.
- 192 - Bartholeyns, Gil, et Manuel Charpy. 2021. L’étrange et folle aventure du grille-pain, de la machine à coudre et des gens qui s’en servent. Carnets Parallèles. Premier Parallèle. p. 15
- 193 - Crawford, Matthew B. 2009. Éloge du carburateur essai sur le sens et la valeur du travail. La Découverte. p. 136
- 194 - Ibid. p. 140
- 195 - Framework, réal. 2025. We built a non-boring computer: the Framework Laptop 12. https://www.youtube.com/watch?v=Ejl-7X74tgc.
- 196 - « Permacomputing, tendance éphémère ou phénomène durable ? | HACNUM ». 2025. 28 avril 2025. https://hacnum.org/hacnumedia/ permacomputing-tendance-ephemere-ou-phenomene-durable/.
3. Conclusion : Une proposition d’ouverture de l’ordinateur portable
D'abord une simple recherche et devenu maintenant un projet, Strata a comme objectif de laisser un témoin à relayer dans les communautés du libre, de l'informatique, du permacomputing, … dans lesquels trop peu de projets autour des problématiques de l'hardware sont conceptualisées, mais seulement évoquées. L'objectif à atteindre n'est pas la production industrielle à grande échelle chez toutes les marques fabricantes d’ordinateurs portables de cette coque Strata, mais plutôt une preuve du possible. Un moment dans le temps, dans notre société d'ingénieurs, où nos ordinateurs portables ne se réinventent plus, prouvant le contraire et ouvrant la voie à de nouvelles inventions. Le but de ce projet est d'exister d'abord pour prouver, et ensuite d'évoluer dans tout un tas de communautés pouvant être intéressées et ayant la volonté d'un ordinateur portable répondant matériellement aux enjeux d'aujourd'hui.

L'idée est de simplifier l'ouverture de l'ordinateur avec nos plaques. Des systèmes existants de glissières ou d'encoches permettent la jonction d’éléments ensemble. Il faut cependant un élément les sécurisant. L’utilité intrinsèque première de l’ordinateur portable est d’être amené à se déplacer avant tout, et non pas ouvert. Ce geste reste rare comparativement à notre utilisation soutenue de l’ordinateur. Si une encoche ou une butée existe à l’avant de la coque, l'élément sécurisant et liant les plaques se trouve à l’opposée, en haut de l’ordinateur, d’une certaine manière. Ici, la plaque de plastique s’est voilée pendant son refroidissement. Les composants disposés en dessous ne sont pas au même niveau et empêchent aux plaques d’être parallèles. Pour éviter toute résistance de tension dans l'encoche, les finitions des matériaux doivent coïncider. De plus, la plaque de plastique ne recouvre pas en totalité le plateau inférieur.

La matrice de point créée à partir de l’observation des vis des machines portables semble être adéquate. La recomposition d’une carte mère en son sein fonctionne. Fatalement, toutes les vis n’ont pas trouvé de logement. Dans une coque de PC industrielle, les composants peuvent être vissés par leurs deux flancs. L’accroche sur Strata n’a lieu que sur l’un des flancs, laissant inévitablement des espaces à visser. Cela ne gêne en rien.
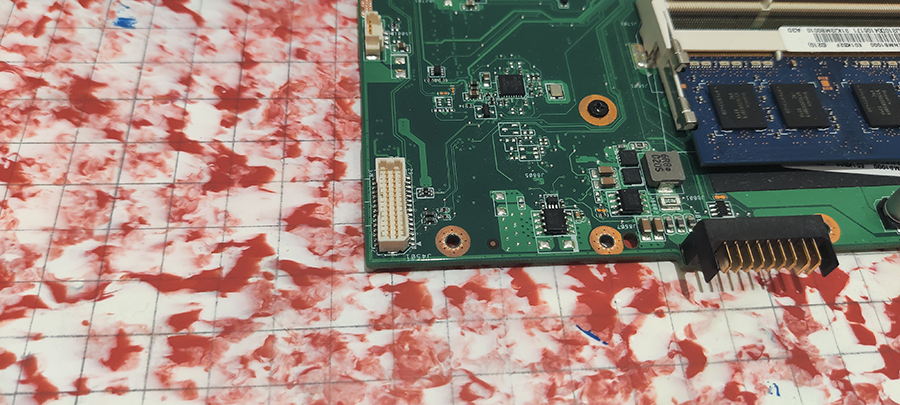
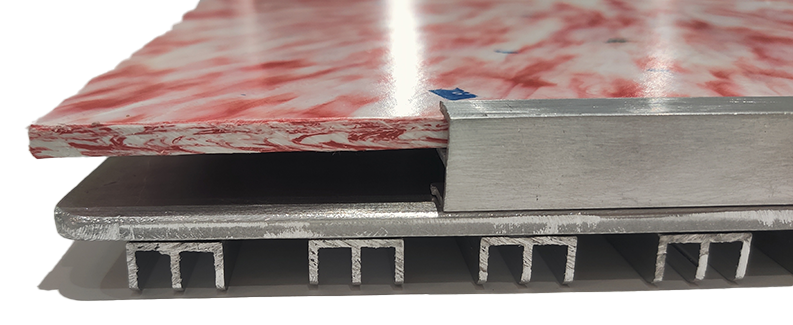

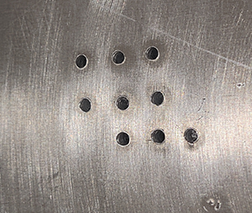
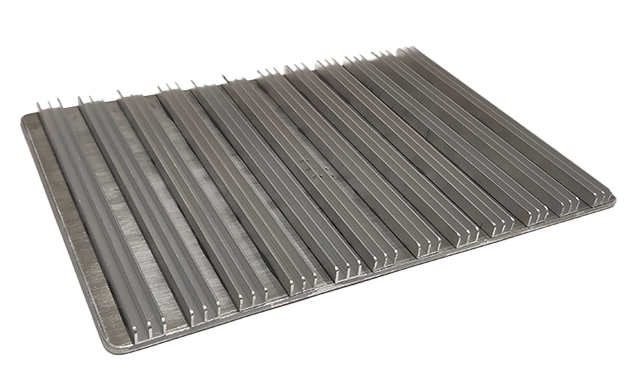
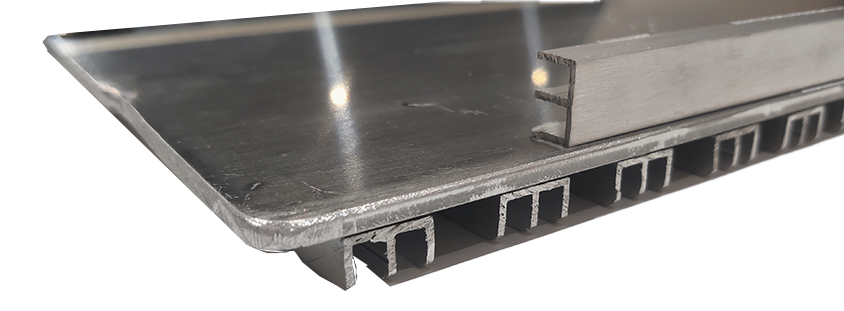
Par la suite, Strata doit se concrétiser en utilisant des logiciels de modélisation 3D précis. Le dessin de la coque pourra être affiné et pousser l’idée au prochain niveau, prouver à un utilisateur quelconque la faisabilité de ce projet. Concevoir un objet technique n’est pas aisé. Des dizaines de paramètres sont à prendre en compte et dépendent des autres. Le moindre changement sur l’un se répercute sur d’autres. Il m’a été compliqué de ne naviguer dans cet horizon brumeux entre tous ces paramètres.
En conclusion, le permacomputing émerge comme une réponse critique et constructive aux défis environnementaux, sociaux et économiques posés par l’industrie numérique actuelle. Inspiré par les principes de la permaculture, ce mouvement propose une approche holistique de l’informatique, où la durabilité, la réparabilité et la sobriété énergétique deviennent des impératifs éthiques et techniques. À travers cette recherche, nous avons exploré les fondements théoriques du permacomputing, ses applications pratiques, ainsi que les obstacles structurels qui entravent son adoption à grande échelle. L’analyse a révélé que l’obsolescence programmée, l’opacité des dispositifs techniques et la surconsommation sont des symptômes d’un système économique fondé sur une croissance infinie, incompatible avec les limites planétaires. Face à cette réalité, le permacomputing incarne une alternative radicale : repenser l’informatique non pas comme un outil jetable, mais comme un écosystème résilient, ouvert et régénératif. Les initiatives comme la Rebooterie, Framework Laptop ou MTN Reform démontrent qu’une autre voie est possible, où les utilisateurs retrouvent le contrôle de leurs machines grâce à la modularité, l’open-source et une conception éthique.
Cependant, la transition vers un modèle permacomputing ne peut se faire sans une remise en question profonde des logiques industrielles dominantes. Les géants du numérique, bien qu’engagés dans des démarches de responsabilité sociale et environnementale, restent prisonniers d’un paradigme productiviste. La standardisation des composants, la documentation ouverte et l’éducation aux enjeux techniques sont autant de leviers pour favoriser cette transition. Le projet Strata, imaginé dans cette recherche, illustre comment une coque d’ordinateur portable modulaire et réparable pourrait concilier performance, durabilité et accessibilité.
Enfin, le permacomputing dépasse la simple question technologique pour interroger notre rapport au progrès et à la consommation. Il s’inscrit dans une vision plus large du Chthulucène, où humains et non-humains coexistent dans un équilibre respectueux des écosystèmes. Comme le souligne Donna Haraway, il ne s’agit pas de rejeter la technologie, mais de la réinventer pour qu’elle serve le vivant plutôt que l’exploiter. En conclusion, le permacomputing n’est pas une utopie, mais une nécessité. Il invite à repenser nos usages, à valoriser la réparation et à cultiver une culture numérique sobre et consciente. Si les défis sont immenses, résistance des industriels, dépendance aux ressources rares, inertie des habitudes, les pistes proposées par ce mouvement offrent un cadre pour une informatique post-croissance, résiliente et régénératrice. L’enjeu désormais est de faire converger les efforts des makers, des designers, des ingénieurs et des politiques pour que cette vision devienne la norme plutôt que l’exception. L’ordinateur de demain ne sera pas plus puissant, mais plus durable. Le permacomputing en est le manifeste.
Bibliographie
- Bartholeyns, Gil, et Manuel Charpy. 2021. L’étrange et folle aventure du grille-pain, de la machine à coudre et des gens qui s’en servent. Carnets Parallèles. Premier Parallèle.
- Bihouix, Philippe. 2021. L’Âge des low tech vers une civilisation techniquement soutenable. Éditions du Seuil.
- Bosqué, Camille. 2021. Open design. Fabrication numérique et mouvement maker. B42 éd. Collection Esthétique des données 04.
- Bosqué, Camille. 2024. Design pour un monde fini. Carnets Parallèles. Premier Parallèle.
- Crawford, Matthew B. 2009. Éloge du carburateur essai sur le sens et la valeur du travail. La Découverte.
- Defoe, Daniel. 1728. Libertalia, une utopie pirate. La Petite littéraire. Libertalia.
- Dubasque, Didier. 2019. Comprendre et maîtriser les excès de la société numérique. Politiques et interventions sociales. Rennes: Presses de l’École des hautes études en santé publique.
- Guien, Jeanne. 2021. Le consumérisme à travers ses objets: Gobelets, vitrines, mouchoirs, smartphones et déodorants. Éditions divergences.
- Jarrige, François. 2016. Technocritiques: du refus des machines à la contestation des technosciences. La Découverte-poche. Paris: la Découverte.
- Maeda, John. 2006. The law of simplicity.
- Masure, Anthony. 2017. Design et humanités numériques. Esthétique des données. Édition B42.
- Midal, Alexandra. 2013. Design l’Anthologie. Cité du Design.
- Moles, Abraham. 1987. Vivre avec les choses : contre une culture immatérielle. Vol. 7. Art Press, hors-série.
- Nova, Nicolas. 2024. Persistance du merveilleux. Premier Parallèle.
- Oroza, Ernesto. 2009. Rikimbili. Publications de l’Université de Saint-Étienne. Cité du Design.
- Ouassak, Fatima. 2024. Pour une écologie pirate. Points Féminisite. Points.
- Rieffel, Rémy. 2014. Révolution numérique, révolution culturelle ? Gallimard. Folio actuel.
- Steven, Levy. 2013. L’éthique des hackers. Evergreen.
- Buožytė, Kristina, et Bruno Samper, réal. 2022. Vesper Chronicles. Science Fiction, Drame, Aventure. Condor Distribution.
- Matrix. 1999. Science Fiction.
- Softley, Iain, réal. 1995. Hackers : Les Pirates du cyberespace. Action, drame, thriller. United Artists.
- Darabont, Frank, réal. 2010. « The Walking Dead ». AMC.
- ARTE, réal. 2025. La guerre des puces | ARTE. https://www.youtube.com/watch?v=ontJn5ZLHj8.
- Arthur Goujon, réal. 2024. Échange mémoire Émilie Gaches. https://www.youtube.com/watch?v=9QK0JmWqnAM.
- Coface France, réal. 2023. Interview de Jean-Marc Jancovici, associé fondateur, Carbone4 lors du colloque Risque Pays de Coface. https://www.youtube.com/watch?v=wupnTUk63RQ.
- Dell Technologies France, réal. 2022. VIVATECH 2022 - Le concept Luna se dévoile. https://www.youtube.com/watch?v=Eu37xaN_Ca4.
- Framework, réal. 2025. We built a non-boring computer: the Framework Laptop 12. https://www.youtube.com/watch?v=Ejl-7X74tgc.
- Nothing, réal. 2025. Introducing Phone (3a) Series | Nothing TV. https://www.youtube.com/watch?v=ZizbGaSnIUE.
- RTS - Radio Télévision Suisse, réal. 2025. Pourquoi on achète autant de gadgets inutiles ? | RTS. https://www.youtube.com/watch?v=e4W1gmqVYSM.
- Thinkerview, réal. 2019. Philippe Bihouix : Prophète de l’apocalypse ? [EN DIRECT]. https://www.youtube.com/watch?v=Oq84s9BLn14.
- TRACKS - ARTE, réal. 2025. De Miyazaki à la vraie vie : le solarpunk peut-il dépasser la fiction ? | Tracks | ARTE. https://www.youtube.com/watch?v=FlXqWf5jSP8.
- Underscore_, réal. 2025. L’IA vient de créer une puce parfaite (mais personne ne comprend comment). https://www.youtube.com/watch?v=NHgag2vKbxg.
- INTERVIEW : Karim Belhabchi, spécialiste durabilité chez Dell France. 2023. https://open.spotify.com/episode/4oo Mjv0wk56ks8hFLZQwZM.
- « ~Rustic Computing~ | Moddr_ ». s. d. Consulté le 7 novembre 2023. https://moddr.net/rustic-computing/.
- « Cloud of Cards ». s. d. ECAL Shop (blog). Consulté le 15 avril 2024. https://ecal-shop.ch/produit/cloud-of-cards/.
- Grindle, Mike. 2023a. « Permacomputing: Tackling the Problem of Technological Waste ». The New Climate. (blog). 31 juillet 2023. https://medium.com/the-new-climate/permacomputing-tackling-the-problem-of-technological-waste-4cc7a4437ad6.
- Grindle, Mike. 2023b. « What Is Open-Source Hardware and Why Does It Matter? » ILLUMINATION (blog). 29 mai 2023. https://medium.com/illumination/what-is-open-source-hardware-and-why-does-it-matter-b3e95f36fb84.
- « OpenStructures – Nicolas Hervé ». s. d. Consulté le 31 mai 2025. https://nicolas-herve-design.fr/openstructures/.
- « Permacomputing, tendance éphémère ou phénomène durable ? | HACNUM ». 2025. 28 avril 2025. https://hacnum.org/hacnumedia/ permacomputing-tendance-ephemere-ou-phenomene-durable/.
- « Permacomputing : une tech plus verte et durable pour réduire notre empreinte numérique ». 2024. 7 novembre 2024. https://www.angrymum.fr/le-permacomputing-quand-la-tech-sinvite-en-mode-ecolo-chez-soi/.
- « Qui sommes-nous ? » s. d. Les Imaginations Fertiles (blog). Consulté le 3 mai 2025. https://www.imaginationsfertiles.fr/nous/.
- Bertrand, Gwenaëlle, et Maxime Favard. 2022. « « Typen », maître-mot du design industriel ». Appareil, no 24 (juillet). https://doi.org/10.4000/appareil.4325.
- Haraway, Donna. 2016. « Anthropocène, Capitalocène, Plantationocène, Chthulucène. Faire des parents ». Traduit par Frédéric Neyrat. Multitudes 65 (4): 75‑81. https://doi.org/10.3917/mult.065.0075.
- Weber, Olaf. 1982. « Über das Verhältnis von Standard und Typus in der Architektur ». https://doi.org/10.11588.
- « « Permacomputing » : la discrète communauté qui défend des outils numériques libres, sobres et décroissants ». 2024, 13 mai 2024. https://www.lemonde.fr/pixels/article/ 2024/05/13/permacomputing-la-discrete-communaute-qui-experimente-un-numerique-sobre-et-decroissant_6232934_4408996.html.
- « Altair 8800 ». 2023. In Wikipédia. https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Altair_8800&oldid=205789258.
- « Apple I ». 2023. In Wikipédia. https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Apple_I&oldid=209836568.
- « Detroit: Become Human ». 2024. In Wikipédia. https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Detroit:_Become_Human&oldid= 213793806.
- « Fairphone (entreprise) ». 2024. In Wikipédia. https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Fairphone_(entreprise)&oldid= 214071464.
- « Ikea ». 2024. In Wikipédia. https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Ikea&oldid=214042456.
- « Jerry Do-It-Together ». 2024. In Wikipédia. https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Jerry_Do-It-Together&oldid=214550324.
- « L’Utopie ». 2024. In Wikipédia. https://fr.wikipedia.org/w/index.php?titl %e=L %27Utopie&oldid=214382833.
- « Matrix (film) ». 2024. In Wikipédia. https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Matrix_(film)&oldid=214343465.
- « Permaculture ». 2023. In Wikipédia. https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Permaculture&oldid=210509409.
- « Phonebloks ». 2023. In Wikipédia. https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Phonebloks&oldid=208299492.
- « Totnes ». 2023. In Wikipédia. https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Totnes&oldid=208689445.
- « ANTONIN ODIN ». s. d. Consulté le 8 janvier 2025. https://diplorama2022.ensci.com/PROJET/ ANTONIN_ODIN/index_odin.html#.
- « 5 chiffres pour comprendre la « submersion » numérique ». s. d. Consulté le 11 novembre 2023. https://usbeketrica.com/fr/article/5-chiffres-pour-comprendre-la-submersion-numerique.
- « Biennale Internationale Design Saint-Étienne 2019 | En ce moment ». s. d. Consulté le 7 janvier 2025. https://biennale-design.com/saint-etienne/2019/fr/home/?article=le-designer-chercheur-1670.
- brian03079. s. d. « Thinkpad W701DS Lattepanda Alpha + KVM Conversion ». Instructables. Consulté le 2 juin 2025. https://www.instructables.com/Thinkpad-W701DS-Lattepanda-Alpha-KVM-Conversion/.
- « #Café Bricol’ ». s. d. uMap. Consulté le 19 avril 2024. https://umap.openstreetmap.fr/fr/map/cafe-bricol_23889.
- « Emissions from Computing and ICT Could Be Worse than Previously Thought ». s. d. Consulté le 10 janvier 2024. https://www.sciencedaily.com/releases/ 2021/09/210910121715.htm.
- fabbula. s. d. « What is permacomputing? » Notion. Consulté le 19 février 2024. https://www.notion.so.
- « Framework Laptop ». s. d. Framework. Consulté le 7 novembre 2023. https://frame.work/fr/fr.
- « Frekvens ». s. d. Teenage Engineering. Consulté le 19 avril 2025. https://teenage.engineering/designs/frekvens.
- géographe, Yohan Demeure, expert. 2022. « VivaTech : Dell présente sa vision d’un laptop durable avec le concept Luna ». Sciencepost. 20 juin 2022. https://sciencepost.fr/vivatech-dell-laptop-durable-luna/.
- « Glitch Art, l’imperfection parfaite ». s. d. Consulté le 2 février 2024. https://usbeketrica.com/fr/article/glitch-art-l-imperfection-parfaite.
- Heikkilä « Viznut », Ville-Mathias. 2021. « Permacomputing Update 2021 ». 2021. http://viznut.fi/texts-en/permacomputing_update_2021.html.
- « « Il nous reste environ trente ans de numérique devant nous » ». s. d. Consulté le 1 décembre 2024. https://usbeketrica.com/fr/article/il-nous-reste-environ-trente-ans-de-numerique-devant-nous.
- « John Carmack Suggests the World Could Run on Older Hardware – If We Optimized Software Better ». 2025. TechSpot. 14 mai 2025. https://www.techspot.com/news/107918-john-carmack-suggests-return-software-optimization-could-stave.html.
- Joseph, Fūnk-é. 2022. « I Miss You, Transparent Technology: An Investigation into the Y2K Clear Craze ». Fanbyte. 2 août 2022. https://www.fanbyte.com/pokemon/ features/transparent-technology-y2k-clear-craze-i-miss-you.
- Larousse, Éditions. s. d.-a. « Définitions : numérique - Dictionnaire de français Larousse ». Consulté le 14 mai 2024. https://www.larousse.fr/dictionnaires/ francais/ %num % %C3 %A9rique/55253.
- Larousse. s. d.-b. « Définitions : utopie - Dictionnaire de français Larousse ». Consulté le 14 avril 2024. https://www.larousse.fr/dictionnaires/ francais/utopie/80825.
- « Mindy Seu Traces the Origins of Internet Green ». s. d. Hyundai Artlab. Consulté le 7 janvier 2025. https://artlab.hyundai.com/editorial/mindy-seu-traces-the-origins-of-internet-green.
- « MNT Reform ». s. d. Crowd Supply. Consulté le 9 février 2024. https://www.crowdsupply.com/mnt/reform.
- « Notre histoire ». s. d. Consulté le 28 avril 2024. https://www.ikea.com/be/fr/this-is-ikea/about-us/notre-heritage-pubad29a981.
- « OpenStructures ». s. d. Consulté le 31 mai 2025. https://openstructures.net/.
- « permacomputing wiki ». s. d. Consulté le 29 octobre 2023. https://permacomputing.net/.
- « Sans chaîne, ni courroie : comment fonctionnent ces vélos « hybrides » à entraînement numérique ? » 2023. clubic.com. 16 juillet 2023. https://www.clubic.com/electric-bicycle/actualite-477964-sans-chaine-ni-courroie-comment-fonctionnent-ces-velos-hybrides-a-entrainement-numerique.html.
- « T60/T61 FlexView FrankenPad Questions - Thinkpads Forum ». s. d. Consulté le 8 avril 2025. https://forum.thinkpads.com/viewtopic.php?t=90020.
- « Usbek & Rica - Une brève histoire des hackers ». s. d. Consulté le 27 mars 2024. https://usbeketrica.com/fr/article/une-breve-histoire-des-hackers.
- Zaffar, Hanan. 2025. « The Rise of ‘Frankenstein’ Laptops in New Delhi’s Repair Markets ». The Verge. 7 avril 2025. https://www.theverge.com/tech/639126/ india-frankenstein-laptops.
Annexes
1. Entretien à la Rebooterie avec Camille et Ulysse, les deux salariés de l’association à ce moment
Entretien mené le 06 décembre 2023.
----------------Arthur Goujon (AG) - Pouvez-vous me faire l'historique de l'association ?
Camille - L’association la Rebooterie a été créée en 2020, pendant le covid. Sur le modèle des associations qui réparent des vélos, les premiers bénévoles qui aimaient bien l’informatique, se sont dit qu’il manquait justement un endroit où réparer son ordinateur. Ils ont alors mis leurs savoirs à disposition au travers de cette association. On organise plusieurs actions régulières qui se sont mises en place au fur et à mesure. Aujourd’hui on récupère des dons de machines ou de matériel informatique, principalement de particuliers. Cela regroupe les vieux ordinateurs qui trainent, les téléphones portables, les claviers avec des anciennes prises, et encore pleins d’autres choses différentes. On reçoit aussi de temps en temps des dons d’entreprises. Quand on réceptionne ces dons, on effectue un premier tri en fonction de l’état et de l’âge de la machine. Soit on le garde pour en faire quelque chose, soit on l’envoie en recyclage chez S2R, avec qui nous travaillons. Tout ce qui passe cette première est stocké dans notre réserve. Sur les ordinateurs notamment, s’ils sont en bon état, on le diagnostique. En fonction de ce diagnostic, soit on l’utilise dans nos ateliers « PC à 0€ », soit on les reconditionne pour les mettre à la vente. On propose des ordinateurs reconditionnés pour nos adhérents. Si jamais le diagnostic n’est pas joyeux, on démonte l’ordinateur pour récupérer les pièces. On revend ensuite ces pièces à prix libre qui sont accessibles aux adhérents, pour faire des réparations. Pour résumer la philosophie du lieu, les gens ont du matériel qui dort dans leurs placards, ils nous le rapporte, nous le trions, et le but est de pouvoir réutiliser le plus possible tout ce qui est encore fonctionnel sur les machines. Si des pièces sont complètement défaillantes, avant que la structure de recyclage les emmène, les gens peuvent les récupérer. Des personnes ayant des projets artistiques par exemple récupèrent de temps à autres des cartes mères ou encore des dalles d’écrans. On a un problème d’espace de stockage, ce qui fait qu’au bout d’un moment, ce qui n’est plus fonctionnel ne peut plus être gardé. On constate aussi que l’écrasante majorité des personnes qui viennent pour l’auto-réparation se présentent avec des ordinateurs portables ou des téléphones. Les gens n’utilisent plus que ces deux appareils.
AG - Quelle est la mission principale de votre association ?
Camille - L’association a comme mission d’accompagner les gens, plus que d’avoir des informaticiens ultra qualifiés qui réparent « bêtement » et froidement les machines. Nous avons appris les connaissances de réparation directement ici, sur le terrain en faisant. On n’est pas non plus un fablab avec des techniciens qui ont des compétences poussées. L’idée est de partager ses connaissances pour faire de l’auto-réparation, d’installer des systèmes libres etc. Il y a des similitudes avec les repair cafés, on a des bénévoles ici qui sont aussi bénévoles dans des cafés. On a un mode de fonctionnement vraiment similaire, notamment pour ce qui est de la dimension sociale, sauf que nous sommes orientés numérique et non pas électroménager. On a plein de profils de bénévoles différents qui nous aident dans cette mission. On accepte tout le monde, il n’y a pas besoin d’avoir forcément des compétences dans le numérique ou l’informatique. Par exemple, sur les deux formations qui ont eu lieu samedi dernier, l’une était sur Arduino. C’était une initiation à Arduino pour les personnes qui n’ont jamais utilisé ce matériel. Samedi prochain, on organise une formation sur la dynamique de discrimination de genres dans les ateliers d’auto-réparation. C’est une question centrale à la Rebooterie. On ne veut pas que ce lieu ne soit investi que par des hommes informaticiens qui veulent en faire un terrain de jeux pour bidouiller sur des ordinateurs. On veut garder cet endroit le plus ouvert possible et aussi réfléchir à comment le rendre accessible à tout le monde. À la base, le monde de l’informatique était très féminin. C’était surtout les femmes qui étaient techniciennes informatiques au début de ce monde vu comme très minutieux et de patience. Aussi ce travail était « acceptable » pour les femmes, car ce n’était pas par exemple sur un chantier. Ce métier d’informaticien s’est ensuite complètement masculinisé dans les années 80/90 grâce à l’arrivée de l’ordinateur personnel.
AG - Quels sont les actions que vous proposez ?
Ulysse - la Rebooterie propose des ateliers d’auto-réparation hebdomadaires sous forme de permanence. Les gens viennent avec une machine en mauvais état ou qui est en panne, et nous sommes là pour les aider dans leur réparation. Ils peuvent profiter des pièces à prix libre, et des fois des pièces neuves comme des disques durs ou d’autres pièces spécifiques. Ils disposent aussi d’outils qu’on leur met à disposition comme des tournevis, des spatules pour ouvrir et décoller des pièces, des postes à souder, des clés USB à disposition avec des OS libres de droit, … On a pas mal de succès sur les ateliers d’auto-réparation. C’est une forme d’atelier supervisé, où l’on accompagne les personnes dans leur diagnostic, puis dans leur réparation. Pour les ateliers PC à 0€, ceux-ci ont lieu une fois par mois, sur deux séances de trois heures avec un groupe fixe sur inscription. L’idée est de pouvoir équiper les personnes qui n’ont pas moyen de s’équiper en PC. On ne demande pas de justificatif, on annonce simplement que tout le monde peut s’inscrire. Le but est de repartir à la fin des deux séances avec un PC qu’ils ont reconditionné eux-même, gratuitement. La première séance, nous sortons des PC pré-diagnostiqués et chaque participant en choisit un. Pour ces trois premières heures, on est plus dans la transmission. On va parler des pièces d’un ordinateur, comment ouvrir un ordinateur, regarder ce qu’il y a dedans, identifier les différentes parties et à quoi elles servent, … Ensuite, les personnes diagnostiquent leur PC et on leur propose de changer de disque dur et de RAM. De cette manière, elles démontent le PC. Moins par souci de besoin de le faire, mais plus pour comprendre comment faire et expérimenter. Pour la deuxième séance, on commande des pièces neuves notamment des batteries d’ordinateur portable. C’est la pièce de notre stock que l’on a le moins, étant très spécifique en fonction du modèle de PC. Cette séance commence encore avec une partie de transmission, cette fois sur les logiciels : apprendre ce qu’est un système d’exploitation, qu’est ce que Libreoffice, … On leur propose de tester des systèmes libres sur une clé live, et si l’un leur convient, qu’ils l’installent sur leur machine. On encourage les gens à partir sur Linux car il tourne mieux sur les vieilles machines. On a aussi des clés Windows si les gens le souhaitent. Enfin, ils repartent avec leur ordinateur. La liste d’attente est longue de six mois pour les prochaines inscriptions à cet atelier.
Camille - Une autre action que l’on fait est autour du numérique et des usages, pour que les personnes gagnent aussi en autonomie dans ce domaine et pas uniquement sur la question du matériel. L’idée est de questionner notre usage journalier de ces machines. Ces temps sont appelés « conseil numérique » et sont aussi une permanence ouverte. Des gens viennent et nous demandent comment faire si j’ai oublié mon mot de passe de ma boîte mail, ou alors comment je peux installer un système d’exploitation différent sur mon smartphone. Il y a différents degrés de demandes.
Enfin la dernière action que nous menons sont des formations. On n’en fait pas beaucoup et elles sont à destination d’associations ou de structures qui nous contactent. Le module que nous faisons le plus est sur l’impact environnemental du numérique. On fait aussi ce qu’on appelle le principe de base de la réparation. C’est donc apprendre à réparer un ordinateur et connaître les différentes pièces qui le compose.
2. Entretien avec Brice Genre, co-créateur de l’ordinateur de l’ordinateur Alt, Meta IT
Entretien mené le 16 octobre 2024.
----------------Arthur Goujon (AG) - Qu’est ce que l’entreprise Meta IT et leur ordinateur Alt ? D’où vient ce projet avant-gardiste ?
Brice Genre - Le projet commence en 2001. Il commence en 2001 car je suis sur les bancs de l’université avec Michael Gil de Muro. On ne se connait pas, mais nous faisons partie de la même option en design. Au fur et à mesure des cours, nous nous rendons compte que nous partageons un certain nombre de valeurs et d’intérêts pour certaines choses qui se passent dans la société, à savoir des mouvements de politiques alternatives et toutes les logiques et esthétiques alternatives. Je rappelle pour le contexte que nous sommes un peu les premiers enfants de Matrix, et cela compte. Nous faisons partie de la génération Matrix et sommes très marqués par ces films. Matrix est déjà la forme cristallisée qui rassemble plein de mouvements émergent, issues de la culture de la bande dessinée, de la culture du manga, mais aussi de tout un tas de propos sur le rapport à l’informatique, l’idée de sociétés secrètes, ou encore l’idée de mouvements politiques qui requestionnent le capitalisme. Nous sommes aussi très au fait des questions éco environnementales qui commencent à émerger. On parle là d'une espèce d’écologie qui passe à l’action, à la manière de Greenpeace. Un autre mouvement en parallèle de geeks informatiques (composé de codeurs, ou de développeurs), développent deux approches de l’informatique : la culture du hacking et du cracking. Le cracking est une démarche, dans l’imagination collective, semble un peu plus révolutionniste que le hacking. Le grand principe des hackeurs, qui nous intéresse nous, est l’idée d’une utopie sociale. Chez les crackeurs, l’idée est plus de détruire un système sans véritablement de perspectives futures.
À cette époque-ci, nous ne sommes que très peu à nous intéresser à ces logiques-là. Cependant, dans des cercles d’étudiants en arts ou autre, ces thèmes intéressent et forment une sorte d’agglomération de ces personnes. Dans le monde de l'ingénierie et également des gens plus âgés que nous à ce moment, s’intéressent aussi à ces idées là. C’est Michael qui me met le pied à l’étrier car il est plus au fait de toutes ces choses que moi. Il s’intéresse par exemple déjà aux logiciels open source qui sont émergents et connaît déjà la communauté GNU et tout ce qui décline par la communauté open source. Je découvre avec lui par exemple, une manière qui est très empreinte de la cuisine asiatique, basée plus sur le végétal et les céréales, que sur des apports protéinés de type viande. C’est quelqu’un qui vit dans un appartement qui ne comporte pratiquement aucun meuble. Ce sont des choix de vie peut-être plus courants aujourd’hui mais qui n’étaient pas vraiment pratiqués à cette période. Cela rejoignait beaucoup de propos que j’avais en design. Ces idées n’avaient pas encore de noms, ce n’est que plus tard que l’étiquette de minimalisme est apposée. J’étais en fait déjà très minimaliste, je vivais avec peu, j’étais contre une certaine forme d’organisation de la société de consommation, …
Avec Michael nous commençons à évoquer des idées en échangeant autour de projets, qui sont des prétextes données par nos enseignants en design. On pense à des projets alternatifs et à contre-courant de l’industrie. Un jour donc, dans ce contexte électro-informatique et début des IA, qui ne sont pas encore nommées de la sorte, mais aussi de celui de Deep Blue (premier ordinateur qui bat un être humain aux échecs), ou encore du iMac de Jonathan Ive, qui est l’expression même du dispositif propriétaire dans son ensemble, des débats commencent à se faire entendre. D’abord ceux qui souhaitent vendre des PC (personnal computer), qui ont une vision plus ouverte de l’informatique à domicile et ensuite Apple, qui est l’expression d’un système verrouillé mais très confortable dans l’utilisation et fiable. Michael et moi avons des pc et sommes à l’encontre de l’utilisation de logiciels propriétaires. Nous pensons que les outils doivent être offerts et disponibles à tout le monde. Nous commençons à travailler avec des versions ouvertes de logiciels très balbutiantes, tel que Sodipodi qui est l’équivalent d’Inkscape et d’Illustrator, ou aussi Gimp pour l’équivalent de Photoshop. Michael me fait aussi découvrir les logiciels de 3D, notamment Blender, qui est dans sa forme embryonnaire et difficile à prendre en main puisqu’il est conçu par des ingénieurs et des développeurs.
De mon côté je pars en maîtrise sur un sujet qui émane de celui de ma licence, c’est-à-dire sur la déconstruction et la libéralisation des systèmes de connaissance. Je suis aussi très intéressé par le travail de Daniel Defoe et l’utopie pirate, qui est un auteur qui a rassemblé les propos politiques et idéologiques des pirates du XVIIe siècle. Dans l’arrière fond de ces propos tiens l’idée d’une vie, d’une organisation et d’un état beaucoup plus libertaire, avec une organisation des individus collective en horizontalité, … Je réalise donc mon projet de maîtrise sur l’habitat d’urgence. Je développe des objets, des systèmes, des modes d’habitations qui sont à destination des personnes sans domicile fixe. Pendant ce temps, Michael change de trajectoire. Étant quelqu’un qui fabrique des images et de l’illustration, il se dirige vers le design graphique. Pendant 2 ou 3 ans nous restons en contact. Il décide de partir à Paris et de trouver du travail de graphisme. Il intègre ensuite une émission de télévision et travaille la nuit en production, en réalisant à la chaîne des montages vidéos pour Mireille Dumas et son émission « Bas les masques ». Vous allez voir pourquoi je vous raconte tout cela.
Même avec la distance, nous restons en contact et essayons de nous voir de temps en temps. Un jour, Michael m’appelle et me dit qu’il va quitter Paris puisqu’il a trouvé un travail de graphiste dans une société informatique à Bordeaux. Cette société développe de manière open source des logiciels d’apprentissage et des jeux éducatifs pour les enfants. Dans cette startup il y a le patron Éric qui est informaticien et développeur, Olivier qui est un autre développeur / codeur, et est complètement brillant et hors-normes. C’est quelqu’un qui a faillit devenir développeur Kernel, vraiment redoutable dans son domaine, avec aussi une psychologie particulière. Je crois, et j’espère qu’il ne m’en voudra pas de le dire, mais c’est vraiment un petit génie de l’informatique avec une compréhension des rapport sociaux particulière. Souvent quand je pense à lui, je pense à Sheldon Cooper. Il y a également Guillaume, qui lui aussi est informaticien, mais surtout ingénieur. Il a travaillé un temps dans l’industrie militaire, notamment chez Mercedes, sur des systèmes de reconnaissance de chars en situation de combat. Il possède donc un rapport à la technologie de pointe de l’électronique. Et enfin Michael. Michael discute avec ces personnes des choses que nous avons échangées sur les bancs de l’école et encore plus tard quand nous continuons à nous croiser. Un jour, il arrive à convaincre Guillaume et Olivier que nous pouvons imaginer un nouvel ordinateur nouveau. L’idée elle est simple, c’est de créer un Apple New Age qui serait éco-conçu, open source, …
Michael m’appelle donc, pour me proposer de construire cet ordinateur éco-conçu et économe en énergie. Il avait une idée très « Matrix » de ce que ce projet pourrait être. J’adhère à ce principe et nous commençons à imaginer un scénario. L’idée est d’avoir un scénario software et un scénario hardware. D’une part le scénario software est d’imaginer une base avec une interface graphique et un système d’exploitation complètement libre, qui sera la tâche d’Olivier et de Guillaume. D’autre part le scénario hardware, nous imaginons un ordinateur nouvelle génération qui respecte ces grandes lignes d’éco-conception, de matériaux éventuellement biosourcés, une accessibilité hyper développée et que l’ordinateur soit réparable facilement et par tout usager.
On va alors filer cette idée, mais surtout beaucoup la radicaliser. On va faire en sorte que nôtre ordinateur consomme le moins d’énergie possible ou que nos matériaux soient hyper recyclables. On affine notre scénario d’usager pour trouver son rôle, à savoir pas seulement quelqu’un qui manipule et utilise un système d’outils, mais quelqu’un qui dispose de connaissance grâce à l’objet qui lui livre une forme d’intelligibilité. L’objet lui dit qui il est, comment il fonctionne, comment le faire fonctionner, comment le faire évoluer, … Nous nous rendons compte assez rapidement de l'existence énorme de l’obsolescence du matériel informatique et qu'énormément de gens font beaucoup d’argent sur le dos de celle-ci. De plus, le coût environnemental est énorme ainsi que l’importance géopolitique des ressources. De ces idées qui se précisent, nous rédigeons le devenir de ce projet et voulons créer une société pour le concevoir et le réaliser.
Je me souviens débuter les premiers tests dans le garage des grands-parents de Michael. Je fabrique une première forme en matériaux composites qui va héberger une dalle d’ordinateur et un système électronique très allégé, pour créer un micro pc. La stratégie de départ est de produire des ordinateurs pour un des domaines qui en est le plus gourmands, à savoir la bureautique. Nous sommes tournés vers les pays occidentaux, dont l’administration se numérise de plus en plus, avec les recours à l’informatique présent dans presque tous les services. Nous pensons que c’est ici qu’il faut frapper : dans les institutions et les grandes structures, et non pas chez les particuliers. Les premières versions sont en fait des petits ordinateurs mais avec de grands écrans, disposant d’écrans plats assez rares en informatique encore à ce moment. Nous voulons alors faire une sorte de blister, d’enveloppe-coque. Il s’agit d’un procédé industriel qui permet d’emprisonner des produits sous une enveloppe thermoformée transparente, ou non. Ce mode de production est très peu coûteux et rapide. Étant donné nos moyens, cette solution semble viable. De plus, ce processus technique peut générer une esthétique et donner la possibilité d’un corps changeant. En fonction de l’évolution technique, nous n’avons alors qu’à changer la partie arrière de la coque. Les deux parties de la coque sont deux blisters qui enferment l’ordinateur.
En poussant l’idée et en restant sur notre logique, on dessine aussi un clavier. On s'aperçoit alors que la création de nouveaux claviers est inutile, alors qu’il y en a déjà plein dans le monde et qu’on les jette. Ce qu’on va faire c’est de récupérer les claviers. Je vous parle de cette anecdote parce qu’on avait peu d’argent, notamment pour se créer un logo. Comme nous voulions marketer le produit, nous pensions peut-être changer juste une touche de ce clavier ou la sérigraphier. Un jour je me dis qu’en fait, sur tous les claviers il existe la touche « Alt ». C’est cette touche « alt » qui permet de générer d’autres fonctionnalités à partir du clavier. On se dit qu’on pourrait appeler l’ordinateur ALT, et ainsi ne pas avoir à le marketer, puisque la touche « alt » est déjà présente sur tous les claviers ! Donc notre premier ordinateur s’appelle ALT, et notre société MÉTA. MÉTA veut dire autre, alter, ailleurs. C’est ainsi qu’est né MÉTA IT, « IT » pour informatique et technologie.
Déjà à cette époque là, des travaux sur la green tech, la technologie verte existent déjà, et notamment quelques forums et revues sur lesquels nous nous tenons à jour de ce qui s’y développe.
Nous mettons au point une sorte de business plan où l’on explique ce qu’est le projet, ce que ça peut coûter à la louche, nos motivations, son importance sur un marché, son positionnement, … Nous proposons ce plan à l’incubateur de projets régional Aquitaine, à Bordeaux, et nous acceptent. Ils vont nous prêter des locaux, nous aider à monter la société, nous mettre à disposition un secrétariat et un peu de fond, le tout pour deux années de suite. Pendant deux ans on s’acharnent donc à développer Alt. Nous mettons plein de choses en place pendant ces deux années. On travaille sur la communication, on met au point un business plan très élaboré, on fait énormément de lobbying, on consulte beaucoup de personnes, on monte aussi un comité scientifique. Au bout de notre logique, nous sentons bien que nous nous tournerons vers la facilité. Ce qui ne nous gêne pas vraiment mais nous ne voulons pas pervertir nos objectifs politiques et idéologiques de départ, et ainsi devenir moins « green » que l’on voulait, et moins « alter » que l’on voulait. Pour ce faire, nous montons un comité scientifique dans lequel aucun de nous ne siège et qui aura autorité sur les décisions que nous prendrons dans la société. C’est en quelque sorte notre garde-fou. On a défini une charte de principe, et se sont eux qui vont valider si nos postures sont les bonnes d’un point de vue énergétique, technique, informatique, … vis-à-vis du projet.
Après avoir passé la période d’incubation à Bordeaux, nous devons mettre une autre vitesse. Nous commençons à avoir possiblement des précommandes, et surtout à avoir quelque chose de définitif. Nous changeons de cadre pour rejoindre une pépinière de jeunes entreprises, située au technopolitain Izarbel à Bidart. C’est-à-dire que les Basques sont en train de se positionner sur des questions d’ordre environnemental, social, industriel, … On retrouve donc plein d’entreprises de domaines différents. Nous avons donc des nouveaux locaux dans le Pays basque et nous recrutons quelques nouvelles personnes. De mon côté, je fais partie de l’équipe de la direction artistique et de conception, toujours sur la question hardware. C’est à ce moment qu’on arrive à une version à peut prêt fini que l’on va vendre. On va fabriquer une centaine d’exemplaires d’Alt, dont une grande partie va être vendue pour l’écoquartier émergent à Bordeaux, notamment dans la ville de Cenon.
Guillaume et Michael principalement, passent beaucoup de temps à trouver des financements et à essayer de convaincre. En effet, parce qu’en face de nous, nous n’avons pas Appel puisqu’ils sont plus du côté des particuliers, mais contre nous avons HP, Dell, Microsoft. Nous étions moins qu’un atome tandis qu’il sont gigantesques. C’est pourquoi nous avions du mal à convaincre, du fait des habitudes informatiques des gens. On arrive même dans un cas, pour convaincre quelqu’un d’une administration à passer à notre solution, à redécorer une interface graphique Ubuntu pour en faire une apparence d’un système Microsoft. On déguise alors à fond comme Microsoft, jusqu’à prendre tous les équivalents des logiciels comme Libreoffice et Openoffice pour en faire un faux Word. Après avoir fait des tests pendant un mois, les gens nous disaient que oui, cela ne changeait pas nos habitudes. Michael et Guillaume leur disaient alors qu’ils venaient en réalité de travailler sur un système Ubuntu.
On remarque donc qu’il existe une sorte de résistance aux habitudes informatiques et surtout une résistance par rapport à notre taille vis-à-vis de nos ambitions (David contre Goliath) et qu’il est difficile de trouver des business angels pour injecter de l’argent dans la société, et troisièmement que personne de sait ce qu’est l’éco-conception à ce moment. Nous perdons beaucoup, beaucoup de temps et d’énergie à expliquer à des personnes potentiellement intéressées ce que c’est. Même des gens importants ou issus de la politique qui auraient pû être nos appuis ne connaissaient pas. Il faut comprendre qu’entre ces 10 à 15 dernières années l’éco-conception s’est vraiment accélérée, au point de rentrer dans l’opinion. Pour nous, l’opinion n’en avait rien à faire à cette époque.
Donc, nous avons une solution fonctionnelle, utile, qui répond à plein d’enjeux, mais qui n’a pas l’adhésion du public. De ce fait, nous nous épuisons et peinons à trouver de l’argent pour financer le projet. Ensuite en 2014, Michael tombe gravement malade, il est atteint d’un cancer. Il s’en ira au courant de l’année 2015. Guillaume et Olivier continuent malgré tout la société, alors que je ne suis pas avec eux. Je vis sur Toulouse donc je fais des aller-retours tout le temps. Guillaume va tenir la boîte et faire en sorte que ça tienne le mieux possible, mais il va finir par solder la société deux ans plus tard, en 2017. Il n’y avait simplement plus assez de personnes pour tenir la barre. Olivier décide de s’en aller, j’étais moi en intermittence, et Guillaume gardait les rennes en développant la partie software (logicielle) et notamment des ERP. Nous faisions des ERP à partir de logiciel open source qui nous permettait de faire rentrer de l’argent, pour continuer MÉTA. C’était une manne pour continuer le développement hardware. Après une discussion avec Guillaume en 2017, on décide de stopper la société. On la revend à une société bretonne, et c’est ainsi que MÉTA s’est arrêté.
Je crois qu’un des tournants difficiles était justement le grand projet de l’écoquartier de Bordeaux. Nous pouvions faire partie de l’équipe EDF mais n’avions pas été retenu. On pense qu’on était trop petit et trop naïf. Nous étions dans une radicalité utopique, et c’est ce qui nous a fait perdre, à mon sens, l’appel à projet. Si je ne dis pas de bêtise pour l’appel d’offre, il s’agissait de produire 600 ou 700 ordinateurs. Le grand projet de ce quartier résidait dans ses bâtiments. Ces bâtiments devaient consommer le moins d’énergie possible. Ce que nous avions observé dans ces bâtiments notamment de type tertiaire, c’est que le gros de sa consommation énergétique était dû à la climatisation, pour plusieurs raisons. D’abord pour refroidir les locaux de travail et le personnel. Ces mêmes locaux qui sont réchauffés par la chaleur dégagée des ordinateurs et aussi des serveurs qui eux sont ventilés par des éléments de climatisations qui sont extrêmement énergivores. Nous avions aussi une solution de serveur très peu consommatrice d’énergie et qui par extension chauffait très peu. Tout ceci permet de réduire les infrastructures et donc les coûts de manière assez drastique.
Pour vous donner une idée, les unités centrales à l’époque consommaient environ l’équivalent de 330 watts, quand une solution Apple en consommait 170-200 watts, qu’un ordinateur portable en consommait 100-120 watts, et qu’un MacBook Air en consommait 80 watts ; nous en consommons 25 watts pour faire la même chose. Il fallait absolument que l’ordinateur consomme le moins d'énergie, pour réduire aussi ces problématiques techniques et limiter l’obsolescence du matériel. Pour limiter l’obsolescence on s’est concentré sur les points faibles de l’ordinateur, à savoir sa ventilation. À partir du moment où la ventilation capte trop de poussière dans l’air, les mécanismes s'enrayent et tous les dispositifs qui permettent le refroidissement des pièces comme le processeur ou la carte graphique sont mis en défaut, puisqu’ils sont mal ventilés. Si une puce est mal ventilée, elle va perdre en compétence. Pour palier à ce problème, nous avons réfléchi de la même manière que pour une formule 1 : de quoi n’avons-nous pas besoin ? Nous avons enlevé plusieurs pièces de cette manière.
C’est un des axes vraiment important du développement de la partie hardware. Nous devons refroidir un ordinateur sans ventilateur. C’est ce qui nous a guidé dans la conception et à faire des choix notamment de matériaux. Nous avions contacté une entreprise qui s’appelle Végéplast qui développe des bioplastiques. Ils ne trouvaient pas de débouchés à cette époque-ci, ils ne faisaient que des putters pour le golf. Et donc nous avions pensé utiliser du Végéplast pour faire notre coque d’ordinateur. Seulement puisque nous avons enlevé la ventilation, il nous fallait un matériau capable de chauffer et de refroidir très vite. De manière très accessible il n’y en a qu’un seul, c’est l’aluminium. De plus, ce matériau est recyclable à 99%. C’est ce matériau que nous avons choisi pour la conception hardware.
Sa conception était particulière, nous avons été les premiers à le faire comme ce qui suit à cette époque. L’idée de départ était de se dire que notre ordinateur est un client léger, un accès bureautique. Donc il nous faut un écran, un pied pour le supporter à une certaine hauteur et un clavier avec la solution dont je viens de vous parler. Il y a une carte mère, un transformateur électrique, un processeur, et tout le reste qui permet au système de transmettre les informations électriques entre chacun des éléments. Tout ceci rentre dans une coque d’un côté et de l’autre. Les coques sont séparables et démontables le plus rapidement possible. S’il doit se refroidir, je me suis dit qu’il devrait se refroidir comme un corps vivant, et plus précisément comme un corps humain. Ce sera donc sa peau qui lui permettra de se refroidir. La coque n’est donc pas qu’un simple élément de capotage mais un élément structurel. À la manière insecte, les parties souples sont à l’intérieur de son squelette tandis que nous avons les parties souples à l’extérieur du squelette. Nous avons alors notre coque qui agit à la fois comme un squelette, et à la fois comme une peau, qui n’est pas contre certes pas souple. Sur des premières versions pourtant c’était le cas, puisque nous avions utilisé à un moment une peau en latex souple. Nous nous fournissions dans des magasins de BDSM en Allemagne, à Berlin. Ils nous envoyaient des rouleaux de latex qu’ils utilisaient pour la création de leurs vêtements. Pour revenir à notre peau en aluminium, nous avons testé d’abord des système de flux d’air dirigé vers le haut, avec des aération. Seulement le rendement n’était pas suffisant avec ce principe de physique simplifié. Nous avons finalement réalisé des « pontets » (ponts thermiques), qui relient la coque aux éléments chauffants. De cette manière, la coque recueille la chaleur et la dissipe sur son ensemble. Ainsi, nous pouvons nous priver de la ventilation active.
Nous avons effectué des tests de stress intense de la machine, et celle-ci n’est monté qu’à 29 watts d’utilisation. Notre plus long test à durer, si je m’en souviens bien, 15 jours sans jamais s’arrêter de calculer, bugger ou s’éteindre. Nous avons aussi testé dans pièces dont la température ambiante était plus élevée et toujours aucun problème. C’est vrai que nous n’avons jamais testé en situation de tropicalisation absolue, avec par exemple un taux d’humidité record.
AG - La dalle aussi chauffe, dans une certaine mesure. Comment avez-vous fait pour ce composant ?
Brice Genre - Pour le type de dalle je ne pourrais pas vous dire exactement, on a essayé pleins de trucs différents avec différents fournisseurs. Le but est d’avoir des pièces fabriquées le plus possible en France ou en Europe, sauf pour la carte mère qui venait d’un revendeur allemand : l’objectif est de localiser autant que faire se peut sa production (45:55). On avait imaginé un modèle économique global où META ne serait pas comme une franchise, mais plutôt comme: si quelqu’un voulait créer une société META, il le pourrait, dans n’importe quelle région de France ou n’importe quel pays d’Europe voire du monde, puisque le projet serait complètement open-source. On avait plusieurs versions en insérant une clé dans la peau de l’ordinateur, dans laquelle il y avait tous les schémas de construction, tous les modes de production et tous les plans nécessaires pour pouvoir le re-fabriquer. Il avait donc au saint de sa peau tout ce dont il avait besoin pour être re-fabriqué. Puis est venue une version plus simplifiée: dans l’interface graphique de l’ordinateur, il y avait un dossier, qui une fois activé, donnait accès à toutes les informations et toutes les métadonnées qui permettait la reproduction de l’ordinateur. Mais à partir du moment où on apportait une modification, il fallait qu’on soit consulté pour avis. Puisqu’il fallait optimiser l’ordinateur pour qu’il consomme moins d’énergie, moins de matériaux, etc.. c’était à nous de créer l’élément zéro perfectible(47:13), et les autres ne pouvait que soustraire des choses, et non ajouter. Par exemple, si une administration au Maroc veut produire, plutôt qu’être éligible d’une colonisation économique, ils peuvent décider de produire d’eux-même à partir d’une franchise qui était la nôtre. Et toutes les améliorations qu’ils pouvaient produire, comme un produisant, ils devaient impérativement alimenter ce giga fichier qui se trouvait sur ordinateur, et d’améliorer le modèle, comme si c’était un ADN vivant qui augmente ses capacités et ses performances pour chaque contributions. Autre chose: sur la partie hardware j’avais travaillé sur le fait d’éteindre l’ordinateur. Avec notre travail d’analyse, on s’est rendu compte que dans les bureaux, les gens partaient après leur journée de travail sans forcément éteindre l’ordinateur, ils attendaient que la mise en veille se fasse. On s’est donc questionné sur ce geste d’éteindre l’ordinateur, et on avait pensé à des gestes simples, comme souffler sur le micro pour l'éteindre, un peu comme une bougie. On voulait tout de même qu’il s’éteigne complètement, c’est pour ça qu’on a maintenu l’interrupteur d’alimentation qui se trouvait sur le dessus. Guillaume et Olivier ont travaillé sur un système de mise en veille qui permettait de limiter toute perte d’énergie résiduelle dans l’appareil, et la seule qui chose maintien de l’électricité, c’était un bout au niveau du processeur et du micro, car pour rallumer l’ordinateur on pouvait re-souffler dessus. Donc on réfléchit sur pleins d’aspects différents, sur des principes au niveau du geste ou de la condition structurelle.
Là je vais vous montrer la dernière version. Et après je vais vous montrer, on va faire un serveur, qui lui s’appelait Ctrl. C’était une aventure qui a duré une dizaine d’années, ça a demandé beaucoup d’énergie mais c’était passionnant. Ce qui était fou, c’est que des années plus tard - en 2019 je crois - je montais sur Paris avec Anthony pour une conférence de geeks, de graphistes et ce genre de chose, et on avait été invité là-bas par Manuel Raeder et Raphaël … Et puis dans la soirée je discute avec un gars qui me demande ce que je fais, donc je lui explique « je suis designer, je dessine des ordinateurs, j’ai dessiné Alt » et à ma grande surprise il connaissait Alt, et apparemment tout le monde connaissait Alt aussi. Il m’a expliqué: « On étaient à un rassemblement de geeks en Belgique, et pour nous vous étiez la solution. » Et c’est cool de découvrir qu’il a des gens qui se regroupent et font des sortes de happening autour de ça, qui s'inspirent de l’esprit open source.
AG - Et vous ne savez pas si par la suite ils se sont inspirés de vos travaux ?
Brice Genre - Non on ne sait pas vraiment, mais on a quand même vu des choses qui nous ont fait rire. Mais c’est cool, on a eu quelques articles de presse nationale. Je vais vous montrer le diapo’, ce sont des images de com’ qui malheureusement ont plus de 10 ans, donc ça date un peu. (explications du projet Alt vu de dessus, du logo et du référencement): et c’est un vrai objet qui existe, qui a été photographié en studio. Mes inspirations viennent principalement de l’univers d’Apple, Braun, Dieter Rams et de toute cette culture du design industriel et optimal. Donc sur l’image on peut déjà lire où est hébergée la carte mère, la partie transfo’ avec la prise de connexion, et il y a 6 vis où vous pouvez tout voir à l’intérieur(54:45). Toute la coque est un dissipateur thermique, et il y a deux versions: une version blanche en aluminium thermolaquée et l’autre est une version aluminium brossé, presque comme ce qu’on peut voir sur un Mac. Et ça, c’est le pied, cette rigole ici. Quand j’ai fait l’analyse structurelle des pc, et surtout des écrans, il n’y avait que Mac qui avait fait cette espèce de dalle et de pied, et c’est tout. Mais on s’est dit que c’était quand même une solution intéressante puisque ça permet de rassembler l’écran et l’ordi, de limiter spatialement le truc, limiter le nombre de câbles encombrants, juste le câble d’alimentation et Ethernet et c’est terminé. On s’est aperçu pendant l’analyse qu’on avait déjà les tours, et aussi les écrans, qui devaient s’orienter pour pouvoir travailler, et pour pouvoir articuler le pied sur quelques degrés, il fallait une charge mécanique assez complexe, et il fallait fabriquer entre 13 et 28 pièces manufacturées pour articuler un écran. Donc je me suis dit qu’on allait réduire ce nombre le plus possible: je me suis donc inspiré des chevalets de peintre. Et j’en ai mis du temps à trouver cette solution, c’était un dimanche après-midi je crois, et j’ai vu un système de compas et de chevalet, et c'était ça, tout simplement. Donc Guillaume m’a aidé pour savoir quelle était la longueur exacte de la rigole, la longueur exacte de la lumière par rapport aux angles qu’on voulait donner à l’ordinateur. Mais l’idée, c’est d’avoir une pâte qui est pliée - donc au niveau de la fabrication et de la consommation, c’est rien du tout - qui est utilisée sur les grands compas qu’on trouve sur les tableaux d’écoliers, donc ce sont des petits objets industriels qui existent déjà comme des objets semi-finis, qui sont utilisés par de grands industriels dans des catalogues, pour à peu près n’importe quel type d’objet. Donc l’idée c’est de placer le pied de la rigole ici, on le vise et c’est fini. Et on se sert de l’épaisseur de peau de cet endroit-là de la coque de l’ordinateur pour faire le pas de vis, il n’y a pas d’inserts. C’est pleins de petites idées qui s’assemblent comme ça, hier vous en parliez, le problème était que: « quand j’ai récupéré le matériaux, il y avait pleins de petits trucs à l’intérieur, je n’ai pas réussi à tout enlever pour faire fondre ma pièce ». Nous ce qu’on voulait, c’est d’enlever tout le matos à l’intérieur - on appelle ça la bareback - de l’ordinateur une fois qu’il est démonté, et on se retrouve avec un minimum de pièces industrielles, avec un cadre qui fait également le piètement, ensuite on a cette plaque avec ce morceau de coque qui sert de support: ce qui fait donc 5 pièces pour l’ensemble de l’ordinateur, plus 6 vis et les éléments électroniques qui se trouvent à l’intérieur.
3. Entretien avec Marlène, coordinatrice de l’association Cadavres Exquis
Entretien mené le 21 novembre 2024.
----------------Arthur Goujon (AG) - Peux-tu présenter l’association et ce que tu y fais ?
Marlène - Cadavres Exquis est une association d’une trentaine d'adhérents dont je fais partie. Je suis à 100 % dedans, c’est moi qui coordonne l'association. On fait des opérations de temps en temps où les adhérents aident à nettoyer les plastiques. Aussi, sur un tableau en ligne qui répertorie les actions de sensibilisation, je les invite à me donner un coup de main en remplissant les dates pendant lesquelles ils sont disponibles. Nous avons fait des ateliers avec des lycéens, au CNRS, à l'hôpital Gérard-Marchant spécialisé en psychiatrie et en santé mentale, ou encore sur de l'événementiel, … On touche différents publics. On se déplace pour ces ateliers avec ce qu’on appelle la recyclerie mobile, composée de la presse et du broyeur. Sur un événement, parce qu’on avait les moyens logistiques, nous avions réussi à emmener la machine à laver vélo. On travaille aussi en ce moment sur la conception d’une kermesse pour sensibiliser grâce au jeu.
On ne fait pas que des ateliers, mais aussi des ventes. Nous serons au marché de Noël de Toulouse pendant deux jours avec des pièces et des bijoux fabriqués pour l’occasion. Ensuite, nos adhérents peuvent créer des objets pour l’association et en faire des objets de ventes, ou pédagogiques. Nous avons fait des recherches sur le territoire et aujourd’hui encore, il y a beaucoup de demandes d’ateliers de sensibilisation. Nous ne faisons jamais de grande série, comme les trophées pour Toulouse Métropole par exemple. L’année prochaine nous allons travailler avec Recyclo’bois, qui recycle le bois.
Nous aujourd’hui on recycle essentiellement du HDPE et du polypropylène. L’ABS n’est pas très bon et compliqué à travailler, pas très sécurisé en termes de recyclage et de procédé. On récupère le plastique que l’on tri par catégorie. Il existe aujourd'hui des outils technologiques comme un scanner qui te dit de quel type de plastique il s’agit, sauf sur les plastiques sombres. Nous n’avons pas ces moyens en tant qu’association à Cadavres Exquis. Ce sont les adhérents qui nous aident : on tri et on nettoie avec une machine à laver vélo. On fait pré-tremper les plastiques que l’on rince ensuite dans la machine, le tout pour ne pas utiliser d’électricité. La partie la plus importante dans le recyclage de plastique c’est le tri : par matière mais aussi par propreté. Plus ton plastique est pur et propre, plus ton produit fini sera esthétiquement léché. C’est pour cela que nous faisons un pré-tri en fonction des plastiques et des objets. Les petits bouchons par exemple ne sont pas viables, une fois broyés ils ne produisent que très peu de copeaux et sont souvent recouverts d’étiquettes et donc de colles. Donc on fait un pré-tri, on nettoie, on fait sécher et ensuite seulement on tri à cent pour cent. Avec une lampe qui nous aide à voir plus claire, on regarde chaque pièce que l’on tri par couleur et par plastique. Si les pièces utilisées ne sont pas propres, la saleté va brûler et noircir le plastique. Une fois triée par catégorie et par couleur, on peut utiliser le broyeur.
On recycle beaucoup le plastique de catégorie 5, le polypropylène (PP). Cette catégorie regroupe certains bouchons, du packaging, du mobilier de jardin, des kayaks, … Ce sont des objets qui ont une résistance mécaniques certaines. Il faut être attentif au PP, puisque entre deux objets de cette matière, les deux peuvent réagir différemment. Deux industriels différents ajoutent chacun des additifs dans leur produits, à la manière d’un boulanger qui ajoute un peu plus ou un peu moins de sel dans sa baguette. On se retrouve donc avec toujours avec le même objet, une baguette, mais qui goûte ou réagit différemment. De ce fait, par exemple, nos plaques ne sont pas toujours régulières étant donné que les produits initiaux (transformés par des industriels), ne sont pas standardisés.
AG - Pourquoi le PC-ABS est difficile à recycler comme tu me l’as dit plus tôt ?
Marlène - Chez Cadavres Exquis nous ne le recyclons pas car nous nous sommes fier à la communauté qui nous à fait comprendre que c’était compliqué, que les émanations pues et qu’elles ne sont pas très bonnes pour la santé, surtout à notre échelle artisanale, sans hotte aspirante.
AG - Qu’est ce que le HDPE ?
Marlène - On peut prendre pour exemple une bouteille de soda : elle est composée de trois plastiques différents. La bouteille est en PET. Il s’agit du plastique transparent qui est très bien recyclé par les industriels. Le PET constitue l’essentiel des 25 % du plastique recyclé en France et aussi des moins de 10 % dans le monde. Ensuite le bouchon est de catégorie deux, à la manière de beaucoup de contenant comme des bidons de lessive, des jerricans, … Enfin l’étiquette de la bouteille qui est un plastique fin, du LDPE, qu’on trouve aussi sous la forme des sachets en plastique. Nous ne le recyclons pas chez Cadavres Exquis aujourd’hui car nous n'en avons que très peu.
Nous faisons partie de la communauté Precious Plastic. Precious Plastic est une communauté qui existe depuis 2013 et qui a été créée par un étudiant en design qui est parti du principe que le plastique était mal recyclé dans le monde. Il a construit des machines open source pour que les gens se réapproprient le recyclage des plastiques. Il a créé un mini laboratoire, a reçu des financements, et a fondé cette communauté mondiale qui aujourd’hui partage beaucoup de choses dont nous faisons partie. La particularité de Precious Plastic France, c’est quelque chose de très français, s’est monté en association. L’association Precious Plastic France, qui est en train de prendre une autre direction aujourd’hui, regroupe des partenaires partout sur le territoire, de la Belgique jusqu’à la Guyane.
Precious Plastic France à plusieurs antennes en France, mais la volonté aujourd’hui est d’avoir une communauté et une association nationale soudée. De cette manière, l’association unifiée pourra avoir du poids et toquer aux portes des pouvoirs publics plus facilement, là où beaucoup de décisions sont prises. Il y a assez de plastique dans chaque territoire pour le réutiliser pour faire du mobilier urbain, des objets de la vie de tous les jours, … Il faut par contre des décisions des politiques pour aider les structures à recycler ce plastique, et ensuite et surtout arrêter la production de plastique. 40 % du plastique aujourd’hui est jetable, donc quand il n’est pas recyclé où va-t-il ? Incinérer à l’autre bout du monde si ce n’est pas enfoui sous terre ?
On a une presse à injecter. Le principe de la presse est de mettre les copeaux en plastique broyés à l’intérieur pour les chauffer. On met un moule en aluminium sous la presse, on appuie et en quelques secondes tu as produit un objet. Les moules ont une entrée de buse. Quand cette entrée est en contact avec la buse de la machine (la partie par laquelle le plastique chemine dans le moule), le plastique est injecté. Si on presse le bras de levier pour faire sortir du plastique sans moule, il ne va rien se passer. Il faut qu’il y ait un contact entre le moule et la buse. En pressant la buse contre le moule, la buse remonte de quelques millimètres dans la machine ce qui l’ouvre, et permet au plastique de s’injecter dans le moule.
L’injection est un des procédés que nous effectuons. L’extrudeuse ensuite, est une visse sans fin. De la même manière que la presse à injecter qui a une capacité réduite selon la taille de la machine mais surtout du moule, du moment que du plastique se trouve dans l’extrudeuse, la machine est en marche. Cette machine permet donc de produire des formes dites profilées (une même forme qui sort en continu de la machine), comme des briques de plastique par exemple.
Le troisième procédé que nous utilisons est la compression. Nous avons récupéré une presse à t-shirt pneumatique que de copains qu’ils n’utilisaient pas. Elle nous permet de faire de chouettes plaques. Nous avons deux plaques en aluminium téflonné sur lesquelles on pose des cadres qui font entre 2 et 10 millimètres d'épaisseur. On ajoute le plastique a l’intérieur des cadres que l'on met sous la presse à 210°. Comme en pâtisserie pour un gâteaux, il y a un temps de cuisson qui varie en fonction de l’épaisseur de la plaque. Après le temps de cuisson, on met la plaque sous cette presse à froid pendant une heure ou deux. Cette manipulation permet à la plaque de refroidir sous contrainte et d'éviter toutes déformations.
AG - Sous quelle forme ajoutes-tu le plastique dans tes cadres ?
Marlène - Cela dépend, nous en avons fait avec des chutes par exemple. Ici justement avec des chutes de pièces d’une personne qui travaille pour Airbus. Il découpe des grandes plaques en plastique translucide que nous avons récupérées. C’était des plaques non utilisées et stockées dans un garage, donc un peu sales. On retrouve cette saleté dans la plaque finie parce que le plastique est compliqué à nettoyer. ça m’embêtait de jeter ces plaques même sales, donc j’ai essayé en utilisant un apport de bouchons en plus. Je me suis retrouvé avec une plaque coloré et translucide que je pourrais usiner en luminaires par exemple. Nous faisons aussi avec ces plaques, des trophées pour Toulouse Métropole qui ont été remis mardi dernier, des horloges, des supports de téléphones et nous développons même des boucles d’oreilles en ce moment avec une petite découpe numérique. Donc aujourd’hui nous avons ces objets-ci qui nous servent pour la sensibilisation. Pendant les ateliers, on explique aux personnes présentes comment recycler le plastique, pourquoi, etc. En même temps, nous leur faisons faire ces objets pour qu’ils repartent avec du concret de nos ateliers. On a un petit broyeur rangé là-bas. Il est manuel et sur roue.
Les premières plaques que nous avons faites ont été chauffées dans un four de cuisine standard. J’avais récupéré deux plaques en aluminium très fines que j'avais mises dans des moules en bois, comme un coffrage. Les plaques en métal permettent de bien diffuser la chaleur et évite au plastique de trop coller dans le moule. Avec une feuille de téflon dans le fond, je mettais les bouchons en plastique directement dans mon moule, on n’avait pas encore de broyeur. Dès que la matière fondait, j’utilisais des gants pour malaxer la pâte chaude.
AG - Est-ce qu’on peut faire les mêmes choses avec du plastique recyclé qu’avec du neuf ?
Marlène - Nous ne savons pas exactement puisque nous ne recréons pas les mêmes objets à partir desquels nous partons. Ce qu’il faut par contre, à la base et dans tous les cas, c’est que le plastique soit pur. Dans notre cahier des charges de tous projets, notre objet doit être recyclable. Dans le trophée pour Toulouse Métropole, rien n’est collé. Il n’y a que deux vis et un socle en bois. C’est-à-dire que le jour où ils en ont assez de voir leur trophée, ils le dévissent et peuvent recycler le plastique.
AG - Serait-possible selon toi d’avoir un perma-plastique à la manière du permacomputing ?
Marlène - Sur les revêtement d’ordinateur portable tu as souvent des films par dessus la coque pour les faire briller et les embellir. C’est la même histoire que pour les pots de yaourt qu’on arrive pas à recycler à cause de toutes leurs couches de plastique différents. C’est donc toujours la même histoire, si à la base le plastique est propre et pur, il n’y a pas de problème. Sinon, le procédé sera plus compliqué.
4. Rapport de stage dans l’association Cadavres Exquis
Pendant deux mois, Marlène m’a ouvert les portes de son atelier au sein de l'association Cadavres Exquis. Après l’avoir rencontré autour d’une discussion autour du plastique et de son recyclage, l’idée d’un stage surgit. De mon côté pour apprendre les processus semi-industriels à petite échelle du recyclage du plastique et de toutes les étapes que cela implique. Pour Marlène et l’association, c’est une paire de bras supplémentaire et quotidienne pour la conception de leur atelier naissant : la fête foraine du plastique. L’historique de l’association est disponible en annexes. Marlène partage un atelier avec Ramik, un tourneur sur bois qui nous a énormément aidé grâce à sa connaissance des matériaux mais aussi des procédés de fabrication. Sans son aide précieuse, certains jeux comme Pepito n'auraient jamais été possibles.
L’association cherche à étoffer son catalogue d’ateliers. La kermesse ou la fête foraine du plastique est une idée que Marlène et les adhérents ont eue. Tout le monde s’imagine la kermesse : un parcours de jeux en plein air pour petits et grands. La spécialité de l’association étant la sensibilisation autour du plastique et de son recyclage, la kermesse du plastique sera alors un parcours de jeux éducatifs qui retrace les différentes étapes du recyclage du plastique. Pendant huit semaines, j’ai conceptualisé les idées encore frivoles que Marlène imaginait.
Marlène étant à mi-temps dans l’association, j’étais en autonomie au moins la moitié de mon temps. Afin de coordonner mes idées et mes actions avec elle et leurs bénévoles de l’association, nous avons créé un document en ligne où tout archiver. Ce document retrace l’historicité de nos idées concernant la kermesse. En scrollant, le document défile au rythme des jeux et des interludes descriptives pour les futurs animateurs. La signalétique a fortement conditionné l’architecture du document. L’objectif pour les enfants qui participent à la kermesse est de jouer, mais aussi de se sensibiliser au recyclage du plastique. À chaque étape ludique, les panneaux de la signalétique donnent les instructions du jeu, des indications sur l’étape du recyclage à laquelle les enfants se trouvent, et des chiffres autour du plastique.
Le parcours comme nous l’avons imaginé se déroule ainsi.
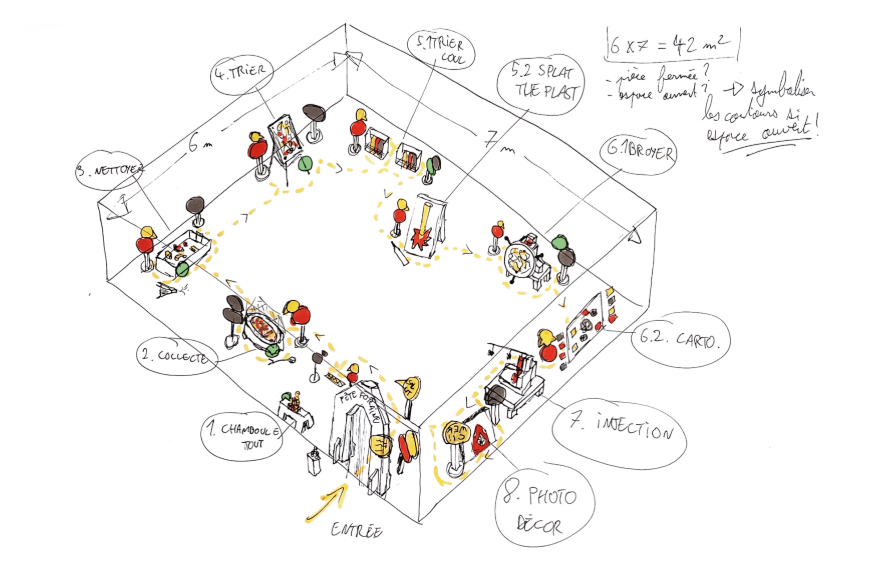
On commence par « Les 7 Plastocards », un jeu de chamboule-tout qui veut nous faire connaître les sept plus pollueurs de plastique (Coca, Nestlé, …). On continue avec la « Pêche au plastoc ». On récupère tous les plastiques dans un océan de bouchons le plus vite possible. Après leur récolte, les plastiques doivent être nettoyés. On se dirige alors vers « Total Plastout », le seul jeu avec de l’eau (contenue). Ensuite, au jeu suivant nommé « Tête à Plast », il nous faut trier deux catégories de bouchons en les envoyant à son partenaire de jeu, dans les bons sceaux. Après ce moment de défouloir, les enfants se concentrent dans un jeu de mémoire : (Mémoplasto). Ils apprennent que le tri par couleur est important pour avoir le choix par la suite. Le dernier jeu mais pas la dernière étape, « Pepito de la muerte ». Une roue de vélo labyrinthique tourne en même temps que les bras de levier du broyeur. L’objectif est de broyer le bouchon coincé dans le dédale en le faisant tomber dans le broyeur. Enfin, uniquement après avoir complété toutes ces étapes, les enfants peuvent injecter un toupi souvenir en plastique recyclé.
L’exercice de conception était d’autant plus challengeant que l’association avait vendu une prestation pour cette kermesse, à la sortie même de mon stage. Certains jeux ont demandé plus d’attention que d’autres. Pepito en fait partie, puisqu’il nous fallait trouver un mode de rotation axé sur les mouvements du broyeur manuel. Avec une roue de vélo et des courroies de chambres à air, nous sommes parvenus à un résultat suffisant pour la première prestation. Le bouchon se coince dans le parcours par moment, la roue est difficile à engendrer pour les plus petits et il est impossible de broyer en même temps que de jouer. Les dents ont tendance à se bloquer. Tous les jeux sont fabriqués à partir d’un maximum de matériaux de récupération. Hormis la quincaillerie, quelques feuilles et de la peinture.
Une grosse partie du temps a été consacrée à la conception de cette fête foraine du plastique, baptisée « Plastique Paradise ». Les jeux changeaient de formes, de concepts entiers parfois même. Ci-après quelques croquis d’intentions de jeux.
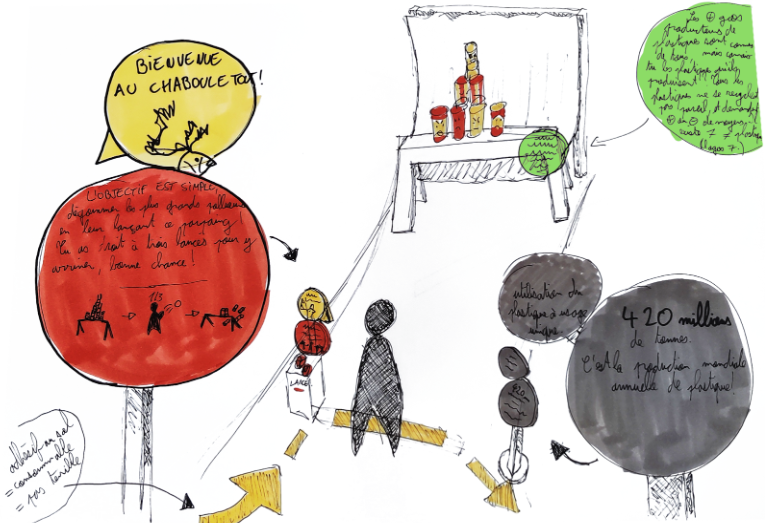
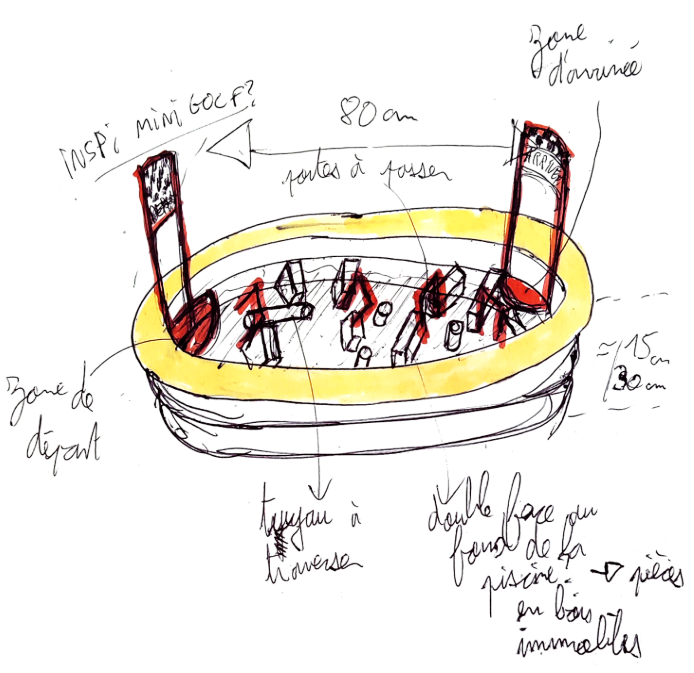
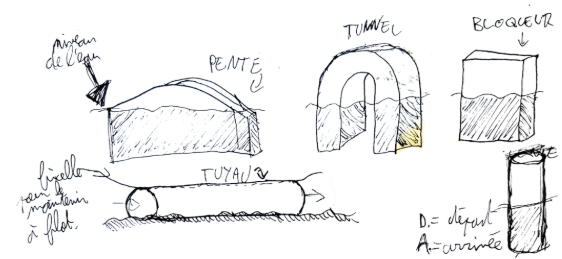
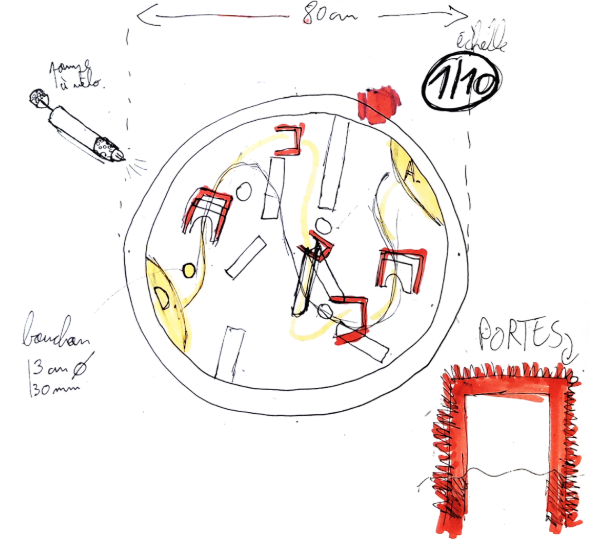
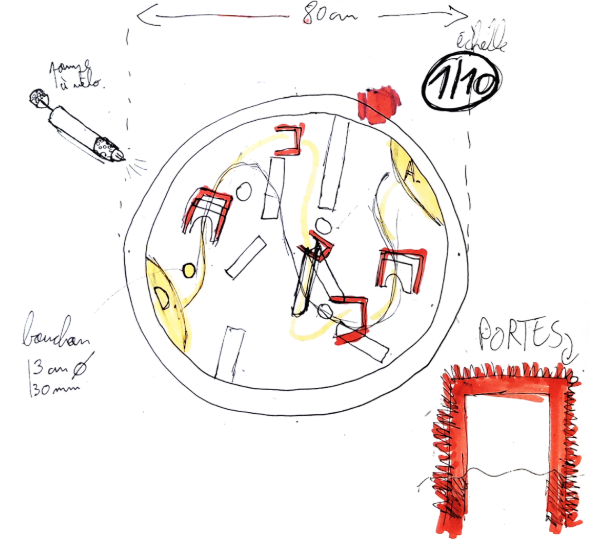
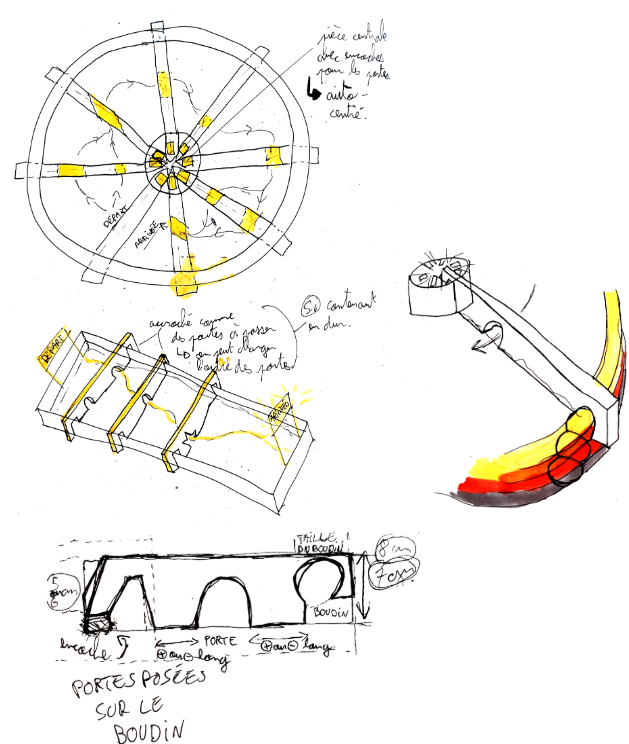
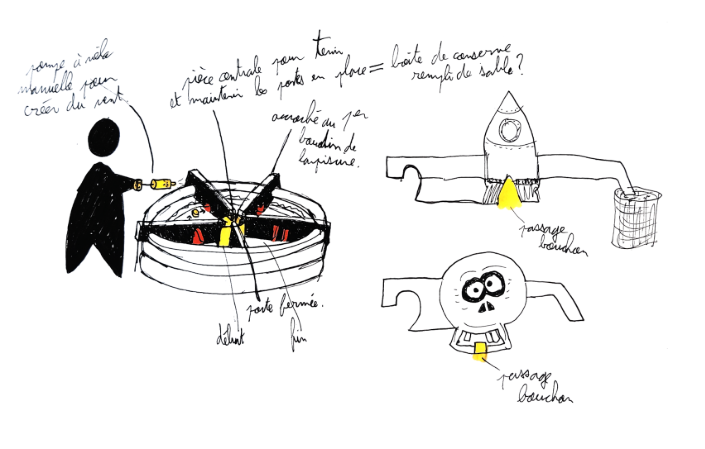
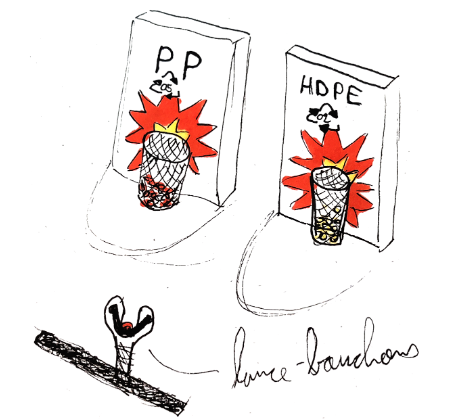
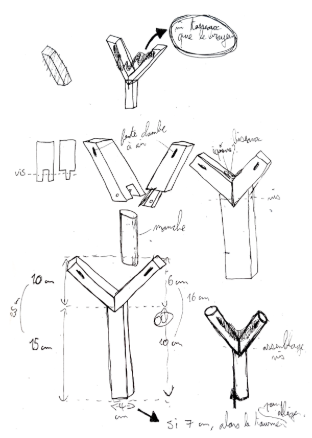
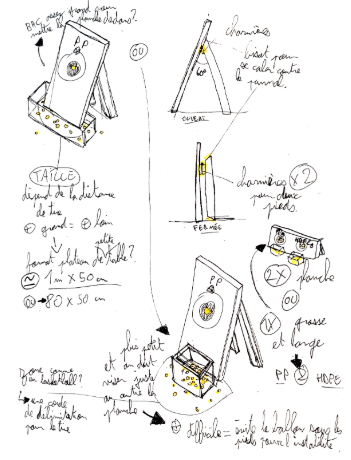
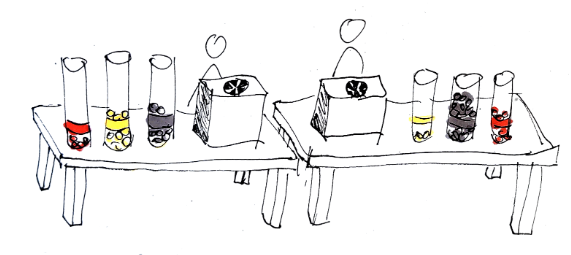
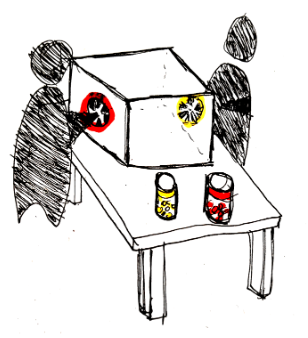
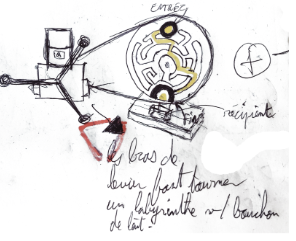
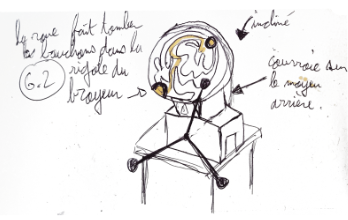
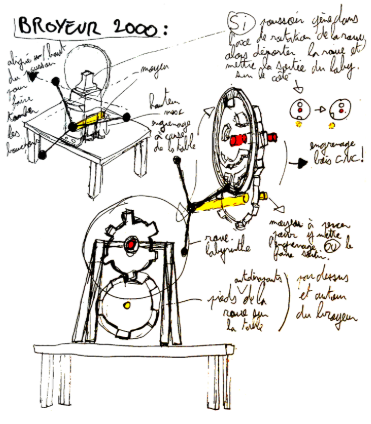
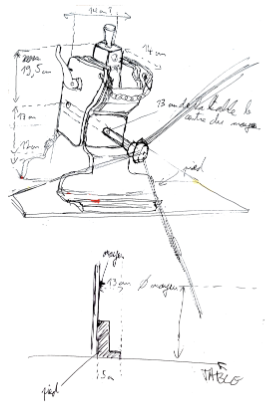
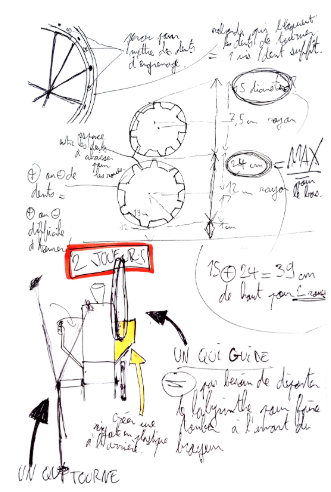
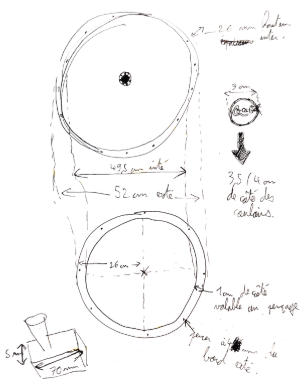
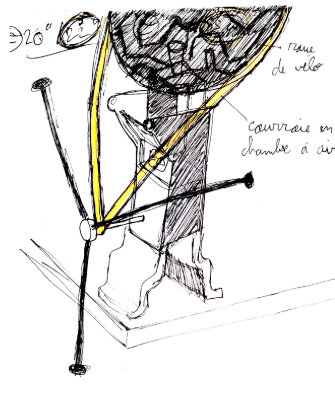
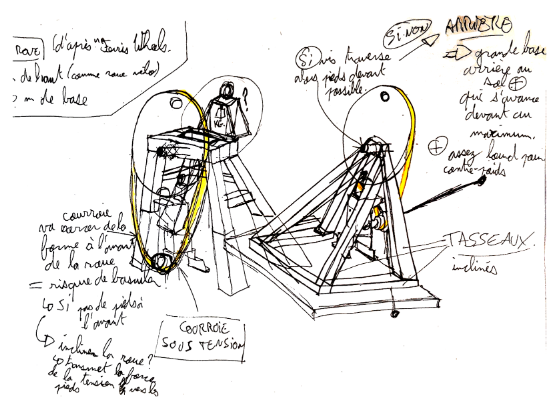
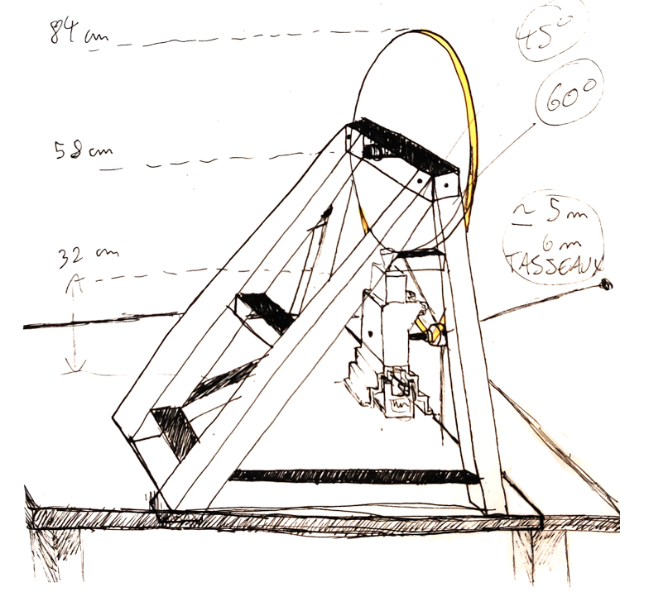
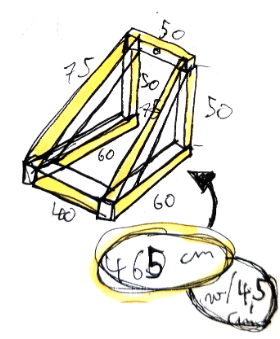
En plus des jeux, la signalétique est une partie assez conséquente. C’est elle qui a ouvert la voie à une homogénéité. Néanmoins elle n’existe pour le moment qu’en plan vectoriel. L’association est encore jeune, et nous voulons être certains des de pouvoir amortir économiquement la production d’un mobilier de cet ordre. De plus, les premiers tests nous diront si les textes méritent révisions.
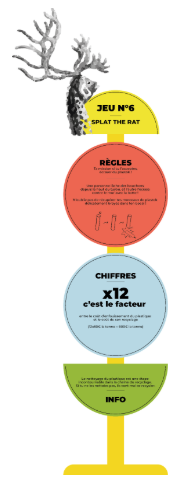
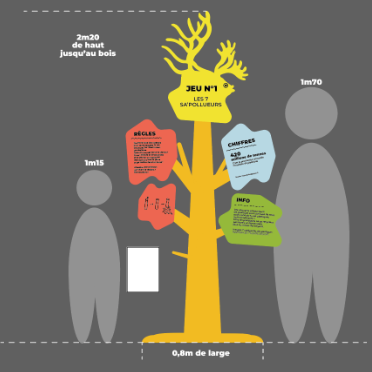
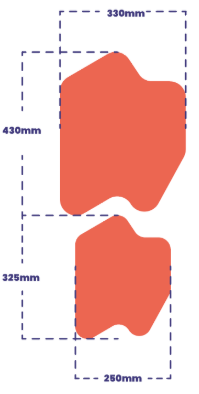
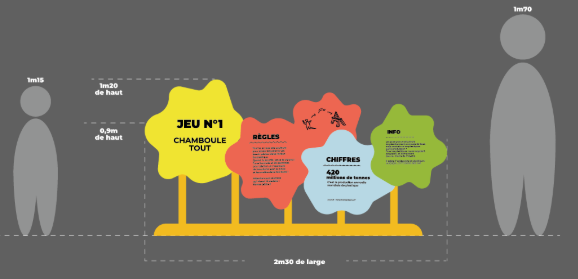
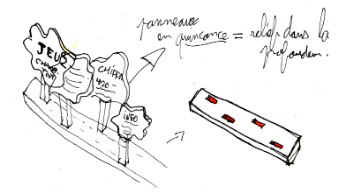
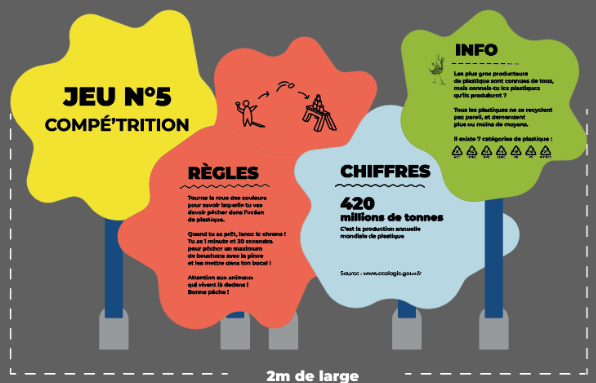
Après avoir organisé la première fête foraine du plastique, nous avons immédiatement remarqué plusieurs choses avec Marlène. Dès la première étape, les enfants ne souhaitaient que jouer, et ne surtout pas lire les cartes avec les règles, les indications et les chiffres clés du plastique. La transmission d’information est donc à réimaginer. Ensuite, nous étions entre 4 et 5 pour animer la kermesse. La ressource humaine est rare et précieuse dans le milieu associatif, et même avec ce nombre de bénévoles, nous arrivions à peine à gérer la foule, les jeux sont peut-être trop rapides.




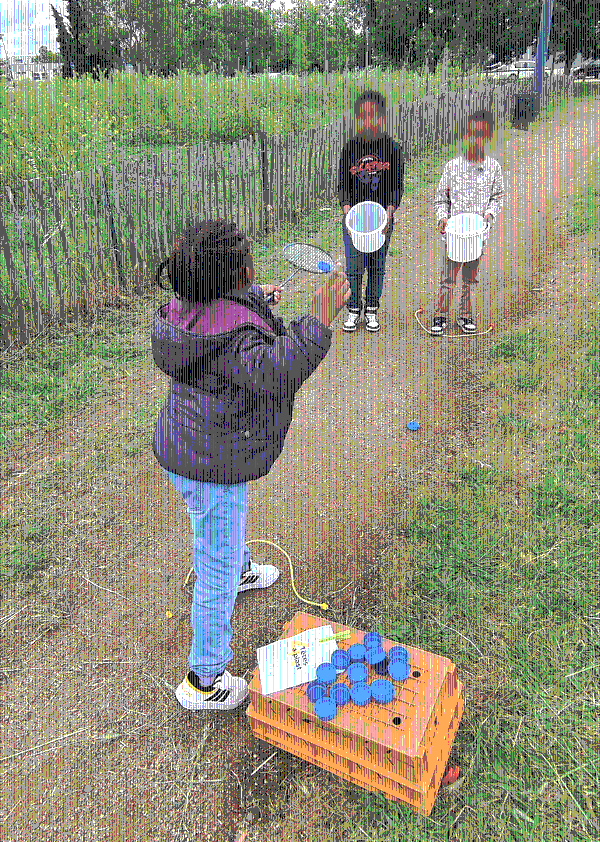
Enfin, à côté de la conception de « Plastique Paradise », Marlène a pris le temps de me partager son savoir-faire du recyclage du plastique. Grâce à la presse à injecter, au broyeur électrique, à la presse à t-shirt et bien sûr au vélo elliptique relié à une machine à laver, l’association est équipée pour la production à petite échelle. Elle m’a expliqué ses expérimentations de grammage par volume pour arriver à ce résultat aujourd’hui. Tout est consigné dans un tableur, formule mathématique en fonction de l’épaisseur voulue et du type de plastique, les tests précédents et leurs grammages suivis de remarques, … Le travail de la plaque est intéressant visuellement. Le broyat s’écrase sous la presse chauffante et doit être retourné pour homogénéiser la fonte. Une fois sortie, un côté est diffus tandis que l’autre respecte approximativement les motifs créés à sec. Il est possible de dessiner dans la matière grâce à cette technique.



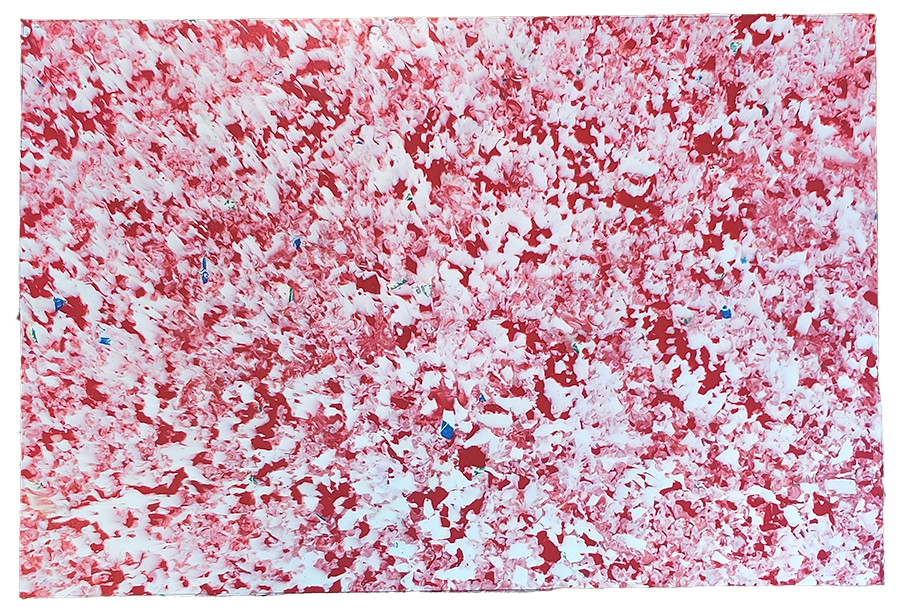
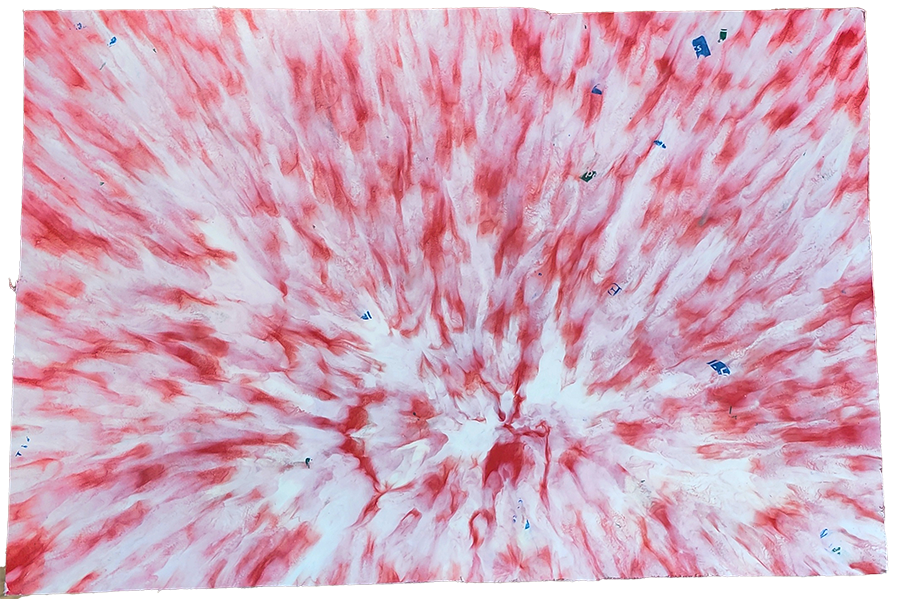
Glossaire
A
ABS : Acrylonitrile Butadiène Styrène, un plastique robuste utilisé en impression 3D et dans divers produits.
Adobe : Entreprise éditrice de logiciels graphiques comme Photoshop, Illustrator ou InDesign.
ASCII : Code standard pour représenter les caractères alphanumériques en informatique (American Standard Code for Information Interchange).
Anthropocène : Période géologique actuelle, marquée par l’impact significatif des activités humaines sur la Terre et ses écosystèmes.
B
Bedrock : Fondement ou socle d’un système informatique ou géologique.
Boîte noire : Système dont le fonctionnement interne est caché ou complexe à comprendre.
BIOS : Basic Input/Output System, un programme basique gérant le démarrage d’un ordinateur.
Bitmap : Représentation d’une image par une matrice de pixels.
C
Carte graphique : Composant matériel qui gère l’affichage et le rendu d’images sur un écran.
Carte mère : Composant central d’un ordinateur, connectant tous les autres matériels.
Clavier : Périphérique permettant de saisir des caractères et des commandes dans un ordinateur.
Cloud (nuage) : Serveur distant permettant le stockage et l’accès à des données via Internet.
Code source : Ensemble des instructions d’un logiciel écrit dans un langage de programmation.
Composants : Éléments physiques d’un système informatique (processeur, RAM, etc.).
Collapse computing : Approche informatique favorisant des solutions résilientes et simples face à un contexte d’effondrement.
Collapsologie : Étude interdisciplinaire des risques d’effondrement des sociétés modernes.
CSS : Cascading Style Sheets, langage de style utilisé pour la présentation des pages web.
Customiser : Modifier ou personnaliser un objet ou logiciel selon ses besoins.
Cyberculture : Culture émergente liée à l’usage des technologies numériques.
Cyberpunk : Genre de science-fiction dystopique, explorant les impacts des technologies sur la société.
D
Dalle : Surface d’affichage d’un écran.
Décroissance : Mouvement prônant une réduction de la production et de la consommation pour préserver les ressources.
Demoscene : Communauté créant des démonstrations audiovisuelles exploitant les capacités des ordinateurs.
DIY (do-it-yourself) : Approche où les individus fabriquent ou réparent eux-mêmes des objets.
Dystopie : Société imaginaire présentant un avenir sombre ou oppressif.
E
Écosystème : Système formé par les interactions entre des organismes vivants et leur environnement.
Effondrement : Désintégration d’un système ou d’une société.
Émulateur : Logiciel permettant de simuler un matériel ou un système sur une autre machine.
F
Frugal computing : Utilisation de ressources informatiques minimales et durables.
G
Game jam : Événement où les participants créent des jeux vidéo en un temps limité.
Gimp : Logiciel libre de manipulation d’images.
GitHub : Plateforme de gestion de code et de collaboration pour les développeurs.
GNU : Système d’exploitation libre initié par Richard Stallman.
GPL : General Public License, licence garantissant la liberté d’usage, de modification et de distribution des logiciels.
H
Hackaton : Événement collaboratif où des développeurs créent des solutions numériques en un temps limité.
Hackeur : Personne explorant ou modifiant des systèmes informatiques.
Hardware : Composants physiques d’un système informatique.
HDPE : Polyéthylène haute densité, un plastique recyclable utilisé dans de nombreux objets.
High-tech : Technologies de pointe.
Holocène : Époque géologique précédant l’Anthropocène
HTML : HyperText Markup Language, langage de base pour structurer les pages web.
I
Inkscape : Logiciel libre de dessin vectoriel.
Intelligence artificielle (I. A.) : Simulation des capacités humaines par des machines.
Interface graphique utilisateur (GUI) : Interface visuelle permettant d’interagir avec un logiciel.
Internet : Réseau mondial interconnectant des ordinateurs
Interopérabilité : Capacité de différents systèmes à fonctionner ensemble.
J
JavaScript : Langage de programmation utilisé pour rendre les pages web interactives.
K
Kernel : Cœur d’un système d’exploitation gérant les interactions matériel-logiciel.
L
Langage de programmation : Langage utilisé pour écrire des programmes informatiques.
Licence libre : Licence autorisant l’usage, la modification et le partage d’un logiciel.
Limites planétaire (planetary boundaries) : Frontières écologiques à ne pas dépasser pour maintenir des conditions favorables sur Terre.
Linux : Système d’exploitation libre.
Logiciel (software) : Programme informatique.
Longévité : Durée de vie d’un objet ou système.
Low-tech : Solutions technologiques simples, durables et accessibles.
M
Machine virtuelle : Simulation logicielle d’un ordinateur.
Makers : Communauté de créateurs DIY.
Markerspace : Atelier collaboratif équipé d’outils pour la création.
Microprocesseur : Circuit intégré réalisant les calculs d’un ordinateur.
N
Navigateur web : Logiciel permettant de consulter des pages web.
Nerd : Passionné de sciences ou de technologies.
NTIC : Nouvelles technologies de l’information et de la communication.
Numérique : Domaine lié aux technologies de l’information et de la communication.
O
Obsolescence programmée : Stratégie réduisant la durée de vie d’un produit.
Octet : Unité de stockage informatique (8 bits).
Oligarchie : Pouvoir concentré entre les mains d’un petit groupe.
Opensource : Logiciel dont le code source est librement accessible.
Open hardware : Conception matérielle ouverte et partagée.
P
PC-ABS : Polycarbonate Acrylonitrile Butadiène Styrène, un plastique robuste utilisé dans l’impression 3D et dans l’industrie de l’électronique.
Peer-to-peer (pair à pair) : Réseau décentralisé où les utilisateurs partagent des ressources directement.
Permaculture : Conception de systèmes agricoles durables.
Piratage : Accès non autorisé à des systèmes informatiques.
Pixel : Plus petite unité d’une image numérique.
Plug-in : Module complémentaire ajoutant des fonctionnalités à un logiciel.
Procédural : En programmation, méthode qui consiste à exécuter des instructions dans un ordre défini.
Processeur : Cœur d’un ordinateur effectuant les calculs.
Processing : Langage et environnement de programmation utilisé pour la création visuelle et interactive.
Programmation : Processus de création et d’écriture de logiciels ou d’applications.
Publication assistée par ordinateur (PAO) : Utilisation de logiciels pour concevoir des documents destinés à l’impression.
Q
R
RAM : Random Access Memory, mémoire vive d’un ordinateur utilisée pour les tâches en cours.
Réalité virtuelle : Environnement numérique immersif simulé par un dispositif informatique.
Reconditionnement : Rénovation d’un produit pour prolonger sa durée de vie.
Recyclage : Transformation de matériaux usagés pour en créer de nouveaux.
Réemploie : Réutilisation d’objets ou matériaux pour leur donner une seconde vie.
Résilient : Capable de s’adapter et de résister aux perturbations.
Résolution : Densité de pixels dans une image ou sur un écran, mesurée en pixels par pouce (ppp).
Rétrocompatibilité : Capacité d’un système ou logiciel à fonctionner avec des versions plus anciennes.
S
Salvage computing : Pratique consistant à recycler ou réutiliser du matériel informatique.
Scribus : Logiciel libre de publication assistée par ordinateur (PAO).
Serveur (cloud) : Ordinateur distant hébergeant des données et applications accessibles via Internet.
Sobriété : Réduction volontaire de la consommation pour minimiser l’impact écologique.
Solarpunk : Mouvement culturel et artistique imaginant un avenir durable et optimiste grâce aux énergies renouvelabes.
Stochastiques : Phénomènes ou systèmes régis par des probabilités ou l’incertitude.
Système d’exploitation : Logiciel de base gérant les ressources matérielles et logicielles d’un ordinateur.
T
Technosolutionisme : Croyance en la capacité des technologies à résoudre tous les problèmes sociaux ou environnementaux.
Terminal (de commande) : Interface textuelle permettant d’interagir avec un système informatique via des commandes.
Trackpad : Périphérique tactile permettant de contrôler le curseur d’un ordinateur.
U
UEFI : Unified Extensible Firmware Interface, remplaçant moderne du BIOS pour gérer le démarrage des ordinateurs.
UNIX : Système d’exploitation multitâche utilisé comme base pour de nombreux autres systèmes (Linux, macOS).
URL : Uniform Resource Locator, adresse permettant d’accéder à une ressource sur Internet.
Utopie : Vision idéalisée d’une société parfaite et harmonieuse.
V
Vernacular computing : Approche utilisant des technologies locales, accessibles et adaptées aux besoins spécifiques.
W
Web : ensemble des pages accessibles via Internet, reliées entre elles par des hyperliens.
X
Y
Z
Colophon
Mémoire de recherche-projet de Master 2 Design Transdisciplinaire, Cultures et Territoires, sous la direction de Brice Genre et de Sylvain Bouyer, année 2024-2025.
Université Toulouse - Jean Jaurès département arts plastiques / design.
Design graphique : Arthur Goujon.
Caractère typographique, sous licence libre OFL : « Redaction », dessiné par Titus Kaphar et Reginald Dwayne Betts.
https://www.redaction.us/
Outil de la mise en page complète : Paged.js
L'objectif de ce mémoire en tant qu’objet éditorial est de suivre les lignes directrice du permacomputing. Ce faisant, un minimum de règles sont injectées dans le code de paged.js, offrant une mise en page simple, efficace, et claire. De part ces règles, des lézardes, veuves et orphelines existent et sont volontaires. Le format A4 de ce mémoire est courant et économique. Il est non pas plié en format A5, mais dans le sens de la longueur pour offrir un objet éditorial qui dénote.
Version web interactive disponible sur : www.arthurgoujon.fr
Imprimé par Copy Diffusion Service.
6 place du Parlement, 31000 Toulouse.
FR - Les limites planétaires et la décroissance soulignent la nécessité urgente de repenser fondamentalement nos modes de consommation et de production, afin de préserver les ressources limitées de notre planète et de minimiser notre impact sur l’environnement. Dans ce contexte, le permacomputing émerge comme un mouvement novateur qui cherche à intégrer les principes de la permaculture, (durabilité, rendement et résilience) dans le domaine de l’informatique et de la technologie. Au cœur du permacomputing se trouve la conscientisation de notre utilisation des machines et des chaînes de production des technologies informatiques. Ce principe vise aussi à contrer l’obsolescence programmée, c’est-à-dire le fait délibéré des industriels de créer des objets à dates de péremption sans possibilité de réparation. Cela implique pour le permacomputing de privilégier les solutions modulaires et réparables, ainsi que de favoriser le réemploi des équipements informatiques plutôt que leur remplacement constant. Dans cette optique, une longévité programmée est encouragée, mettant l’accent sur la conception de produits électroniques facilement réparables. Il s’agit donc de l’importance que nous donnons à nos objets. Comment alors changer notre point de vue sur et la distinction sociale de nos ordinateurs portables, grâce à des objets non plus de cherté, mais des objets de fierté ?
Permacomputing, Décroissance, Low-tech, Open hardware, Réemploi, Résilience, Effondrement, Technocritique, Autonomie technologique
EN - Planetary boundaries and degrowth highlight the urgent need to fundamentally rethink our consumption and production patterns, in order to preserve our planet’s limited resources and minimize our impact on the environment. In this context, permacomputing is emerging as an innovative movement that seeks to integrate the principles of permaculture (sustainability, performance and resilience) into the field of computing and technology. At the heart of permacomputing therefore lies awareness of our use of machines and IT technology production chains. This principle also aims to counter planned obsolescence, that is to say the deliberate act of manufacturers to create objects with expiry dates without the possibility of repair. This therefore implies for permacomputing to favor modular and repairable solutions, as well as to favor the reuse and reuse of electronic equipment rather than their constant replacement. With this in mind, planned longevity is encouraged, emphasizing the design of easily repairable electronic products. So it’s about the importance we give to our objects. How then can we change our point of view on and the social distinction of our laptops, thanks to objects no longer expensive, but objects of pride?
Permacomputing, Degrowth, Low-tech, Open hardware, Reuse, Resilience, Collapse, Technocriticism, Technological autonomy